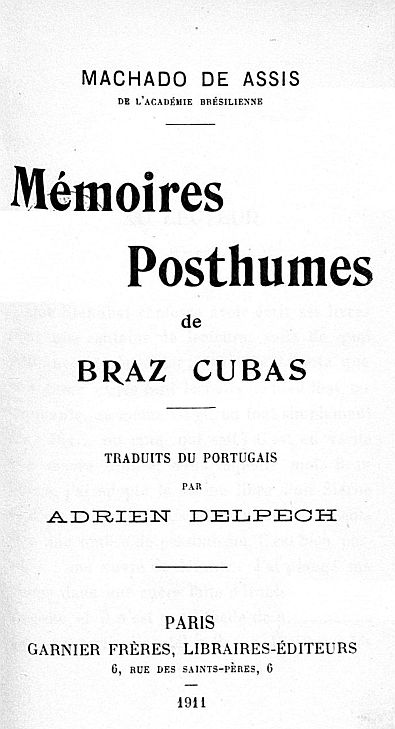
Project Gutenberg's Mémoires Posthumes de Braz Cubas, by Machado de Assis This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Mémoires Posthumes de Braz Cubas Author: Machado de Assis Translator: Adrien Delpech Release Date: December 4, 2019 [EBook #60847] Language: French Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MÉMOIRES POSTHUMES DE BRAZ CUBAS *** Produced by Laura Natal Rodrigues at Free Literature (Images generously made available by Gallica, Bibliothèque nationale de France.)
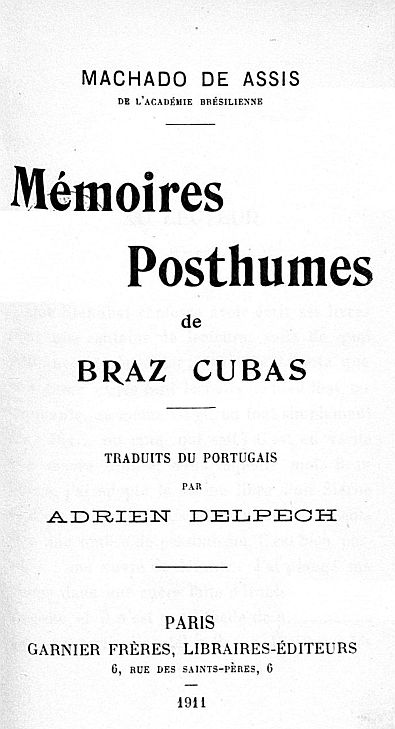
TABLE DES MATIÈRES
AU LECTEUR
I. MORT DE L'AUTEUR
II. L'EMPLÂTRE
III. GÉNÉALOGIE
IV. L'IDÉE FIXE
V. OÙ L'ON VOIT POINDRE L'OREILLE D'UNE FEMME
VI. «CHIMÈNE, QUI L'EÛT DIT? RODRIGUE, QUI L'EÛT CRU?»
VII. LE DÉLIRE
VIII. RAISON CONTRE FOLIE
IX. TRANSITION
X. CE JOUR-LÀ
XI. L'ENFANT EST LE PÈRE DE L'HOMME
XII. UN ÉPISODE DE 1814
XIII. UN SAUT
XIV. LE PREMIER BAISER
XV. MARCELLA
XVI. UNE RÉFLEXION IMMORALE
XVII. CONSIDÉRATIONS SUR LE TRAPÈZE
XVIII. VISION DANS LE CORRIDOR
XIX. À BORD
XX. JE PASSE MON BACCALAURÉAT
XXI. LE MULETIER
XXII. RETOUR À RIO
XXIV. COURT, MAIS GAI
XXV. À LA TIJUCA
XXVI. L'AUTEUR HÉSITE
XXVII. VIRGILIA
XXVIII. POURVU QUE
XXIX. LA VISITE
XXX. LA FLEUR DU BUISSON
XXXI. LE PAPILLON NOIR
XXXII. BOITEUSE DE NAISSANCE
XXXIII. BIENHEUREUX CEUX QUI SAVENT RESTER
XXXIV. À UNE ÂME SENSIBLE
XXXV. LE CHEMIN DE DAMAS
XXXVI. À PROPOS DE BOTTES
XXXVII. ENFIN!
XXXVIII. LA QUATRIÈME ÉDITION
XXXIX. LE VOISIN
XL. DANS LE CABRIOLET
XLI. L'HALLUCINATION
XLII. CE QUE N'A POINT TROUVÉ ARISTOTE
XLIII. MARQUISE: ATTENDU QUE JE SERAI MARQUIS
XLIV. UN CUBAS
XLV. NOTES
XLVI. L'HÉRITAGE
XLVII. LE RECLUS
XLVIII. UN COUSIN DE VIRGILIA
XLIX. LE BOUT DU NEZ
L. VIRGILIA MARIÉE
LI. ELLE EST À MOI
LII. LE PAQUET MYSTÉRIEUX
LIII. ......
LIV. LA PENDULE
LV. VIEUX DIALOGUE D'ADAM ET D'ÈVE
LVI. LE MOMENT OPPORTUN
LVII. DESTIN
LVIII. CONFIDENCE
LIX. UNE RENCONTRE
LX. L'ACCOLADE
LXI. UN PROJET
LXII. L'OREILLER
LXIII. FUYONS
LXIV. LA TRANSACTION
LXV. À L'AFFÛT ET AUX ÉCOUTES
LXVI. LES JAMBES
LXVII. LA PETITE MAISON
LXVIII. LE FOUET
LXIX. UN GRAIN DE FOLIE
LXX. DONA PLACIDA
LXXI. CRITIQUE DE CE LIVRE
LXXII. LE BIBLIOMANE
LXXIII. LE GOÛTER
LXXIV. HISTOIRE DE DONA PLACIDA
LXXV. RÉFLEXIONS
LXXVI. LE FUMIER
LXXVII. ENTREVUE
LXXVIII. LA PRÉSIDENCE
LXXIX. MOYEN TERME
LXXX. LE SECRÉTAIRE
LXXXI. LA RÉCONCILIATION
LXXXII. QUESTION DE BOTANIQUE
LXXXIII. 13
LXXXIV. LE CONFLIT
LXXXV. AU SOMMET DE LA MONTAGNE
LXXXVI. LE MYSTÈRE
LXXXVII. GÉOLOGIE
LXXXVIII. LE MALADE
LXXXIX. IN EXTREMIS
XC. VIEUX COLLOQUE D'ADAM ET DE CAÏN
XCI. UNE LETTRE EXTRAORDINAIRE
XCII. UN HOMME EXTRAORDINAIRE
XCIII. LE DÎNER
XCIV. LA CAUSE SECRÈTE
XCV. FLEURS D'AUTAN
XCVI. LA LETTRE ANONYME
XCVII. ENTRE LA BOUCHE ET LE FRONT
XCVIII. SUPPRIMÉ
XCIX. DANS LA SALLE
C. LE CAS PROBABLE
CI. LA RÉVOLUTION DALMATE
CII. REPOS
CIII. DISTRACTION
CIV. C'EST LUI
CV. ÉQUIVALENCE DES FENÊTRES
CVI. JEUX PÉRILLEUX
CVII. LE BILLET
CVIII. OÙ L'ON NE COMPREND PLUS BIEN
CIX. LE PHILOSOPHE
CX._31
CXI. LE MUR
CXII. L'OPINION
CXIII. LA SOUDURE
CXIV. FIN DE DIALOGUE
CXV. LE DÉJEUNER
CXVI. PHILOSOPHIE DES FEUILLES MORTES
CXVII. L'HUMANITISME
CXVIII. LA TROISIÈME FORCE
CXIX. PARENTHÈSE
CXX. COMPELLE INTRARE
CXXI. EN DESCENDANT LA COLLINE
CXXII. UNE INTENTION TRÈS FINE
CXXIII. LE VRAI COTRIM
CXXIV. POUR SERVIR D'INTERMÈDE
CXXV. EPITAPHE
CXXVI. DÉSOLATION
CXXVII. FORMALITÉS
CXXVIII. À LA CHAMBRE
CXXIX. SANS REMORDS
CXXX. UNE CALOMNIE
CXXXI. FRIVOLITÉS
CXXXII. LE PRINCIPE D'HELVÉTIUS
CXXXIII. CINQUANTE ANS
CXXXIV. OBLIVION
CXXXV. INUTILITÉ
CXXXVI. LE SHAKO
CXXXVII. À UN CRITIQUE
CXXXVIII. COMMENT JE NE FUS PAS MINISTRE D'ÉTAT
CXXXIX. QUI EXPLIQUE LE CHAPITRE ANTÉRIEUR
CXL. LES CHIENS
CXLI. LA DEMANDE SECRÈTE
CXLII. JE N'IRAI PAS
CXLIII. UTILITÉ RELATIVE
CXLIV. EXPLICATION SUPERFLUE
CXLV. LE PROGRAMME
CXLVI. UNE EXTRAVAGANCE
CXLVII. LE PROBLÈME INSOLUBLE
CXLVIII. THÉORIE DU BIENFAIT
CXLIX. ROTATION ET TRANSMISSION
CL. PHILOSOPHIE DES ÉPITAPHES
CLI. LA MONNAIE DE VESPASIEN
CLII. L'ALIÉNISTE
CLIII. LES NAVIRES DU PIRÉE
CLIV. RÉFLEXION CORDIALE
CLV. ORGUEIL DE LA SERVILITÉ
CLVI. PHASE BRILLANTE
CLVII. DEUX RENCONTRES
CLVIII. LA DEMI-DÉMENCE
CLIX. NÉGATIVES SUR NÉGATIVES
Que Stendhal confesse avoir écrit ses livres pour une centaine de lecteurs, voilà de quoi s'étonner et s'attrister; mais qu'importe que ce volume ait les cent lecteurs de Stendhal, ou cinquante, ou même vingt, ou tout simplement dix! Dix... ou cinq, qui sait? C'est en vérité une œuvre diffuse, dans laquelle moi, Braz Cubas, j'ai adopté la forme libre d'un Sterne et d'un Xavier de Maistre, en y mettant peut-être une ombre de pessimisme. C'est bien possible: une œuvre de défunt... J'ai plongé ma plume dans une encre faite d'ironie et de mélancolie, et il n'est pas difficile de présumer ce qui peut sortir d'un tel mélange. D'ailleurs les gens graves trouveront à ce livre des apparences de pur roman, tandis que les lecteurs frivoles y chercheront en vain la contexture habituelle du roman. Me voici donc privé de l'estime des gens graves et de la sympathie des frivoles, qui sont les deux pivots de l'opinion.
Malgré tout, je ne désespère pas de la ramener à moi, et je vais tout d'abord m'abstenir d'un prologue trop explicite et long. La meilleure préface est celle qui contient le moins de choses possible, et qui les dit d'une façon obscure et tronquée. Donc je vous fais grâce des procédés extraordinaires que j'ai employés dans la confection de ces mémoires, écrits là-bas, dans l'autre monde. Ce serait sans doute intéressant, mais surtout long, et parfaitement inutile à la compréhension de ce livre. L'œuvre vaut ce qu'elle vaut. Si elle te plaît, ô délicat lecteur, paie-moi de ma peine. Sinon je te ferai la nique, et bonsoir.
BRAZ CUBAS.
Je me suis demandé pendant quelque temps si je commencerais ces mémoires par le commencement ou par la fin, c'est-à-dire si je parlerais d'abord de ma naissance ou de ma mort. L'usage courant est de commencer par la naissance, mais deux considérations me firent adopter une autre méthode. La première c'est que je ne suis pas à proprement parler un auteur défunt, mais un défunt auteur, pour qui la tombe fut un autre berceau. La seconde c'est que j'ai pensé que cet écrit en serait ainsi plus original et plus galant. Moïse, qui a aussi narré sa mort, ne la met pas au début mais à la fin de son récit: différence radicale entre mon livre et le Pentateuque.
Je mourus donc un vendredi du mois d'août 1869, sur le coup de deux heures de l'après-midi, dans ma belle propriété de Catumby. J'avais alors soixante-quatre ans, solides et verts; j'étais vieux garçon, je possédais environ trois cents contos, et onze amis m'accompagnèrent au cimetière. Onze amis! Il est vrai qu'on n'avait envoyé aucune lettre de faire part, et qu'il tombait une pluie fine passée au tamis, si implacable et si triste qu'un de mes fidèles de la dernière heure en intercala cette ingénieuse pensée dans le discours qu'il prononça sur le bord de ma sépulture: «Vous qui l'avez connu, Messieurs, ne vous semble-t-il pas comme à moi que la Nature paraît pleurer la perte irréparable d'un des plus beaux caractères dont se puisse honorer l'humanité? Cette ambiance sombre, ces gouttes du ciel, ces nuages obscurs qui voilent l'azur comme un crêpe funèbre, révèlent la douleur profonde dont la Nature est pénétrée, et tout cela constitue un sublime tribut de louange à notre illustre défunt.»
Bon et fidèle ami! comme j'ai bien fait de lui laisser vingt titres de rente par héritage. Ce fut de la sorte que j'arrivai au terme de mon voyage; ce fut ainsi que j'entrai dans l'indiscovered country de Hamlet, exempt des angoisses et du doute du jeune prince danois. Ma retraite fut calme et traînante, comme celle de quelqu'un qui se retire tard du spectacle. Tard et rassasié. Neuf ou dix personnes assistèrent à mon départ; trois femmes entre autres: ma sœur Sabine, mariée avec Cotrim; sa fille, un lis de la vallée, et... prenez patience: d'ici peu vous saurez quelle était la troisième. Contentez-vous d'apprendre pour l'instant que cette anonyme, bien qu'elle ne fût point ma parente, eut plus de réel chagrin que mes propres parents. En vérité, elle souffrit davantage. Elle ne cria pas, elle ne se roula pas sur le sol en proie à une attaque de nerfs, c'est vrai... Mais un vieux garçon qui meurt à soixante-quatre ans ne prête pas à la douleur tragique, et de toutes les façons il ne convenait pas à l'inconnue d'en donner les marques. Debout au chevet du lit, les regards stupides, la bouche entr'ouverte, la pauvre femme ne pouvait se convaincre de mon trépas: «Mort! mort!» se répétait-elle.
Et son imagination, comme les cigognes qu'un illustre voyageur vit cingler, en dépit des ruines et du temps, de l'Illyssus vers les plages africaines, vola par-dessus les débris des années jusqu'à une Afrique juvénile. (Nous l'y accompagnerons plus tard, quand moi-même je revêtirai les traits de mes premiers ans.) Pour le moment, je veux mourir tranquille et méthodiquement, en écoutant les sanglots des dames, les chuchotements des hommes, la pluie qui tambourine sur les feuilles des tignorons dans le jardin, le frottement strident d'un tranchet que le rémouleur aiguise dehors, à la porte du sellier. Je vous jure que cet orchestre mortuaire était beaucoup moins triste qu'on ne pourrait supposer. Il finit même par me sembler délectable: la vie trébuchait en moi, la conscience s'effaçait, je tombai de l'immobilité physique dans l'immobilité morale; mon corps devenait plante, pierre, boue, puis plus rien.
Je mourus d'une pneumonie. Si j'affirme pourtant que ma mort fut causée moins par cette maladie que par une idée grandiose et utile, le lecteur ne me croira pas, quoique ce soit la vérité pure. Je Vais exposer en connaissance de cause.
Effectivement, tandis que je me promenais un matin dans le jardin, une idée se suspendit au trapèze que j'avais dans le cerveau. Puis elle commença à jouer des bras et des jambes, à faire les plus scabreuses cabrioles et les plus audacieux exercices de voltige. Je m'abîmai dans sa contemplation. Soudain elle fit un saut périlleux, puis étendit bras et jambes en forme d'X: «Déchiffre-moi ou je te dévore».
Ce n'était rien moins que l'invention d'un médicament sublime, d'un emplâtre anti-hypocondriaque, destiné à soulager notre mélancolie humaine. Dans ma demande de brevet, j'appelai l'attention du Gouvernement sur ce résultat véritablement chrétien. Cela ne m'empêcha pas du reste de m'épancher avec mes amis au sujet des avantages pécuniaires qui devaient découler de la vente d'un produit si merveilleux dans ses résultats. Mais maintenant que je suis ici, de l'autre côté de la vie, je puis bien avouer que mon enthousiasme venait principalement de l'espoir de voir ces trois paroles: Emplâtre Braz Cubas, imprimées sur les journaux, sur les murs, sur des affiches, aux quatre coins des rues. Pourquoi le nierais-je? J'avais la passion de l'esbroufe, de l'annonce et du feu d'artifice. Les modestes s'indigneront peut-être, les habiles m'en feront un titre à leur considération. Ainsi mon idée, comme les monnaies, avait deux faces: l'une tournée vers le public, l'autre vers moi. D'un côté, philanthropie et lucre; de l'autre, soif de renommée. Disons: amour de la gloire.
Mon oncle, chanoine à prébende entière, avait l'habitude de me dire que l'amour de la gloire temporelle mène à la perdition, les âmes ne devant aspirer qu'à la gloire éternelle. À cela, mon autre oncle, ancien officier d'infanterie, répondait qu'il n'y a rien de plus véritablement humain que le sentiment de la gloire, qui est une des caractéristiques de notre espèce.
Le lecteur décidera entre le militaire et le prêtre; je reviens à mon emplâtre.
Mais puisque j'ai parlé de mes deux oncles, le moment est opportun pour ébaucher ma généalogie.
Un certain Damion Cubas, qui florissait dans la première moitié du XVIIIe siècle, fut le fondateur de ma famille. Il était né à Rio de Janeiro, où il exerçait la profession de tonnelier. S'il se fût limité à cet état, il serait mort sans doute dans la gêne et l'obscurité. Mais étant devenu agriculteur, il planta, cueillit et troqua ses produits contre de bons deniers sonnants jusqu'au jour où il mourut, laissant une grosse fortune à son fils, le licencié Luiz Cubas. C'est de lui que date vraiment la série de mes aïeux, de ceux que ma famille avoue—Damion Cubas n'ayant été après tout qu'un tonnelier, peut-être même un mauvais tonnelier, tandis que Luiz Cubas passa par l'Université de Coimbra, occupa de hautes charges, et fut un des confidents du vice-roi, comte de Cunha. Comme ce nom de Cubas sentait par trop le muid, mon père, qui était l'arrière petit-fils de Damion, alléguait les hauts faits d'armes d'un certain chevalier qui, sur la terre d'Afrique, aurait reçu ce titre, un jour qu'il enleva trois cents cuves[1] aux Mores. Mon père, homme d'imagination, échappait ainsi à la tonnellerie sur l'aile d'un calembour. C'était un digne homme, d'un bon naturel, digne et loyal entre tous. Il avait bien quelques fumées de vanité. Mais trouve-t-on quelqu'un en ce bas monde qui échappe à ce travers? Il est bon d'ajouter qu'il ne recourut à ce stratagème qu'après avoir cherché à greffer notre famille sur le vieux tronc de mon célèbre homonyme, le capitan Braz Cubas, qui fonda la ville de S. Vicente où il mourut en 1592. Ce fut pour ce motif qu'il me donna le nom de Braz. Mais les descendants légitimes protestèrent, et il inventa les trois cents cuves mauresques.
J'ai encore quelques parents vivants: ma nièce Venancia, par exemple: le lis de la vallée, fleur des dames de son temps. Son père aussi, Cotrim, un individu qui... mais n'anticipons pas sur les événements. Finissons-en d'une avec l'emplâtre.
Après tant et tant de cabrioles, mon idée finit par devenir une idée fixe. Dieu te garde, lecteur, d'une semblable aventure. Mieux vaut un fétu ou même une poutre dans l'œil. Vois Cavour: ce fut l'idée fixe de l'unité italienne qui le tua. Il est vrai que Bismark n'est pas mort de la sienne. Mais la nature est une grande capricieuse, et l'histoire une éternelle toquée. Par exemple Suétone nous présente un Claude qui est un parfait imbécile,—une «citrouille», suivant l'expression de Sénèque,—et un Titus qui fut les délices de Rome. Et voici qu'un moderne professeur trouve le moyen de démontrer que des deux césars, le délicieux, l'exquis, c'est précisément la citrouille de Sénèque. Et toi, madame Lucrèce, fleur de la famille des Borgias, si un poète te peint sous les traits d'une Messaline catholique, il se présente aussitôt un Grégorovius incrédule pour adoucir ton profil. Si tu n'es pas un lis, au moins n'es-tu pas non plus un bourbier. Il me plaît de me tenir en équilibre, entre le poète et le savant.
Vive l'histoire, qui, dans sa volubilité, tourne à tous les vents. Et pour en revenir à l'idée fixe, je dirai que c'est elle qui fait les grands hommes et les fous. L'idée mobile, vague, chatoyante, est le propre des Claude, suivant la formule de Suétone.
Mon idée fixe, à moi, était fixe à un point que je ne saurais dire. Non, je ne trouve rien au monde qui soit assez fixe pour servir de terme de comparaison: peut-être la lune, peut-être les pyramides d'Égypte, ou l'ancienne diète germanique. C'est au lecteur de choisir et je le prie de ne pas faire la grimace, parce que je tarde à commencer la partie narrative de ces mémoires. Nous y viendrons. Je vois bien qu'il préfère l'anecdote à la réflexion, comme les autres lecteurs, ses confrères. Il est dans son droit. Encore un peu de patience. Ce livre est écrit avec flegme, avec le flegme d'un homme qui n'a plus à tenir compte de la brièveté du siècle. C'est une œuvre essentiellement philosophique, d'une philosophie inégale, tantôt austère, tantôt folichonne; elle n'édifie ni ne détruit; elle ne refroidit ni n'enflamme; et toutefois elle vise moins haut qu'à l'apostolat, et plus haut qu'au simple passe-temps.
Allons, rectifiez la position de votre nez, et revenons à l'emplâtre. Laissons là l'histoire avec ses caprices de dame élégante. Nous n'étions pas à Salamine, et nous n'avons point écrit la confession d'Augsbourg. Pour ma part, si de temps à autre je me souviens de Cromwell, c'est seulement pour me dire que la main de Son Altesse, cette main qui ferma le Parlement, aurait pu imposer aux Anglais l'emplâtre Braz Cubas. Et ne vous riez pas de cette banale victoire de la pharmacie sur le puritanisme. Qui ne sait qu'au pied de chaque haute et ostensible bannière, il y a souvent de petits drapeaux, modestes et particuliers, qui se dressent et se déroulent à l'ombre de ceux-ci, et quelquefois même leur survivent. Voyez le village qui s'abritait sous la protection du château féodal. Le château tomba, le village demeure. Il est vrai qu'il a grandi et a pris des airs de noblesse... Décidément ma comparaison ne vaut rien.
Mais voici que tandis que j'étais en train de préparer et de perfectionner ma recette, je reçus en plein un vent coulis. Je tombai malade; je traitai le mal par le mépris. J'avais l'emplâtre en tête. Je portais en moi l'idée fixe des fous et des forts. Je me voyais de loin m'élevant au-dessus de la multitude, pour remonter au ciel comme un aigle immortel, et ce n'est pas en présence de ce spectacle sublime qu'un homme se laisse vaincre par la douleur. Le jour suivant j'étais plus mal. Je me soignai alors, mais incomplètement, sans méthode, et sans persistance. Telle fut l'origine du mal qui m'emporta dans le domaine de l'éternité. Vous savez déjà que je mourus un vendredi, jour de mauvais augure, et je crois avoir prouvé que ce fut ma découverte qui me tua. Il y a des démonstrations moins lucides et non moins triomphantes.
Il n'était pas impossible cependant que je devinsse centenaire et que mon nom figurât dans les journaux sur la liste des macrobiens. J'avais une bonne santé, j'étais robuste. Supposez qu'au lieu de poser les bases d'une invention pharmaceutique, j'eusse réuni les éléments d'une institution politique ou d'une réforme religieuse. Le courant d'air, supérieur aux spéculations humaines, me surprenait de la même manière, et tout s'en allait à vau-l'eau. Telle est la destinée humaine.
Ce fut sur cette réflexion que je pris congé de la femme, je ne dirai pas la plus sage, mais assurément la plus belle de toutes celles de son temps, de l'anonyme du premier chapitre, celle dont l'imagination, semblable aux cigognes de l'Illyssus... Elle avait alors cinquante-quatre ans; c'était une ruine, une imposante ruine. Figurez-vous, lecteur, que nous nous étions aimés, elle et moi, bien des années auparavant, et qu'un jour, au cours de ma maladie, je la vis paraître à la porte de ma chambre.
Je la vis s'arrêter sur le seuil de l'alcôve, pâle, émue, vêtue de noir, et demeurer là sans oser entrer, peut-être intimidée par la présence d'un homme qui se trouvait avec moi. Du lit où j'étais étendu, je la contemplai pendant tout ce temps, sans lui rien dire et sans faire un geste. Nous ne nous voyions pas depuis deux ans déjà, et elle m'apparaissait, non telle qu'elle était, mais telle qu'elle avait été. Je me remémorai ce que nous fûmes tous deux, à l'époque juvénile vers laquelle un Ézéchias mystérieux fit soudain reculer le soleil. Je secouai toutes mes misères, et cette poignée de poussière, que la mort allait éparpiller dans l'éternité du néant, fut plus forte que le temps, ministre de la mort. Aucune eau de Jouvence n'eût valu cette simple et mélancolique évocation du passé.
Croyez-m'en: rien ne vaut le souvenir. On ne doit jamais se fier à la félicité présente; il y a en elle une goutte de bave de Caïn. Quand le temps a passé, quand le spasme a cessé, alors oui, on peut vraiment savourer celle des deux illusions qui est la meilleure, parce qu'elle est exempte de souffrance.
L'évocation fut d'ailleurs de courte durée. La réalité s'imposa, le présent fit disparaître le passé. Peut-être exposerai-je au lecteur, dans quelque page de ce livre, ma théorie des éditions humaines. Pour le moment, ce qu'il est important de savoir, c'est que Virgilia (elle s'appelait Virgilia) entra dans l'alcôve, avec la fermeté, la gravité que lui donnaient ses vêtements et aussi les années, et s'approcha de mon chevet. L'étranger se leva et sortit. C'était un individu qui venait tous les jours me rendre visite pour me parler du change, de la colonisation et de la nécessité de multiplier les chemins de fer au Brésil. Comme c'était passionnant pour un moribond! Il sortit; Virgilia demeura debout; durant quelques instants nous nous regardâmes en silence. Qui l'eût dit? de deux grands amoureux, de deux passions effrénées, il ne restait rien après vingt années: rien, ou tout au plus deux cœurs desséchés, dévastés par la vie et rassasiés d'elle, peut-être pas autant l'un que l'autre, mais enfin rassasiés tous deux. Virgilia avait alors la beauté de la vieillesse, un air austère et maternel. Elle était moins maigre qu'à notre dernière rencontre à la Tijuca dans une fête de la Saint-Jean. Elle faisait tête au temps: c'est à peine si quelques fils blancs s'intercalaient entre ses cheveux noirs.
—Voilà que vous rendez visite aux défunts, lui dis-je.
—Qui parle de défunts? répondit-elle en faisant la moue.
Et après m'avoir serré la main:
—Je m'occupe de secouer les paresseux.
Elle n'avait plus la caresse attendrie d'un autre temps, mais sa voix était amicale et douce. Elle s'assit. J'étais seul chez moi, en compagnie d'un simple infirmier. Nous pouvions nous parler en toute franchise. Virgilia me donna des informations du dehors: elle comptait avec esprit, assaisonnant ses discours d'un peu de médisance, ce sel de la conversation. Et sur le point de quitter le monde, j'éprouvais un plaisir satanique à me moquer de lui, à me convaincre que je perdais bien peu de choses en vérité.
—Quelle idée! interrompit Virgilia, en grossissant la voix. Si vous continuez, je ne reviendrai plus. Mourir! naturellement, nous sommes tous mortels. Il suffit d'être en vie.
Et regardant sa montre:
—Mon Dieu! déjà trois heures. Je file.
—Déjà?
—Oui; je reviendrai demain ou après-demain.
—Je ne sais trop que vous conseiller. Votre malade est un vieux garçon, et il n'y a aucune femme chez lui.
—Et votre sœur?
—Elle ne pourra venir qu'à partir de samedi.
Virgilia réfléchit un instant. Puis elle haussa les épaules, et dit gravement:
—Je suis vieille! Personne ne remarquera... D'ailleurs, pour couper court aux racontages, j'amènerai Nhonhô.
Nhonhô était l'unique fruit de son mariage, et à l'âge de cinq ans, il avait été le complice inconscient de nos amours. À l'époque de ma maladie, il était déjà avocat. Ils vinrent tous deux, le surlendemain, et j'avoue qu'en les recevant dans ma chambre, je fus pris d'une timidité qui ne me permit pas de répondre tout de suite aux paroles affectueuses du jeune homme. Virgilia devina ce qui se passait en moi, et lui dit:
—Nhonhô, regarde-moi ce grand enfant gâté qui ne dit rien pour faire croire qu'il est très malade.
Le jeune homme sourit; je souris aussi, je crois, et nous plaisantâmes. Virgilia était sereine et souriante, offrant l'aspect des existences immaculées, sans un regard suspect, sans un geste dénonciateur. Son égalité de parole et de caractère dénonçait une domination d'elle-même assez rare, sans doute. Notre conversation glissa par hasard aux amours illégitimes, moitié divulguées, moitié secrètes, d'une personne de notre connaissance, et qui était même son amie, ce qui ne l'empêcha pas de montrer à l'égard de celle-ci quelque dédain et même de l'indignation. Son fils écoutait avec satisfaction cette voix digne et forte, et je me demandais à moi-même ce que les pies-grièches diraient de nous, si Buffon était né pie-grièche.
C'était le délire qui méprenait.
Je ne sache pas que personne ait encore raconté son propre délire. La science me sera redevable de ce service. Les lecteurs indifférents aux phénomènes mentaux pourront sauter ce chapitre. Mais même si vous n'êtes pas curieux, vous trouverez peut-être intéressant de savoir ce qui se passa dans ma tête pendant près d'une demi-heure.
Je pris d'abord la forme d'un barbier chinois habile et grassouillet, en train de raser de près un mandarin, qui me payait de ma peine par des chiquenaudes et des dragées: simples caprices de mandarin.
L'instant d'après, je devins la Somme de Saint Thomas, imprimée en un volume et reliée en maroquin, avec des fermoirs d'argent et des estampes. Ce délire donna à mon corps la plus rigide immobilité. Je me rappelle encore que mes mains formaient les fermoirs du livre. Je les tenais croisées sur le ventre, et quelqu'un (Virgilia sans doute) les décroisait, parce que cette attitude semblait celle de la mort.
Enfin je fus rendu à la forme humaine, et livré à un hippopotame, qui m'emporta. Je me laissai faire, sans protester, et je ne sais trop si je ressentais de la peur ou un sentiment de confiance. Mais au bout d'un instant, la course devint tellement vertigineuse que j'osai l'interroger, et lui dire, après quelques précautions oratoires, qu'il me semblait aller à l'aventure.
—Tu te trompes, me répondit l'animal. Nous remontons à l'origine des siècles.
Je lui fis observer que c'était un peu loin. Mais l'hippopotame ne m'entendit pas ou ne me comprit pas, ou feignit de ne pas entendre. Je lui demandai, puisqu'il parlait, s'il descendait du cheval d'Achille ou de l'âne de Balaam, et il me répondit par un geste commun à ces deux animaux: il secoua les oreilles. Je fermai alors les yeux et m'abandonnai au hasard. J'avoue que je ressentis quelque démangeaison de savoir où se trouvait placée l'origine des siècles, si elle était aussi mystérieuse que celle du Nil, et surtout si elle valait plus ou moins que la consommation des mêmes siècles: réflexions d'un cerveau malade. Comme je fermais les yeux, je ne voyais pas le chemin. Je me souviens seulement que l'impression du froid augmentait à mesure que nous avancions. À un certain moment, je crus entrer dans la région des neiges éternelles. J'ouvris alors les yeux, et je vis qu'en effet mon hippopotame galopait sur une plaine de neige, couverte de quelques montagnes de neige, d'une végétation de neige, et de quelques grands animaux également de neigé. On ne voyait que de la neige; un soleil de neige nous pénétrait de froidure. J'essaya de parler, mais de froidure. J'essayai de parler, mais je ne pus prononcer que cette question anxieuse:
—Où sommes-nous?
—Nous avons passé l'Éden.
—Arrêtons-nous alors sous la tente d'Abraham.
—Mais puisque nous allons en arrière, répartit ma monture en se moquant de moi.
Je demeurai ahuri et vexé. Le voyage me parut décidément extravagant et sans intérêt, le froid incommode, le moyen de locomotion brutal et le but inaccessible. De plus,—imagination de malade,—je me disais qu'en supposant même que nous y arrivions, il n'était pas impossible que les siècles, irrités de cette profanation, nous déchirassent entre leurs ongles, qui devaient être séculaires comme eux. Tandis que je me livrais à ces réflexions, nous dévorions l'espace, et la plaine fuyait sous nos pieds. Enfin l'animal s'arrêta, et je pus regarder autour de moi. Regarder seulement, car je ne vis rien, hors l'immense linceul de neige qui couvrait alors le ciel même, demeuré jusque-là limpide. Par moment, j'entrevoyais quelque énorme plante agitant au vent ses larges feuilles. Le silence était sépulcral. On eût dit que la vie des êtres se figeait en présence de l'homme.
Et voici qu'un visage énorme (tombait-il du ciel? sortait-il de terre, je ne sais), un visage de femme, fixant sur moi des regards rutilants comme le soleil, m'apparut. Il avait l'ampleur des solitudes sauvages et il échappait à la compréhension humaine, car ses contours se perdaient dans l'ambiance, et ce qui paraissait opaque était tout simplement diaphane. Dans ma stupéfaction, je ne dis rien, je ne poussai pas un cri. Mais au bout d'un instant, dans ma curiosité délirante, je lui demandai son nom.
—Je suis, comme il te plaira, la Nature ou Pandore. Je suis ta mère et ton ennemie.
En entendant ces mots, je reculai un peu, pris d'épouvante. La figure poussa un large éclat de rire, qui fit autour de nous l'effet d'une tempête. Les plantes se contorsionnèrent, et un long gémissement rompit le silence.
—Ne crains rien, me dit-elle; mon inimitié ne tue pas. C'est au contraire par la vie qu'elle s'affirme. Tu vis: je ne te souhaite pas d'autre mal.
—Vis-je vraiment? demandai-je en enfonçant mes ongles dans ma chair, pour me certifier de ma propre existence.
—Oui, ver de terre, tu vis. Ne crains pas de perdre ces haillons, dont tu t'enorgueillis. Pendant quelques heures encore, tu goûteras le pain de la douleur et le vin de la misère. Tu vis, dans ta folie actuelle, tu vis. Et si ta conscience se réveille un instant et reprend sa sagacité, tu diras encore que tu veux vivre.
Ce disant, la vision étendit le bras, me saisit par les cheveux, m'éleva dans les airs comme elle eût fait d'une plume. Alors seulement je contemplai de près son visage qui était énorme. Il était d'une quiétude parfaite, sans contorsions, sans expression de haine ou de férocité. Sa caractéristique unique et complète était l'impassibilité égoïste, l'éternelle surdité, la volonté immobile. Ses colères, si elle en ressentait, demeuraient enserrées dans son cœur. En même temps, sur ce visage glacial, il y avait un air de jeunesse, de force et de santé, en présence duquel je me sentais le plus débile et le plus décrépit des êtres.
—M'entends-tu? dit-elle enfin, au bout de quelques instants de mutuelle contemplation.
—Non, répondis-je; je ne veux pas te comprendre, tu es absurde, tu es un mythe. Je rêve, sans doute; ou si par hasard je suis devenu fou, tu n'es qu'une conception d'aliéné, une chose vaine, que la raison absente ne peut ni diriger ni palper. La Nature?... celle que je connais est bien une mère, mais non une ennemie. Elle ne fait pas de la vie un fléau; elle n'a pas, comme toi, cet air indifférent et sépulcral. Et pourquoi Pandore?
—Parce que je porte sur moi les biens et les maux, et le pire de tous, l'espérance, consolation des hommes. Tu trembles?
—Oui, ton regard me fascine.
—Sans doute; car je ne suis pas seulement la vie, mais aussi la mort; et d'ici peu tu vas me rendre ce que je n'ai fait que te prêter. Grand voluptueux, la volupté du néant t'attend.
Quand cette parole retentit comme un coup de tonnerre dans cette immense vallée, je crus que c'était le dernier son qui parviendrait à mes oreilles. Je sentis comme la décomposition subite de moi-même. Je lui lançai un regard suppliant et demandai un sursis de quelques années.
—Vie éphémère, s'écria la vision, pourquoi souhaiter encore quelque prolongement? pour dévorer encore, et être enfin dévorée à ton tour. N'es-tu point lasse du spectacle de la lutte? Tu connais à fond tout ce que je t'offre de moins ignoble et de moins triste: le lever du soleil, la mélancolie des soirs, le sommeil, enfin, qui est le plus grand présent de mes mains. Que te faut-il encore, sublime idiote?
—La continuation de moi-même: je ne te demande rien de plus. Qui donc m'a mis dans le cœur, sinon toi, cet amour de la vie? Et si j'aime la vie, n'est-ce point te frapper toi-même que de me tuer?
—Non; car je n'ai plus besoin de toi. Ce qui importe au temps, ce n'est pas la minute qui passe, c'est celle qui vient. Celle-ci est forte, allègre; elle se croit immortelle, bien qu'elle porte la mort en elle, et qu'elle doive périr comme celle qui l'a précédée. Seul le temps subsiste. Égoïsme, diras-tu; sans doute, mais j'ai encore une autre loi: égoïsme, et conservation. La panthère enlève un veau du troupeau en se disant qu'elle doit vivre; et si le veau est tendre tant mieux. C'est la règle universelle. Monte et regarde.
Ce disant, la vision m'emporta au sommet d'une montagne. J'abaissai mes yeux vers la vallée, et pendant longtemps je contemplai dans le lointain, à travers le brouillard, une chose unique. Figure-toi, lecteur, une réduction des siècles défilant devant moi, exhibant toutes les races, toutes les passions, le tumulte des empires, la guerre des appétits et des haines, la destruction réciproque des êtres et des choses. Curieux et cruel spectacle! L'histoire de l'homme et de notre planète prenait ainsi une intensité que ne sauraient lui donner ni l'imagination ni la science, car la science est plus lente et l'imagination plus vague, tandis que ce que j'avais devant moi était la condensation vivante de tous les temps. Impossible de décrire ce spectacle: ce serait vouloir fixer l'éclair. Les siècles se succédaient en tourbillon, et pourtant je voyais, avec la vision spéciale du délire, tout ce qu'ils contenaient: fléaux et délices, gloire et misère, et l'amour aggravant la faiblesse. Voici venir la jalousie qui dévore, la colère qui enflamme, l'envie qui bave, et la pioche et la plume humide de sueur, et l'ambition et la faim, et la vanité, et la mélancolie, et la richesse, et l'amour: toutes les passions qui agitent l'homme comme un jouet, ou le détruisent et en font un haillon. Je voyais les formes multiples du même vice originel, qui tantôt mord les viscères, tantôt s'attaque à la pensée, et promène éternellement son habit d'arlequin sur l'humanité tout entière. La douleur cédait parfois, ou à l'indifférence qui est un sommeil sans rêve, ou au plaisir qui est une douleur bâtarde. L'homme, flagellé et rebelle, courait au-devant de la fatalité des choses, après une figure nébuleuse et fuyante, faite de lambeaux de l'impalpable, de l'improbable, de l'invisible, mal cousus avec l'aiguille de l'imagination. Et cette image, vaine chimère de la félicité, ou s'éloignait perpétuellement, ou se laissait prendre par un pan de sa robe, dont l'homme s'enveloppait aussitôt la poitrine, tandis qu'elle partait d'un éclat de rire et jouissait comme un songe.
Devant tant de misères, je ne pus contenir un cri d'angoisse que Nature ou Pandore entendit sans rire ni protester; et je ne sais par quelle bizarrerie cérébrale ce fut moi qui me mis à rire d'un rire inextinguible et idiot.
—Tu as raison, dis-je; le spectacle est divertissant et vaut la peine d'être vu, quoiqu'il soit un peu monotone. Quand Job maudissait le jour où il fut conçu, il eût aimé à voir d'ici ce spectacle. Allons, Pandore, ouvre tes entrailles et digère-moi; le spectacle est divertissant, mais digère-moi.
Je fus invité, pour toute réponse, à regarder au-dessous de moi les siècles qui continuaient à passer, rapides et turbulents, les générations qui se superposaient aux générations, les unes tristes compte la captivité d'Israël, les autres gaies, comme les extravagances de Commode, et toutes s'engouffrant ponctuellement dans le sépulcre. Je voulais fuir, mais une force inconnue alourdissait mes pieds. Alors je me dis en moi-même: «Bon! laissons passer les siècles; le mien aura son tour et tous après lui, jusqu'au dernier, qui me donnera le mot de l'énigme de l'éternité.» Et je regardai, et je continuai à voir les âges qui survenaient et passaient, et je me sentais résolu et tranquille, peut-être même satisfait. Oui, peut-être bien, satisfait. Chaque siècle apportait sa part d'ombre et de lumière, d'apathie et de combativité, d'erreur et de vérité, son cortège de systèmes d'idées neuves, de nouvelles illusions. En chacun d'eux un printemps reverdissait, un automne jaunissait, suivi d'un autre renouveau. L'histoire et la civilisation se tissaient ainsi avec cette régularité de calendrier, et l'homme, d'abord nu et désarmé, s'armait et se vêtait, construisait sa cabane et son palais, la sauvage bourgade ou la Thèbes aux cent portes, créait la science qui scrute, et l'art qui charme, devenait orateur, mécanicien, philosophe, parcourait le globe, descendait dans les entrailles de la terre, s'élevait jusqu'aux nuages, collaborant ainsi à l'œuvre mystérieuse du maintien de la vie et de la mélancolie de l'abandon. Mon regard, lassé et distrait, vit ainsi arriver le siècle présent et derrière lui les siècles futurs. Celui-ci venait agile, adroit, vibrant, rempli de lui-même, un peu diffus, audacieux, savant, et malgré tout aussi misérable que les autres, et ainsi je le vis passer comme tous passeront après lui, avec la même égalité et la même monotonie. Je redoublai d'attention, j'allais enfin voir le dernier,—le dernier! Mais à ce moment, la vélocité était telle qu'elle ne donnait plus prise à la compréhension; auprès d'elle, la durée de l'éclair était un siècle. Les objets commencèrent à se confondre; les uns grandirent, les autres s'amoindrirent, d'autres se perdirent dans l'ambiance. Une brume s'étendit autour de moi et couvrit tout, moins l'hippopotame qui m'avait amené, et qui lui-même commença à diminuer, à diminuer, et fut réduit aux dimensions d'un modeste chat. Et c'était bien un chat, en vérité. En regardant attentivement, je reconnus Sultan qui jouait à la porte de ma chambre avec une boule de papier.
Vous avez déjà compris, lecteur, que la Raison réintégrait sa demeure, et qu'elle invitait le Délire à en sortir, en répétant à meilleur droit les paroles de Tartufe:
La maison est à moi, c'est à vous d'en sortir.
Mais ce n'est pas d'hier que la Folie aime à habiter la maison d'autrui, de telle sorte qu'il est fort difficile de la faire déloger lorsqu'une fois elle a élu domicile quelque part. C'est un tic: elle n'en démord pas; il y a beau temps qu'elle a toute honte bue. Et si nous comptons le nombre des habitations dont elle s'empare d'une fois, ou pour y passer une saison, nous conclurons que cette aimable voyageuse doit être la terreur des propriétaires. Dans mon cas, il y eut presque une émeute à la porte de mon cerveau, car l'intruse ne voulait pas sortir, et la propriétaire réclamait à cor et à cris ce qui lui appartenait. La Folie capitula, ne demandant qu'une toute petite place au grenier, pour y fixer sa résidence.
Mais la Raison répliqua:
—Non, madame, je suis lasse de vous souffrir dans mon grenier, et je suis payée pour vous connaître. Ce que vous voulez c'est prendre pied pour envahir progressivement la salle à manger, le salon et le reste de la maison.
—Laissez-moi au moins quelques minutes de répit; je suis sur la piste d'un mystère.
—Quel mystère?
—De deux, même, corrigea la Folie: celui de la vie et de la mort. Je ne vous demande que dix minutes.
La Raison se prit à rire.
—Tu seras toujours la même, toujours la même, toujours la même.
Et ce disant, elle la prit par les poignets et la flanqua dehors. Puis elle rentra, et ferma la porte derrière elle. La Folie proféra encore quelques reproches; mais enfin, perdant toute espérance, elle tira la langue en faisant la grimace, et suivit son chemin...
Et savourez l'habileté, l'art avec lequel je fais la plus importante transition de ce livre. Voyez plutôt: mon délire commence en présence de Virgilia; Virgilia fut mon grand péché de jeunesse; il n'y a pas de jeunesse qui ne soit précédée de l'enfance; l'enfance suppose la naissance; et voilà comment, sans efforts, nous arrivons au 20 octobre 1805, qui est le jour où je naquis. Avez-vous bien remarqué: aucune suture apparente, rien qui distraie la sereine attention du lecteur, rien; de telle sorte que ce livre conserve ainsi tous les avantages de la méthode, sans la rigidité de la méthode. En vérité il était temps. La méthode est indispensable; mais je la préfère en déshabillé, sans atours ni colifichets, se moquant des opinions du voisin et de celles du commissaire de police de quartier. C'est comme l'éloquence: il en est une naturelle et vibrante, d'un art sincère et ensorceleur; et une autre empesée et vide.
Revenons au 20 octobre.
Ce jour-là, une fleur gracieuse poussa sur l'arbre des Cubas: je naquis. Paschoela, insigne sage-femme venue du Minho, et qui se vantait d'avoir ouvert les portes de la vie à une génération entière de gentilshommes, me reçut dans ses bras. Il est possible que mon père l'ait entendue faire son habituelle déclaration; je veux croire pourtant que ce fut le sentiment paternel qui induisit l'auteur de mes jours à la gratifier de deux demi-doublons. On me lava, on m'emmaillota, et je devins aussitôt le héros de la maison. Chacun pronostiquait à mon égard ce qui lui plaisait davantage. Mon oncle Jean, ancien officier d'infanterie, trouvait que j'avais le regard de Bonaparte, ce qui déplut à mon père. Mon oncle Ildefonso, alors simple prêtre, devinait en moi un futur chanoine.
—Il sera au moins chanoine; je ne dis pas plus, pour ne point paraître orgueilleux. Mais je ne serais pas surpris si Dieu le destinait à l'épiscopat. Et pourquoi, après tout, ne serait-il pas évêque! la chose n'est pas impossible. Qu'en dites-vous, Bento, mon frérot?
Mon père répondait à tous que je serais ce qu'il plairait au ciel. Et il me soulevait en l'air comme s'il eût eu l'intention de me montrer à la ville et à l'univers. Il demandait à tout le monde si je lui ressemblais, si j'étais joli, si je paraissais intelligent.
Je raconte ces choses en gros, et telles que l'on me les a narrées plus tard. J'ignore naturellement la plupart des faits de ce jour mémorable. Je sais que les voisins vinrent en personne ou envoyèrent leurs souhaits au nouveau-né, et que pendant les premières semaines, ce fut un défilé de visites à la maison. Toutes les chaises étaient prises, et jusqu'au moindre tabouret. On tailla force layettes. Si je n'énumère point les cadeaux, les baisers, les exclamations et les bénédictions, c'est que je n'en finirais plus avec ce chapitre, et qu'il faut pourtant bien qu'il ait une fin.
Je ne parlerai pas non plus de mon baptême. Tout ce qu'on m'en a dit, c'est que ce fut une des plus brillantes fêtes de l'année suivante, 1806. La cérémonie eut lieu dans l'église de São Domingos, un mardi de mars, par une belle journée, lumineuse et pure; mon parrain et ma marraine furent le colonel Rodrigues de Mattos et sa femme. Tous deux descendaient de vieilles familles du Nord et honoraient le sang qui coulait dans leurs veines, et que leurs aïeux avaient répandu dans les guerres contre la Hollande. Je crois bien que leurs noms à tous deux furent au nombre des premiers mots que je balbutiai. Et je devais le faire avec grâce, et en révélant quelque talent précoce, car sitôt que quelqu'un se présentait, il me fallait réciter ma leçon.
—Bébé, tu vas dire à ces messieurs comment s'appelle ton parrain.
—Mon parrain? c'est S. Exc. le colonel Paulo Vaz Lobo Cezar de Andrade e Souza Rodrigues de Mattos; ma marraine c'est S. Exc. Dona Maria Luiza de Macedo Rezende e Souza Rodrigues de Mattos.
—Il est extraordinaire, ce petit, s'écriaient les assistants.
Mon père était du même avis, et ses yeux brillaient d'orgueil; il passait la main sur mon front, me regardait longtemps avec tendresse satisfait de lui-même.
Je ne sais pas trop non plus quand je fis mes premiers pas; mais ils furent prématurés: peut-être pour presser la nature, m'obligea-t-on de bonne heure à m'accrocher aux chaises, ou me tenait-on par ma robe, ou me donna-t-on un cerceau. «Allons! tout seul!»... me disait ma bonne. Et moi, attiré par le hochet de fer-blanc que ma mère agitait devant moi, j'allais de l'avant, tombant par-ci, tombant par-là; et je marchais, probablement mal; mais enfin je marchais, et j'ai continué par la suite.
Je grandis; ma famille n'y fut pour rien. Je grandis naturellement, comme les magnolias et les chats. Les chats sont peut-être moins madrés, et sûrement les magnolias sont moins dissipés que je ne l'étais. Un poète disait que l'enfant est le père de l'homme. S'il en est ainsi, étudions quelques traits de mon enfance.
J'avais cinq ans à peine, et déjà l'on m'avait surnommé «l'Endiablé»; et vraiment je méritais ce titre. Je fus un des plus terribles gamins de ma génération: malin, indiscret, turbulent et volontaire. Par exemple un jour qu'une esclave me refusa une cuillerée de confiture de coco qu'elle était en train de préparer, je lui mis la tête en capilotade; et non content de cette méchanceté, je lançai une poignée de cendre dans le chaudron; puis, pour comble, j'allai raconter à ma mère que l'esclave avait gâté la confiture par simple perversité. J'avais alors six ans à peine. Prudencio, un petit mulâtre élevé à la maison, me servait de monture. Il se mettait à quatre jambes, les mains à terre, je lui glissais une corde entre les dents, en guise de frein; je lui montais sur le dos; puis le fustigeant avec une baguette, je lui faisais faire mille tours à droite et à gauche et il obéissait, en gémissant parfois; mais enfin il obéissait sans rien dire ou en murmurant un «aï! aï! Nhonhô» auquel je répondais en lui disant: «Vas-tu te taire, animal!» Cacher le chapeau des gens qui venaient nous voir, mettre des queues en papier aux personnes graves, ou les tirer par la perruque; faire des pinçons sur le bras des matrones, et autres exploits du même genre, étaient certainement des preuves d'un caractère indocile; mais je me figure que c'était en même temps des manifestations d'un esprit robuste, car mon père m'avait en grande admiration. En public il me réprimandait bien, pour la forme; mais en particulier, il me couvrait de baisers.
Il ne faudrait pas croire cependant que j'aie passé le reste de ma vie à casser des têtes ou à cacher des couvre-chefs. Mais que je sois demeuré opiniâtre, égoïste, et que j'aie toujours aimé à me moquer un peu des gens, c'est la pure et simple vérité. Si je n'ai point toujours caché leurs chapeaux, je les ai toujours un peu tirés par la perruque.
Je me suis toujours intéressé aussi à la contemplation des injustices humaines avec une tendance à les atténuer, à les expliquer, à les classer par catégories, non pas suivant un étalon rigide, mais en les considérant comme le produit des circonstances et du milieu. Ma mère m'éduquait à sa façon, en me faisant apprendre par cœur des préceptes et des oraisons. Mais c'était le sang et les nerfs qui me gouvernaient bien plus que toutes les prières; et les règles de morale perdaient l'âme qui les fait vivre pour se réduire à de simples formules. Le matin avant la bouillie, le soir avant de m'endormir, je demandais à Dieu de me pardonner mes offenses comme je pardonnais à ceux qui m'avaient offensé; mais entre la matinée et la soirée, je faisais quelque grave espièglerie, et mon père, après le premier mouvement de mauvaise humeur, me donnait de petites tapes en me disant: «Ah! polisson! ah! polisson!»
Oui, vraiment, mon père m'adorait. Ma mère était une femme faible, de peu d'esprit et d'un grand cœur, crédule, sincèrement pieuse, casanière bien que jolie, et modeste quoique riche. Elle ne craignait que deux choses au monde, le tonnerre et son mari, qui était son oracle et son Dieu. De la collaboration de ces deux êtres résulta mon éducation qui, bonne peut-être par quelque côté, était en général vicieuse, incomplète et même négative sur certains points. Mon oncle, le chanoine, faisait bien quelques reproches à son frère; il lui disait que j'étais trop libre et pas assez bien élevé, que j'étais trop gâté et pas assez châtié. Mais mon père répondait que mon éducation était faite suivant un système très supérieur à la routine coutumière; et de la sorte, sans persuader mon oncle, il arrivait à se convaincre lui-même.
De pair avec l'hérédité et l'éducation, il y eut aussi l'exemple du dehors et le milieu domestique. J'ai parlé de mes père et mère, j'avais aussi des oncles. L'un d'eux, Jean, avait la langue bien pendue, menait une vie galante et se plaisait aux conversations scabreuses. Dès que j'eus onze ans, il commença à me raconter des anecdotes plus ou moins vraies, mais toutes farcies d'obscénités. Il ne respectait pas plus mon adolescence que la soutane de son frère. Seulement, celui-ci disparaissait dès qu'il pressentait l'histoire leste. Moi non, je restais sans rien comprendre tout d'abord. Peu à peu je compris et trouvai cela drôle. Au bout d'un certain temps, c'est moi qui recherchais la compagnie de mon oncle. Il m'aimait beaucoup, me donnait des gâteaux et m'emmenait à la promenade. Quand j'allais passer quelques jours chez lui, il m'arrivait souvent de le trouver au fond du jardin, dans le lavoir, en train de causer avec les esclaves qui lavaient le linge. Il en défilait, des anecdotes, des bons mots, au milieu d'éclats de rire qu'on ne pouvait entendre de la maison, dont le lavoir était fort éloigné. Les négresses, un pagne sur le ventre, les jupes relevées, les unes dans le bassin, les autres en dehors, penchées sur les monceaux de linge sale qu'elles savonnaient, battaient ou tordaient, écoutaient les plaisanteries de l'oncle Jean, y répondaient et les commentaient de temps à autre par ces exclamations: «Doux Jésus!... Monsieur Jean est le diable en personne.»
Bien différent était mon oncle le chanoine, homme austère et chaste. Ces qualités, d'ailleurs, ne mettaient pas en relief un esprit supérieur; elles compensaient tout au plus la médiocrité de son intelligence. Il n'était pas de ceux qui voient la partie substantielle de l'Église; il ne considérait que le côté externe, la hiérarchie, les préséances, les surplis et les génuflexions. Il appartenait plutôt à la sacristie qu'à l'autel. Une lacune dans le rituel l'indignait plus qu'une infraction des commandements. Après tant d'années, je me demande s'il eût été capable d'interpréter un passage de Tertullien, ou d'exposer sans hésitations l'histoire du symbole de Nicée. Mais personne, aux grand'messes, ne connaissait mieux que lui le moment et le nombre des révérences auxquelles l'officiant a droit. L'unique ambition de sa vie fut d'être chanoine, et il avouait, du fond du cœur, que c'était la seule dignité à laquelle il pût aspirer. Pieux, sévère dans ses mœurs, minutieux dans l'observance des règles, mais faible, timide, subalterne, il possédait quelques vertus et s'y montrait exemplaire, mais il lui manquait totalement l'énergie pour les inculquer et les imposer à autrui.
De ma tante Emerenciana, sœur de ma mère, je ne dirai rien sinon qu'elle était la seule personne qui exerçât quelque autorité sur moi. Elle avait un caractère à part; mais elle ne vécut qu'un ou deux ans en notre compagnie. Il n'y a guère d'intérêt non plus à citer des parents et des intimes avec qui nous n'eûmes que des relations intermittentes, coupées par de longues séparations, et avec qui nous ne fîmes jamais vie commune. Ce qui peut être intéressant, c'est l'expression générale de la vie domestique que j'ai ébauchée: vulgarité des caractères, amour des apparences rutilantes et du tapage, faiblesse des volontés, triomphe du caprice, et le reste. De cette terre et de ce fumier, naquit cette fleur.
Mais je me reprocherais d'aller de l'avant sans compter un galant épisode de 1814; j'avais alors neuf ans.
Quand je naquis, Napoléon se trouvait au faîte de la gloire et du pouvoir. Il était empereur, et s'était imposé à l'admiration des hommes. Mon père qui, à force de vouloir convaincre les autres de notre noblesse, avait fini par y croire lui-même, nourrissait contre l'usurpateur une haine purement mentale. C'était un prétexte à continuelles discussions avec l'oncle Jean, qui, par esprit de classe ou sympathie de métier, pardonnait au despote en faveur du général. Mon oncle l'abbé se montrait inflexible, contre le Corse, et nos autres parents étaient partagés d'avis. De là naissaient de fréquentes controverses et d'éternelles discussions.
Lorsque la nouvelle de la première abdication arriva à Rio de Janeiro, il y eut naturellement chez nous une vive émotion, mais aucun brocard. Les vaincus, témoins de la satisfaction publique, se maintinrent dans un silence plein de dignité. Quelques-uns même virèrent casaque et battirent des mains. La population, franchement satisfaite, donna des signes évidents de son attachement à la famille royale. On illumina; on chanta la Te Deum, on tira des salves, on organisa des manifestations et l'on se répandit en acclamations. Ce jour-là, j'étrennais une petite épée dont mon parrain m'avait fait présent à la Saint-Antoine; et franchement, cette épée m'intéressait bien autrement que la chute de Bonaparte. Jamais je n'ai oublié cette circonstance: j'ai toujours pensé depuis que, pour chacun de nous, notre petite épée a bien plus d'importance que celle de Napoléon. Notez qu'au cours de mon existence j'ai entendu bien des discours, lu bien des pages où bruissaient de grandes idées et de plus grandes phrases, mais je ne sais trop pourquoi, par derrière les applaudissements qui s'échappaient de mon âme, j'entendais une voix lointaine me répéter cette leçon de l'expérience:
—Allons donc! tu ne penses qu'à ton épée.
Ma famille ne se contenta point de prendre une part anonyme à la joie publique; elle jugea opportun et même indispensable de célébrer la destitution de l'empereur par un dîner tel que l'écho des acclamations et des toasts arrivât aux oreilles de Son Altesse, ou tout au moins de ses ministres. Aussitôt fait que dit: on retira des armoires toute la vieille vaisselle plate, héritage de mon aïeul Louis Cubas; et aussi les serviettes de Flandre et les grands vases des Indes. On égorgea le cochon gras; les compotes et les confitures furent commandées aux commères de la rue d'Ajuda; on lava, on frotta, on polit le plancher des salles, les escaliers, les bougeoirs, les bobèches, les larges manchons de verre, tout l'appareil du luxe classique.
À l'heure dite, une société choisie se trouvé réunie: le juge provincial, trois ou quatre officiers militaires, quelques commerçants et hommes de lettres, un grand nombre de fonctionnaires des administrations, les uns accompagnés de leurs femmes et de leurs filles, les autres seuls, mais tous parfaitement unanimes dans leur désir d'étouffer la mémoire de Bonaparte sous la farce d'un dindon. Ce n'était pas un dîner, mais un Te Deum. Ce fut d'ailleurs à peu près ce que déclara un des littérateurs de l'assistance, le docteur Villaça, improvisateur insigne, qui ajouta aux mets du service un plat préparé par les muses. Je me souviens, comme si c'était d'hier, du moment où il se leva, dans sa lévite de soie où tombait la queue de sa perruque. Une émeraude ornait son doigt. Il demanda à mon oncle l'abbé le refrain de l'impromptu, fixa ses regards sur la chevelure d'une dame, toussa, leva la main droite fermée, d'où surgissait le doigt indicateur levé vers le toit, et dans cette position étudiée, il développa le texte donné. Il fit non pas un impromptu, mais trois; ensuite il jura de ne s'arrêter plus. Il demandait un thème, un autre, improvisant sans hésiter, à tel point qu'une des dames présentes ne put cacher sa grande admiration.
—Madame, répondit modestement Villaça, on voit bien que vous n'avez pas comme moi entendu Bocage, à Lisbonne, sur la fin du siècle dernier. Celui-là, oui!... quelle facilité et quels vers. Combien de fois, pendant des heures, au café Nicola, nous avons lutté à qui improviserait le plus brillamment, au milieu des bravos et des applaudissements. Quel talent, ce Bocage!... La duchesse de Cadaval me le disait encore, il y a quelques jours...
Et ces trois derniers mots, prononcés avec emphase, produisirent dans toute l'assistance un frémissement d'admiration et de surprise. Eh quoi! cet homme si familier, si simple, non seulement luttait avec les poètes, mais encore vivait dans l'intimité des duchesses! Un Bocage et une Cadaval! Au contact d'un tel personnage, les femmes se sentaient magnifiées; les hommes le considéraient avec respect: les uns avec envie, d'autres avec incrédulité. Pendant ce temps, il continuait à accumuler épithètes sur épithètes, adverbes sur adverbes, épuisant tous les mots qui riment avec tyran et usurpateur. On en était au dessert; personne ne pensait plus à manger. Dans l'intervalle des impromptus, courait un murmure allègre, une causerie d'estomacs satisfaits. Les yeux tendres et humides s'alanguissaient encore; ceux dont l'expression était vive et chaude projetaient des regards d'un bout à l'autre de la table couverte de desserts et de fruits, d'ananas en tranches, de melons éventrés, de compotiers de cristal au travers desquels en apercevait la confiture de coco finement râpé et jauni par les œufs, ou la mélasse gluante et obscure, auprès des fromages et des caras. De temps à autre, un rire jovial, ample, déboutonné, un bon gros rire de famille rompait la gravité politique du banquet. À côté de l'intérêt supérieur et commun, s'agitaient d'autres intérêts secondaires et particuliers. Les jeunes filles parlaient des chansonnettes qu'elles devaient chanter au clavecin, et du menuet et de la gigue. Il n'y avait pas une matrone qui ne se promît de danser au moins quelques mesures, pour rappeler ce qu'elle avait été au temps de son jeune âge. Un individu assis à mon côté parlait d'un arrivage de nègres qu'on lui annonçait de Louanda. Son neveu l'avisait par une lettre qu'il avait déjà acheté quarante têtes, et il avait dans sa poche une autre lettre qu'il ne pouvait pas Montrer en ce moment et qui... Ce qu'il pouvait affirmer c'est qu'on allait recevoir, par ce seul bateau, cent vingt nègres pour le moins.
Pan... pan... pan... faisait Villaça en battant des mains. La rumeur cessait subitement comme un orchestre sous la baguette du chef, et tous les regards se tournaient vers l'improvisateur. Ceux qui étaient les plus éloignés arrondissaient leurs mains autour de l'oreille pour ne pas perdre une seule syllabe. La plupart, avant même que le poète eût parlé, avaient déjà sur les lèvres un demi-sourire d'assentiment, candide et banal.
Quant à moi, seul et oublié, je regardais d'un œil amoureux une certaine compote qui était un de mes desserts favoris. Après chaque impromptu, je me disais avec satisfaction que ce serait sûrement le dernier, mais il en venait encore un autre, et le dessert demeurait intact. Personne ne pensait à en appeler. Mon père assis au haut bout, savourait largement la joie des convives, les figures joyeuses, les plats, les fleurs, enchanté de voir cette familiarité communicative qui s'établit entre les esprits les plus distants sous l'influx d'un bon repas. Je me rendais compte de tout cela, attendu que mes regards allaient de sa place au compotier avec de vains appels pour qu'il me servît. Mais il ne voyait rien que lui-même et ses convives. Et les impromptus se succédaient comme des ondées, m'obligeant à rentrer mon envie et ma demande. Je patientai tant que je pus. À la fin, je n'y tins plus. Je demandai de la confiture à voix basse; puis j'élevai la voix, je criai, je battis du pied. Mon père, qui m'eût donné la lune s'il eût dépendu de lui de le faire, appela une esclave pour me servir du dessert. Mais il était déjà trop tard. Ma tante Emerenciana m'avait enlevé de ma chaise et livré à une servante, en dépit de mes cris et de mes protestations.
L'improvisateur ne commit d'autre délit que de retarder le dessert et de provoquer ainsi mon exclusion. C'en fut assez pour que je jurasse d'exercer une vengeance, n'importe laquelle, pourvu qu'elle fût grande et exemplaire, et autant que possible rendît ma victime ridicule. Le Dr Villaça était un homme grave, lent et posé dans ses manières, âgé de quarante-sept ans, marié et père de famille. La queue en papier pendue à l'habit ou à l'extrémité de la perruque me parut insuffisante. Je rêvais mieux que cela. Je me mis à le suivre, à l'épier dans le jardin où nous étions tous descendus pour nous promener. Je le vis causer avec Dona Eusebia, sœur du sergent major Domingues. C'était une robuste fille qui n'était peut-être pas fort jolie, mais pas laide non plus.
Je l'entendis qui disait:
—Je suis très fâchée contre vous.
—Et pourquoi?
—Pourquoi... je ne sais pas... c'est ma destinée... Il y a des jours où je voudrais mourir...
Ils étaient entrés dans un petit bosquet. Le soir tombait. Je les suivis. Villaça avait dans le regard des éclairs de vin et de volupté.
—Laissez-moi, lui dit-elle.
—Personne ne nous voit. Mourir, cher ange, quelle idée! Vous savez bien que je vous suivrais dans la mort... Que dis-je!... je meurs tous les jours de passions et de tristesse...
Dona Eusebia porta son mouchoir à ses yeux.
L'improvisateur cherchait quelque phrase littéraire dans sa mémoire et trouva ceci, qu'il avait plagié comme j'eus l'occasion de le vérifier plus tard.
—Ne pleure pas, mon amour, tu ne voudrais pas que le jour se levât avec deux aurores.
Ceci dit, il l'attira vers lui. Elle résista pour la forme et se laissa faire. Leurs lèvres s'unirent, et j'entendis le bruit d'un léger baiser, du plus timide des baisers.
—Le Dr Villaça vient de donner un baiser à Dona Eusebia, m'écriai-je en courant dans le jardin.
Mes paroles furent comme un coup de tonnerre. Chacun demeura stupéfait. On se regardait, on échangeait des sourires, des observations à demi-voix. Les mères entraînaient leurs filles, sous prétexte que la nuit était fraîche.
Mon père me tira les oreilles, en cachette, vraiment même de mon indiscrétion. Mais le lendemain, à l'heure du déjeuner, en rappelant l'aventure, il me donna une petite pichenette sur le nez en disant: «Ah! polisson, va! polisson!»
Sautons maintenant à pieds joints par-dessus l'école fastidieuse où j'appris à lire, à écrire, à compter, à donner des calottes et à en recevoir: temps de diableries sur les collines et les plages, partout où l'occasion se présentait de faire l'école buissonnière.
Il y avait bien aussi quelques contrariétés: les réprimandes, les châtiments, les leçons arides et longues, et quelques autres petits ennuis, si rares et si légers. Seule la férule lourde; et encore!... ô férule, terreur de mon enfance, tu fus le Compelle intrare avec lequel un vieux maître chauve et osseux me fourra dans la tête l'alphabet, la prosodie, la syntaxe et le peu qu'il savait lui-même. Sainte férule, maudite par les générations plus modernes, que n'ai-je pu demeurer éternellement sous ton joug, avec mon âme imberbe, mes ignorances, ma petite épée de 1814, supérieure à celle de Napoléon. Car enfin, qu'exigeais-lu, ô mon vieux maître de rudiment? quelques leçons apprises par cœur, et un peu de sagesse à l'école. Rien de plus que ce que la vie exige de nous, avec cette différence que si tu m'effrayais, tu ne m'irritais point. Je te revois en ce moment, tel que tu entrais dans la classe, avec tes pantoufles de cuir blanc, ta casaque, ton mouchoir à la main, ta tête chauve et ta barbe rasée. Je te revois t'asseoir, souffler, grogner, humer une prise initiale, avant de nous faire réciter la leçon. Cette vie obscure, tu la menas vingt-trois ans, silencieux et ponctuel, enterré dans ta maisonnette de la rue do Piolho, sans attrister le monde de ta médiocrité, jusqu'au jour où tu fis le grand plongeon dans les ténèbres. Personne ne te pleura, sauf peut-être un vieux serviteur noir: personne d'autre, pas même moi qui te dois de connaître les éléments de la grammaire.
Il s'appelait Ludgero, mon vieux professeur. Je veux écrire son nom tout au long sur cette page: Ludgero Barata[2]—nom funeste qui servait aux élèves d'éternel motif de plaisanteries. Un d'entre nous, Quincas Borba, sen montrait vraiment cruel envers le pauvre homme. Deux ou trois fois par semaine, il lui glissait dans la poche de son large pantalon un cafard qu'il tuait à cette intention. Site maître mettait la main dessus aux heures de classe, il faisait un bond, et promenait sur nous ses regards irrités. Il nous disait alors les pires injures. Il nous traitait de sauvages, de paysans du Danube, de gamins des rues. Les uns tremblaient, autres protestaient. Quincas Borba demeurait impassible, les yeux en l'air.
Quel être extraordinaire, ce Quincas!... Jamais, dans mon enfance, ni du reste pendant toute ma vie, je n'ai rencontré un enfant plus spirituel, plus inventif, plus endiablé. C'était la perle, je ne dirai pas seulement de l'école, mais de la ville tout entière. Sa mère, veuve et possédant quelque bien, adorait son fils et le gâtait, le bichonnait, le faisait accompagner d'un domestique en livrée, qui nous laissait faire l'école buissonnière, dénicher les oiseaux ou courir après les lézards, sur les collines de Livramento et de la Conceição, ou tout simplement flâner dans les rues comme deux gommeux oisifs. C'était plaisir de voir Quincas Borba faire le rôle d'empereur aux fêtes du Saint-Esprit. Du reste, dans nos jeux d'enfants, il choisissait toujours un rôle de roi, de ministre, de général, la marque d'une suprématie, n'importe laquelle. Il avait de l'élégance, de la gravité, une certaine magnificence dans les attitudes et les gestes. Qui aurait dit que... mais n'anticipons pas. Faisons un saut jusqu'en 1822, date de notre indépendance politique, et de ma première captivité.
Je venais d'avoir dix-sept ans; au-dessus de mes lèvres s'estompait un léger duvet, sur lequel je tirais pour le transformer en moustaches. Je n'avais de vraiment viril que mes yeux, qui étaient vifs et résolus. Comme je montrais une certaine arrogance, il était difficile de dire si j'étais encore un enfant avec des airs d'homme, ou un homme ayant conservé des airs d'enfant. J'étais en somme un joli garçon, joli et audacieux, qui entrait dans la vie avec bottes et éperons, le fouet en main, du sang dans les veines, chevauchant une monture nerveuse, rapide et résistante comme le coursier des antiques ballades, que le romantisme alla chercher dans les châteaux du moyen âge pour le lâcher dans les rues de notre siècle. Le pis est que, fourbu de tant de courses qu'on lui fit faire, il fut mis au rancart. Le réalisme le trouva rongé de lèpre et de vermine, et par compassion lui donna asile dans ses livres.
C'est vrai que j'étais un joli garçon élégant et riche; et l'on peut facilement s'imaginer que plus d'une femme, à cette époque, baissait devant moi son front pensif, ou me fixait de ses égards avides. Entre toutes, celle qui me captiva était une... une... je ne sais trop comment dire, car ce livre est chaste, au moins dans mon intention. Ah! dans mon intention, combien il est chaste! Mais enfin, comme il faut tout dire ou rien, celle qui fit ma conquête était une Espagnole, Marcella, la «Belle Marcella» comme l'appelaient avec raison les jeunes gens de ce temps-là. Elle était fille d'un jardinier des Asturies, comme elle me l'avoua elle-même dans une heure d'expansion; car la version courante lui donnait comme père un homme de lettres de Madrid, victime de l'invasion française, qui avait été blessé puis emprisonné et enfin fusillé quand elle avait à peine dix ans. Cosas de España. Quoi qu'il en soit, fille de littérateur ou de jardinier, il est certain que Marcella ne possédait plus l'innocence rustique et ne comprenait qu'avec peine la morale prescrite par la loi. C'était une bonne fille, joyeuse, sans scrupules, un peu comprimée par l'austérité du temps, qui ne lui permettait pas d'exhiber par les rues son équipage et ses folies. Elle était impatiente, amie du luxe, de l'argent et des jeunes hommes. Cette année-là, elle se mourait d'amour pour un certain Xavier, individu riche et phtisique, une perle!
La première fois qu'elle m'apparut, ce fut au Rocio Grande, le soir de la grande illumination improvisée dès qu'on connut les premières nouvelles de la déclaration d'indépendance. Vraie fête de printemps, superbe aurore de la conscience nationale. Nous étions deux gamins: peuple et moi. Nous sortions de l'enfance avec toute la fougue de la jeunesse. Je la vis descendre d'une chaise à porteurs. Elle était imposante dans sa démarche, faite au moule, le corps svelte et ondulant, un galbe, un je ne sais quoi qu'on ne trouve que chez les impures. «Suivez-moi», dit-elle à son valet de pied; et moi je la suivis, aussi asservi que l'autre, comme si l'ordre s'adressait à moi. Je la suivis, amoureux d'elle, vibrant, le cœur illuminé des premières aurores. Chemin faisant, je l'entendis nommer: «La Belle Marcella». Marcella: j'avais entendu l'oncle Jean prononcer ce nom; et je demeurai tout étourdi.
Trois jours plus tard, mon oncle me demanda en secret si je voulais souper avec de petites femmes, aux Cajueiros. J'acceptai, et il me conduisit chez Marcella. Xavier, avec tous ses tubercules, présidait le nocturne banquet. Je ne mangeai rien ou presque rien, n'ayant d'yeux que pour la maîtresse de la maison. Quelle gracieuse petite Espagnole!... Il y avait là une demi-douzaine de femmes, toutes entretenues, jolies et pleines de charme. Mais l'Espagnole!... L'enthousiasme, quelques gorgées de vin, mon caractère impérieux et emporté, tout cela me fit faire une chose dont je ne me serais point cru capable. Sur le seuil de la maison, je dis à mon oncle de m'attendre un instant, et je gravis de nouveau les escaliers.
—Vous avez oublié quelque chose?... me demanda Marcella, debout sur le palier.
—Mon mouchoir.
Elle allait me précéder dans la direction du salon. Mais je lui saisis les mains, l'attirai à moi, et lui donnai un baiser. Je ne sais ce qu'elle me dit, si elle cria, si elle appela. Je descendis de nouveau les escaliers, rapide comme un vent d'orage, et titubant comme un homme ivre.
Je mis trente jours pour aller du Rocio Grande au cœur de Marcella, non plus en galopant sur le coursier fougueux du désir, mais en chevauchant l'âne de la patience, à la fois artificieux et entêté. Il n'y a en vérité que deux moyens de dominer la volonté des femmes: la violence symbolisée par le taureau d'Europe, l'insinuation que rappellent le cygne de Léda et la pluie d'or de Danaé. Ces trois inventions du vieux Jupiter sont passées de mode et j'y substitue le chevalet l'âne. Je ne dirai point les ruses ourdies, les tentatives de séduction, les alternatives de confiance et d'amour, les attentes déçues; je tairai tous ces préliminaires. Mais je puis affirmer que l'âne fut digne du cheval, un véritable âne de Sancho, philosophe en vérité, qui me conduisit à bon port à la fin du laps de temps déjà connu. Je descendis, caressai la croupe de l'animal, et l'envoyai paître.
Ô premières émotions de ma jeunesse, comme vous vous étiez suaves en vérité!... Telle, dans la création biblique, dut être l'effet du premier rayon de soleil, lorsqu'il éclaira la face du monde en fleur. Oui, ce fut ainsi pour moi, et pour toi aussi, ami lecteur; s'il y eut dans ta vie une dix-huitième année, tu concorderas qu'il en fut ainsi.
Notre passion, union, ou tout ce que l'on voudra, le nom importe peu, eut deux phases: la phase consulaire et la phase impériale. La première fut courte, et jamais Xavier ne soupçonna qu'il partageait avec moi le gouvernement de Rome. Le jour pourtant où la crédulité ne put tenir devant l'évidence, il déposa les insignes, je concentrai tous les pouvoirs dans mes mains. Ce fut la phase césarienne. L'univers m'appartint; mais Dieu sait ce qu'il m'en coûta. Il fallut trouver de l'argent et en inventer. J'exploitai d'abord la générosité de mon père, qui me donnait tout ce que je lui demandais, sans reproches, sans retard, sans froideur. Il disait qu'il faut que jeunesse se passe, et qu'il avait été jeune comme moi. Pourtant, j'abusai tant et tant, qu'il resserra peu à peu les cordons de sa bourse. J'eus alors recours à ma mère, qui trouvait moyen de me glisser quelque argent en cachette. C'était peu. Aux grands maux les grands remèdes: j'escomptai l'héritage paternel, je signai des lettres, sans échéance précise, et à des taux usuraires.
En vérité, disait Marcella, quand je lui apportais des soieries ou des bijoux, il faut que je me fâche. A-t-on jamais vu... un cadeau de cette valeur!...
Et s'il s'agissait d'un bijou, elle le contemplait entre ses doigts tout en proférant ces paroles; die l'examinait à la lumière, en essayait l'effet sur elle, et elle me couvrait de baisers impétueux et sincères. En dépit de ses protestations, la joie coulait dans ses regards, et je me sentais satisfait de la voir ainsi. Elle aimait particulièrement nos anciens doublons d'or, et je lui en apportais autant que j'en pouvais trouver. Marcella les enfermait tous dans un coffret de fer dont personne ne sut jamais où elle gardait la clef. Elle les cachait ainsi par crainte des esclaves. Sa maison des Cajueiros lui appartenait. Les meubles étaient bons et solides, en palissandre sculpté, et tout était à l'avenant, bibelots, miroirs, vases, vaisselle, une superbe vaisselle des Indes que lui avait donnée un conseiller à la Cour d'appel. Ah! vaisselle du diable, me portais-tu assez sur les nerfs!... Combien de fois ne l'ai-je pas dit à sa propriétaire. Je ne lui dissimulais pas l'écœurement que me causaient toutes ces reliques de ses amours d'antan. Elle m'écoutait en souriant, avec une expression de candeur,—de candeur et d'autre chose encore que je ne pouvais comprendre en ce temps-là. Mais maintenant, en me reportant en arrière, je songe que son rire offrait le singulier mélange d'un être qui serait issu d'une sorcière de Shakespeare et d'un ange de Klopstock. Je ne sais si je me fais bien comprendre. Dès qu'elle devinait mes inutiles et tardives jalousies, je crois qu'elle prenait plaisir à les exciter davantage. Par exemple, un jour que je n'avais pu lui offrir un certain collier trop cher pour ma bourse, et qu'elle avait vu à la devanture du bijoutier, elle me dit qu'elle avait voulu plaisanter, que son amour se passait fort bien de tels stimulants.
Et elle me menaça du doigt en disant:
—Jamais je ne te pardonnerais d'avoir de moi une aussi triste opinion.
Et voilà que, rapide comme un oiseau, elle bat des mains, m'en entoure le visage, m'attire à elle d'un geste gracieux, avec des minauderies d'enfant. Ensuite, étendue sur la chaise longue, elle continua sa profession de foi, avec simplicité et franchise. Son affection n'était pas à vendre. On pouvait bien en acheter les apparences. Quant à la réalité, elle la gardait pour un petit nombre. Duarte, par exemple, le sous-lieutenant Duarte, qu'elle avait aimé pour de vrai, deux ans auparavant, avait toutes les peines du monde à lui faire accepter un objet de valeur, tout comme moi; elle ne recevait de lui, sans réluctance, que de petits cadeaux modestes comme la croix d'or qu'il lui avait offerte le jour de sa fête.
—Cette croix...
Ce disant, elle porta la main à son corsage, en retira une fine croix d'or, pendue à son coupar un ruban bleu.
—Mais cette croix, lui fis-je observer, ne m'as-tu pas dit qu'elle te venait de ton père?
Marcella secoua la tête avec commisération.
—Tu n'as pas compris que c'était un mensonge... pour ne pas t'attrister. Allons, viens, chiquito, ne sois pas défiant comme cela. J'en ai aimé d'autres; et puis après, qu'importe, puisque c'est fini? Un jour quand nous nous quitterons...
—Ne dis pas cela, m'écriai-je.
—Tout passe! un jour...
Elle ne put achever; un sanglot étouffa sa voix. Elle étendit les mains, m'attira sur son sein, me murmura tout bas à l'oreille:
—Jamais, jamais, mon amour!...
Je la remerciai, les yeux humides. Le lendemain, je lui apportai le collier qu'elle avait refusé.
—Comme souvenir de moi, quand nous nous séparerons, lui dis-je.
D'abord elle se concentra dans un silence indigné. Ensuite, elle fit un geste magnifique. Elle essaya de jeter le collier par la fenêtre. Je retins son bras. Je la suppliai de ne pas me faire une telle offense, de garder le bijou. Elle m'obéit en souriant.
D'ailleurs elle me payait largement de mes sacrifices. Elle devinait mes plus secrets désirs; elle les prévenait tout naturellement, par une espèce de nécessité affective, par une fatalité de sa conscience. Jamais le désir n'était raisonnable; c'était pur caprice, simple enfantillage. Je la voulais vêtue d'une certaine manière, parée de telle et telle façon; j'exigeais qu'elle mît ce vêtement et non un autre, qu'elle vînt se promener. Il en était ainsi du reste. Elle consentait à tout, souriante et bavarde.
—Quel être extraordinaire lu fais! me disait-elle.
Et elle allait mettre la robe, la dentelle, les bijoux, avec une docilité charmante.
Il me vient à l'esprit une réflexion immorale qui est en même temps une correction de phrase. Je crois avoir, dit au chapitre XIV, que Marcella se mourait d'amour pour Xavier. Ce n'est pas mourir, c'est vivre, qu'il faut dire. Vivre n'est pas la même chose que mourir. Tous les joailliers du monde l'affirment, et ce sont des gens qui connaissent la grammaire. Bons bijoutiers, qu'en serait-il de l'amour sans vos jouets et vos amulettes, qui sont le tiers ou la cinquième partie de l'universel commerce des cœurs? Telle est la réflexion immorale que j'ai voulu faire, et qui est aussi obscure qu'immorale, car on ne comprend pas très bien ma pensée. J'ai voulu dire que la plus belle tête du monde n'en est pas moins belle quand on la ceint d'un diadème de perles fines; ni moins belle, ni moins aimée. Marcella par exemple, qui était vraiment bien jolie, Marcella m'aima...
...Marcella m'aima durant quinze mois et onze contos de reis; rien de plus, rien de moins. Mon père, dès qu'il eut vent des onze contos, prit la chose au tragique: il trouva que l'aventure dépassait de beaucoup les limites d'un simple caprice de jeune homme.
—Cette fois, dit-il, tu vas me faire le plaisir de filer en Europe pour suivre les cours d'une université, probablement celle de Coimbra. Je veux faire de toi un homme sérieux, et non un muscadin et un voleur. Voleur! oui, répéta-t-il en voyant mon geste de protestation; quel autre nom donner à un fils qui se conduit comme toi?...
Ce disant, il tira de sa poche mes divers billets qu'il avait rachetés, et me les mit sous le nez.
—Vois-tu, freluquet! Est-ce ainsi qu'on doit respecter l'honneur des siens? Crois-tu que moi et ceux qui m'ont précédé nous avons gagné notre fortune dans les tavernes ou à courir les rues? Libertin! cette fois tu prendras le droit chemin, ou je te déshérite.
Sa fureur était courte et pondérée. Je l'écoutai en silence, et je ne fis point, comme en d'autres circonstances précédentes, d'objections à l'ordre de départ. Je ruminais d'emmener Marcella avec moi. J'allai la trouver, je lui en fis la proposition. Marcella m'écouta, les yeux en l'air, sans répondre. Comme j'insistais, elle déclara qu'elle ne pouvait aller en Europe.
—Et pourquoi pas?
—Je ne puis, me dit-elle d'un air dolent, je ne puis aller respirer l'air de ces rivages, qui me rappellent la mémoire de mon pauvre père, victime de Napoléon...
—Lequel des deux: le jardinier ou l'avocat?
Marcella fronça le sourcil. Elle chantonna une séguedille, se plaignit de la chaleur, et demanda un verre de sirop. La femme de chambre l'apporta sur un plat d'argent qui faisait partie de de mes onze contos. Marcella m'offrit poliment le rafraîchissement. Pour toute réponse je fis sauter d'un revers de main le verre et le plateau. Elle reçut le liquide sur son corsage; la négresse hurla et je lui ordonnai de s'en aller au plus vite. Demeuré seul avec Marcella, je laissai déborder tout le désespoir de mon âme. Je lui dis qu'elle était un monstre, que jamais elle ne m'avait aimé, qu'elle m'avait laissé commettre des folies, sans même avoir l'excuse de la sincérité. Je l'accablai d'injures que j'accompagnais de gestes violents. Marcella demeurait assise, mâchonnant le bout de ses doigts, froide comme un morceau de marbre. J'avais envie de l'étrangler, de l'humilier tout au moins, en la subjuguant sous mes pieds. J'allais peut-être le faire, mais mon impétuosité changea de forme: ce fut moi qui me jetai à ses pieds, contrit et suppliant. Je la couvris de baisers, je lui rappelai les quinze mois de notre félicité, je lui répétai les tendres paroles des meilleurs jours, et je lui serrai les mains, assis sur le plancher, la tête entre ses genoux. Palpitant, égaré, je la suppliai, en pleurant, de ne point m'abandonner... Marcella me regarda pendant quelques instants quand j'eus fini de parler, puis elle m'écarta doucement, avec un geste d'ennui.
—Laisse-moi tranquille, me dit-elle.
Elle se leva, secoua ses vêtements encore tout mouillés, et se dirigea vers sa chambre.
—Non! m'écriai-je, tu n'entreras pas... je te le défends!... J'allais porter la main sur elle. Trop tard; elle était entrée et s'était enfermée à double tour.
Je sortis désespéré. Pendant deux mortelles heures, j'errai au hasard dans les quartiers excentriques et déserts, où j'étais certain de ne rencontrer aucune personne de connaissance. Je mâchonnais mon désespoir avec une avidité morbide. J'évoquais les heures, les jours, les instants de délire, et tantôt je me plaisais à les croire éternels, et à supposer qu'ils survivraient à mon cauchemar passager, tantôt, me mentant à moi-même, je les rejetais loin de moi comme un fardeau inutile. Alors j'aurais voulu m'embarquer tout de suite, couper ma vie en deux morceaux et je me délectais à l'idée que Marcella, avertie de mon départ, serait pénétrée de regrets et de remords. Je me persuadais que, m'ayant aimé follement, elle éprouverait quelque chose, une tristesse quelconque, comme lorsqu'elle pensait au sous-lieutenant Duarte. Cette réminiscence m'emplit alors de jalousie. La nature tout entière me criait qu'il fallait emmener Marcella avec moi.
—Il le faut... il le faut... disais-je en montrant le poing à l'espace.
Soudain une idée géniale... Ah! trapèze de mes péchés, trapèze des conceptions folles! mon idée se mit à y faire des cabrioles comme plus tard celle de l'emplâtre (chapitre II). Il fallait fasciner Marcella, l'éblouir, l'entraîner. Et je découvris un moyen beaucoup plus convaincant que les supplications. Je ne considérai point les conséquences possibles. Je fis de nouveaux billets: je me rendis rue dos Ourives, j'achetai le plus joli bijou en montre, trois diamants énormes, enchâssés dans un peigne d'ivoire; et je courus chez Marcella.
Elle était couchée sur un hamac, dans une attitude amollie, la jambe pendante, montrant le petit pied chaussé de soie, les cheveux épars, le regard tranquille et somnolent.
—Tu m'accompagnes, dis-je. J'ai trouvé de l'argent, beaucoup d'argent; tu auras tout ce que tu désireras. Tiens, prends.
Et je lui montrai le peigne avec ses diamants. Marcella tressaillit, dressa son buste, s'appuya sur le coude, et considéra le peigne pendant un instant très court. Puis elle détourna les regards. Elle s'était reprise. Alors je saisis ses cheveux, je les tordis, je les nouai à la hâte, j'improvisai une coiffure, et je couronnai mon œuvre du peigne aux diamants. Je reculai, je m'approchai de nouveau, retouchant les tresses, les abaissant ou les relevant, cherchant à établir quelque symétrie dans ce désordre. Et j'apportais à ces minuties une tendresse de mère.
—Voilà, dis-je enfin.
—Quel fou! s'écria-t-elle.
Ce fut sa première réponse. La seconde consista à m'attirer, à me payer de mon sacrifice par un baiser, le plus ardent de tous. Ensuite elle prit le peigne, en admira la matière et le travail, me regardant de temps à autre, en secouant la tête d'un air de reproche.
—A-t-on jamais vu!... disait-elle.
—Viendras-tu?
Elle réfléchit un instant. L'expression de ses regards ne me plut guère, qui allaient de moi au mur et du mur au bijou. Mais cette mauvaise impression se dissipa quand elle m'eut répondu résolument:
—J'irai. Quand pars-tu?
—D'ici deux ou trois jours.
C'est bon.
Je la remerciai à genoux. J'avais retrouvé ma Marcella des premiers jours. Je le lui dis. Elle sourit, et elle alla garder le bijou, tandis que je descendais l'escalier.
Sur le palier du rez-de-chaussée, au fond du corridor obscur, je m'arrêtai pendant quelques instants pour souffler, me palper, réunir mes idées éparses, me reprendre enfin, au milieu de tant de sensations profondes et contraires. Je sentais heureux. En vérité, les diamants doublaient un peu mon bonheur; mais quoi! une jolie femme peut bien aimer en même temps les Grecs et leurs présents. Enfin, j'avais confiée en ma bonne Marcella. Elle pouvait avoir ses défauts, mais elle m'aimait.
—Ange!... murmurais-je en regardant le toit du corridor.
Et voici que le regard de Marcella, qui un instant auparavant m'avait donné une impression de défiance, m'apparut comme pour se moquer de moi. Il brillait au-dessus d'un nez qui était à la fois celui de Bakbarah et le mien. Pauvre amoureux des Mille et une nuits! Je te vis courir derrière la femme du vizir, à travers la galerie. Elle te faisait signe comme pour s'offrir à toi, et tu courais, tu courais tout au long de l'allée, jusqu'au moment où tu sortis dans la rue et où tous les corroyeurs te huèrent et elles rossèrent d'importance. Et soudain il me sembla que le corridor était l'allée, et que la rue était celle de Bagdad. En effet, sur le pas de la porte, et sur le trottoir, je vis trois des corroyeurs, l'un en soutane, l'autre en livrée, le troisième en civil. Ils entrèrent dans le corridor, me prirent par le bras, me forcèrent à entrer dans une voiture. Mon père s'assit à ma droite, mon oncle le chanoine à ma gauche, l'individu en livrée monta sur le siège, et fouette cocher! jusqu'à la maison de l'intendant police, et de là jusqu'au port, d'où je fus transporté dans un voilier en partance pour Lisbonne. Figurez-vous ma résistance, d'ailleurs parfaitement inutile.
Trois jours après, je franchis la barre, abattu et muet. Je ne pleurais même pas. J'avais une idée fixe. Maudites idées fixes!... Celle-là me poussait à me précipiter dans la mer en répétant le nom de Marcella.
Nous étions en tout onze passagers: un fou qu'accompagnait sa femme, deux jeunes gens, qui voyageaient pour leur agrément, quatre commerçants et deux domestiques. Mon père me recommanda à tous, en commençant par le capitaine du navire, qui d'ailleurs avait fort à faire et qui, par surcroît, emmenait avec lui sa femme qui était phtisique au dernier degré.
J'ignore si le capitaine eut vent de mes funestes projets, ou si mon père le mit sur ses gardes; il avait constamment les yeux sur moi, il m'obligeait à rester près de lui, ou, quand il était obligé de me quitter, il me conduisait près de sa femme. Elle ne se levait point de sa chaise longue: et tout en toussant, elle me promettait de me montrer les alentours de Lisbonne. Elle n'était point seulement maigre, mais translucide; il était impossible d'elle ne mourût pas d'une heure à l'autre. Le capitaine, peut-être pour se leurrer lui-même, feignait de ne point croire au dénouement si proche.
Je ne savais rien; je ne pensais à rien. Que m'importait le sort d'une femme poitrinaire, au milieu de l'océan? L'univers, pour moi, c'était Marcella.
Au bout d'une semaine, je trouvai le moment propice pour mourir. C'était la nuit. Je montai doucement sur le pont. Mais j'y trouvai le capitaine qui, penché sur le bastingage, considérait l'horizon.
—Quelque grain qui s'annonce?... demandai-je.
—Non, me répondit-il en tressaillant; non. J'admire la splendeur de la nuit. Voyez... Quelle merveille!...
Le style démentait l'aspect assez fruste de l'individu, qui semblait étranger au style métaphorique. Au bout de quelques secondes, il me prit par la main, me montra la lune, et me demanda pourquoi je ne faisais point une ode à la nuit. Je lui répondis que je n'étais rien moins que poète. Il grommela je ne sais quoi, fit quelques pas, prit dans sa poche un morceau de papier tout chiffonné, et à la lumière d'un falot, il me lut une ode dans le goût de celles d'Horace, sur la liberté de la vie maritime. C'était des vers de sa façon.
—Qu'en dites-vous?
Je ne me rappelle plus ce que je lui répondis. Il me serra la main avec force remerciements. Ensuite, il me récita deux sonnets. Il allait m'en dire un autre, quand on vint l'appeler la part de sa femme.
—J'y vais, dit-il, et il me récita le troisième sonnet, lentement, avec componction.
Je demeurai seul. La muse du capitaine avait balayé de mon esprit les funestes pensées. Je préférai dormir, ce qui est une façon passagère de mourir. Le jour suivant, nous nous réveillâmes au bruit d'une tempête qui donna la chair de poule à tous les passagers, moins au fou. Il commença de danser, en criant que sa fille l'envoyait chercher dans une berline. C'était la mort de cette enfant qui avait causé sa folie. Jamais je n'oublierai l'horrible figure de ce pauvre homme au milieu du tumulte des gens et des hurlements de l'ouragan. Il chantait, il dansait, les yeux hors de la tête, très pâle, ses longs cheveux hérissés au vent. Il s'arrêtait de temps à autre, élevait ses mains osseuses, et formait avec les doigts des croix, des carrés, des anneaux, et riait ensuite désespérément. Sa femme l'abandonnait à lui-même; en proie à la terreur de la mort, elle se vouait à tous les saints du paradis. Enfin la tempête se calma, après avoir fait, je l'avoue, une excellente diversion à mes tristesses. Moi qui avais envie d'aller au-devant de la mort, je n'osai plus la regarder en face, quand elle se présenta.
Le capitaine me demanda si j'avais eu peur, si je m'étais senti en péril, si je n'avais pas trouvé le spectacle sublime, le tout en me montrant un véritable intérêt d'ami. Tout naturellement, nous en vînmes à parler de la vie de marin. Le capitaine me demanda si j'aimais les idylles piscatoires. Je lui répondis en toute ingénuité que j'ignorais ce qu'il voulait dire.
—Vous allez voir, me dit-il.
Et il me récita un petit poème, puis un autre, une églogue, puis cinq sonnets, par lesquels il termina, ce jour-là sa confidence littéraire. Le jour suivant, avant de me rien réciter, il me fit l'aveu des graves motifs qui l'avaient voué à la profession maritime, contre la volonté de sa grand'mère qui voulait qu'il fût prêtre. Il possédait assez bien, en effet, les lettres latines. Il n'entra point dans les ordres, mais il continua d'être poète, la poésie étant sa vocation naturelle. Pour m'en convaincre, il me récita tout au long et par cœur une centaine de vers. J'observai en lui un singulier phénomène: ses attitudes étaient si bizarres, qu'une fois je ne pus contenir mon envie de rire. Mais le capitaine, quand il récitait, regardait au dedans de lui-même, de telle sorte qu'il ne vit et n'entendit rien.
Les jours passaient, et les ondes, elles vers, et aussi la vie de la poitrinaire. Elle ne tenait qu'à un fil. Un jour, aussitôt après le déjeuner, le capitaine me dit que la malade ne passerait probablement pas la semaine.
—Vraiment! m'écriai-je.
—Cette nuit a été terrible.
J'allai lui rendre visite. Je la trouvai, en effet, moribonde, ou peu s'en fallait. Mais elle parlait toujours de notre arrivée à Lisbonne, où je resterais quelques jours avant d'aller à Coimbra, car elle comptait bien me conduire à l'Université. Je sortis consterné. Je trouvai son mari en contemplation devant les vagues qui venaient mourir sur la quille du navire, et j'essayai de le consoler. Il me remercia, me conta l'histoire de ses amours, fit l'éloge delà fidélité et du dévouement de sa femme, remémora les vers qu'il avait naguère composés à son intention, et me les récita. Sur ces entrefaites, on vint l'appeler sa part. Nous accourûmes: c'était une crise qu'elle traversait. Ce jour-là et le suivant furent cruels. Le troisième, elle entra en agonie et je m'éloignai de ce spectacle qui me répugnait. Une demi-heure plus tard, je rencontrai le capitaine assis sur un monceau de câbles, la tête entre les mains. Je lui présentai mes condoléances.
—Elle est morte comme une sainte, me répondit-il. Et pour que ces paroles ne pussent être mises sur le compte de l'attendrissement, il se leva aussitôt, secoua la tête, et fixa sur l'horizon un regard accompagné d'un geste long et profond.
—Nous allons, dit-il, la livrer à la tombe qui jamais ne se rouvre sur ce qu'elle a une fois englouti.
Peu d'heures après, le cadavre fut en effet lancé à la mer, avec les cérémonies accoutumées. La tristesse se lisait sur tous les visages. Le veuf conservait l'attitude d'un tronc d'arbre durement fendu par la foudre. Un grand silence... La vague ouvrit ses flancs, reçut la dépouille, se referma dans un remous suivi d'une légère ride, et le bateau continua son chemin... Je demeurai quelques instants à la poupe, les regards fixés sur ce point incertain de l'Océan, où était resté l'un de nous. Ensuite j'allai trouver le capitaine pour le distraire de sa solitude et de ses regrets.
Merci, me dit-il en devinant mon intention. Croyez bien que jamais je n'oublierai vos bons offices. Dieu vous en saura gré. Pauvre Léocadia, tu te souviendras de nous dans le ciel.
Il essuya sur sa manche une larme importune. Je cherchai un dérivatif dans la poésie, qui était sa passion. Je lui parlai des vers qu'il m'avait lus, je m'offris à les faire imprimer à mes frais. Ses yeux s'animèrent un peu.
—Peut-être accepterai-je votre offre, me dit-il. Mais j'hésite... c'est de si faible poésie.
Je jurai le contraire; je lui demandai de réunir les différentes pièces, et de me les donner avant notre débarquement.
—Pauvre Léocadia! murmura-t-il sans répondre à ma demande... la mer... le ciel... le navire...
Le jour suivant, il me lut un épicedion qu'il venait de composer, et où il avait consigné les circonstances de la mort et de la sépulture de sa femme. Il me le lut d'une voix émue, et sa main tremblait. Il me demanda ensuite si les vers étaient dignes du trésor qu'il avait perdu.
—Ils le sont, lui répondis-je.
—Il me manque le grand souffle lyrique, me dit-il au bout d'un instant. Mais personne ne me refusera la sensibilité, et c'est peut-être son excès qui nuit à la perfection.
—Je ne crois pas; je trouve vos vers parfaits.
—Oui, je crois que... enfin ce sont des vers de matelot.
—De matelot poète.
Il haussa les épaules, considéra le papier, et relut la pièce, mais cette fois sans tremblement dans la voix, en accentuant les intentions littéraires, en donnant du relief aux images et de la mélodie aux vers. Enfin il m'avoua que c'était son œuvre la plus achevée. J'abondai dans ce sens; il me serra la main, et me prédit grand avenir.
Un grand avenir! Tandis que ces paroles régnaient à mes oreilles, je promenais mes regards au loin, sur l'horizon mystérieux et vague. Une idée refoulait l'autre, l'ambition portait préjudice au souvenir de Marcella. Un grand avenir? Naturaliste, littérateur, archéologue, banquier, politique, évêque,—eh! oui, pourquoi pas évêque? l'important était que j'obtinsse une haute charge, une grande réputation, une position supérieure. L'ambition, cet aigle, sortit de l'œuf et ouvrit sa pupille fauve et pénétrante. Adieu, amours! adieu, Marcella! Jours de délire, bijoux hors de prix, vie déréglée, adieu! Je prends le chemin ardu de la gloire; je vous abandonne avec mes culottes d'enfant.
Et ce fut ainsi que je débarquai à Lisbonne, et que je partis pour Coimbra. L'Université m'attendait avec ses sciences arides; je fus un étudiant médiocre, ce qui ne m'empêcha point de devenir bachelier. Je reçus mon diplôme avec toute la solennité d'usage, quand j'eus terminé mon cours. Ce fut une belle fête qui me remplit d'orgueil et de regrets, de regrets surtout. J'avais acquis à Coimbra une grande réputation de bon vivant. J'étais un étudiant léger, superficiel, tumultueux et pétulant, aimant les aventures, faisant du romantisme pratique et du libéralisme théorique, vivant sur la foi des yeux noirs et des constitutions écrites. Le jour où l'Université m'attesta sur parchemin que j'étais un savant, moi qui n'ignorais pas les lacunes de mes connaissances, je me sentis en quelque façon déçu, sans rien perdre de mon orgueil pour cela. Et je m'explique. Le diplôme était un titre d'affranchissement. Mais s'il me donnait la liberté, il m'imposait aussi la responsabilité. Je gardai le titre, je laissai les charges sur les rives du Mondego, et je partis, quelque peu déçu, mais sentant déjà une curiosité impétueuse, un désir de jouer des coudes, de jouir, de vivre, de m'affirmer,—de prolonger l'Université, ma vie durant.
L'âne que je montais ayant refusé d'avancer, je m'avisai de le fustiger. Mal m'en prit: il fit deux sauts de mouton, puis trois autres, puis un dernier qui me fit voler de ma selle si malencontreusement que mon pied droit demeura pris dans l'étrier. Je tentai de m'accrocher au poitrail de l'animal. Mais alors, effrayé, il s'emballa à travers champs. Je m'exprime mal: il essaya de s'emballer, et effectivement il réussit à faire deux sauts en avant; mais le muletier, qui se trouvait présent, accourut à temps pour l'arrêter par la bride et le retenir, sans efforts ni péril. Quand il eut dominé la bête, je me dégageai de l'étrier et me relevai.
—Vous l'avez échappé belle, me dit le muletier.
Et c'était vrai. Si l'âne m'eût traîné sur le sol, il se peut bien que ma mort eût été la fin de l'aventure. Je pouvais avoir la tête fendue, une congestion, n'importe quelle lésion interne, et ma science se perdait ainsi dans sa fleur. Le Muletier m'avait sans doute sauvé la vie; c'était positif: je sentais le sang bouillir dans mes veines. Ah! brave muletier! Tandis que je reprenais conscience de moi-même, il s'efforçait de raccommoder les harnais de l'âne. Je résolus de lui donner trois des cinq monnaies d'or que j'avais sur moi. Certes j'estimais ma vie à plus haut prix;—elle avait pour moi une valeur inestimable. Mais enfin la récompense projetée me semblait digne du dévouement de celui qui m'avait sauvé. C'est dit: je vais lui donner les trois monnaies.
—Allons! me dit-il en me présentant la rêne de ma monture.
—Un instant... répondis-je; laissez-moi le temps de me remettre.
—Ne dites pas cela...
—Quand on vient comme moi de voir la mort de près...
—Si la bête s'était emportée avec vous, il est certain que... Mais avec l'aide du ciel, vous voyez qu'il ne vous est rien arrivé.
Je tirai de ma valise un vieux gilet dans la bourse duquel je gardais les cinq monnaies d'or. Mais ce faisant, je me demandai si la gratification n'était pas excessive, et si deux pièces ne seraient pas suffisantes. Pourquoi même deux? Une seule ferait sauter de joie le pauvre diable, dont j'examinais la tenue, et qui m'avait probablement jamais vu une pièce d'or de sa vie. Ma résolution prise, je tirai la pièce que je vis reluire au soleil. Le muletier ne l'aperçut point parce que je lui tournais le dos. Mais il se douta sans doute de quoi il s'agissait, car il commença à faire à l'âne des discours signicatifs. Il lui donnait de bons conseils, lui disant de se mieux comporter, sans quoi, «M. le Docteur» pourrait bien lui donner une raclée. C'était un monologue paternel. J'entendis même le bruit d'un baiser.
—Qu'est cela? dis-je.
—Que voulez-vous!... ce diable d'animal a une manière si gracieuse de regarder les gens.
Je souris, et après quelque hésitation, je lui glissai dans la main une cruzade d'argent. J'enfourchai ma monture, et je partis à large trot, un peu gêné, ou pour mieux dire, un peu incertain de l'effet qu'aurait produit ma pièce. Mais un peu plus loin, je retournai la tête, et je vis le muletier qui faisait de grandes courbettes, avec les marques les plus évidentes du contentement. Je me dis qu'il ne pouvait en être autrement, que je l'avais fort bien payé, trop bien payé même. Je glissai les doigts dans la poche du gilet que je portais sur moi, et j'y découvris quelques monnaies de cuivre. C'était les sous et non la pièce d'argent que j'aurais dû donner au muletier. Car après tout, il n'avait eu en vue aucune récompense. Ce n'était point la réflexion, mais une impulsion naturelle, innée ou inhérente au métier, qui l'avait fait agir. De plus, le fait de s'être trouvé justement sur le lieu du désastre, plutôt qu'en avant ou en arrière, semblait faire de lui un simple instrument de la Providence. De toutes les manières le mérite était nul. Je demeurai tout attristé de cette réflexion. Je me traitai de prodigue, je mis la cruzade sur le compte de mes anciennes prodigalités. Pourquoi ne le dirai-je pas?... j'éprouvai un remords.
Ah! maudit âne, tu as coupé le fil de mes réflexions. Je ne pourrai plus dire ce que je fis jusqu'à Lisbonne, ni à Lisbonne, ni dans la péninsule, ni dans le reste de la vieille Europe, qui, à cette époque, semblait rajeunir. Non, je ne dirai point l'aube du romantisme auquel j'assistai, moi qui allai même jusqu'à aligner des rimes au cœur de l'Italie. Sans quoi c'est un journal de voyage que je devrais écrire, et non des mémoires comme ceux-ci, où n'entre que la substance de la vie.
Au bout de quelques années de pérégrinations, je me rendis aux supplications de mon père: «Viens, me disait-il dans sa dernière lettre. Si tu ne te hâtes, tu ne retrouveras plus ta mère vivante...» Cette dernière phrase me fut cruelle. J'aimais ma mère. Je me rappelai ses dernières bénédictions à bord du navire: «Pauvre enfant! jamais plus je ne te reverrai.» Et la pauvre femme sanglotait en me serrant sur son cœur. Ses paroles résonnaient alors à mes oreilles comme une prophétie réalisée.
Notez bien que je me trouvais alors à Venise, où vibraient encore les vers de Byron. Je marchais en plein songe, revivant le passé, me croyant encore dans la Sérénissime République. Oui vraiment, je demandai une fois au gondolier si le doge irait se promener ce jour-là. «Quel doge, signor mio?» Je retombai en moi-même, mais je ne voulus pas avouer mon illusion. Je dis au brave homme que ma demande était une espèce de charade américaine. Il feignit de comprendre, et ajouta qu'il appréciait beaucoup les charades américaines. Eh bien! j'abandonnai tout: le gondolier, le doge, le pont des Soupirs, les vers du lord, les dames du Rialto, j'abandonnai tout, et je partis comme une balle dans la direction de Rio de Janeiro.
J'arrivai... Mais non; je ne veux point allonger ce chapitre. Quelquefois, je m'oublie à écrire, et la plume court sur le papier au grand préjudice de l'auteur. Des chapitres longs sont bons pour des lecteurs lourdauds. Nous ne sommes pas un public pour in-folio, mais seulement pour in-12: peu de texte, une large marge, des caractères élégants, dorures sur franches et des vignettes... principalement des vignettes. Non, n'allongeons point le chapitre.
J'arrivai, et je ne nie point qu'en apercevant la ville natale j'éprouvai une sensation inconnue, non pas devant ma patrie politique, mais devant le séjour de mon enfance, la rue, la tour, la fontaine publique, la femme en mantille, le noir manœuvre, les choses et les scènes de mon enfance, demeurées gravées dans ma mémoire. C'était une renaissance. L'esprit, comme un oiseau indifférent à la direction des années, prit son vol dans la direction de la fontaine originelle, et alla boire l'eau fraîche et pure, pure encore du limon de la vie.
Remarquez qu'il y a ici un lieu commun. Un autre lieu commun, c'est la consternation de ma famille. Mon père m'embrassa en pleurant: «Ta mère est condamnée», me dit-il. Ce n'était plus le rhumatisme qui la minait, mais un cancer à l'estomac. La malheureuse souffrait d'une façon cruelle, car le cancer est indifférent aux vertus de l'individu. Quand il peut ronger, il ronge, c'est son métier. Ma sœur Sabine, déjà mariée avec Cotrin, tombait de fatigue. Elle dormait à peine trois heures par nuit, la pauvre enfant. L'oncle Jean lui-même paraissait triste et abattu. Dona Eusebia et d'autres femmes assistaient aussi la malade, et se montraient non moins tristes et non moins dévouées!
—Mon fils!...
La douleur cessa pour un instant de tenailler sa victime. Un sourire illumina sa face, sur laquelle la mort étendait déjà son aile. Ce n'était déjà plus un visage. La beauté avait fui comme une aurore brillante. Il ne restait que les os, qui, eux, ne maigrissent pas. J'avais peine à la reconnaître, après huit ou neuf ans de séparation. Agenouillé au pied de son lit, ses mains entre les miennes, je demeurais immobile, sans oser prononcer une parole qui eût été un sanglot. Or, nous essayions de lui cacher son état et la proximité de sa fin. Elle ne s'illusionnait point cependant. Elle sentait venir la mort; elle me le dit, et son pressentiment se réalisa le lendemain matin.
L'agonie fut lente et cruelle: d'une cruauté minutieuse, froide, insistante, qui me remplit de douleur et de stupéfaction. C'était la première fois que je voyais mourir quelqu'un. Je connaissais la mort par ouï-dire; c'est tout au plus s'il m'était arrivé de la voir pétrifiée sur la face d'un cadavre que j'allais accompagner jusqu'au cimetière. La notion que j'en avais se trouvait confondue parmi des amplifications de rhétorique que m'avaient inculquées des professeurs de choses antiques: la mort traîtresse de César, austère de Socrate, orgueilleuse de Caton. Mais ce duel de l'être et du non-être, la mort en action, douloureuse, convulsée, sans appareil politique ou philosophique, la mort d'une personne aimée, c'était la première fois que j'y assistais. Je ne pleurai point; je me rappelle fort bien que je ne pleurai point durant toute cette scène. J'avais la gorge sèche, Inconscience béante, et mes regards demeuraient stupides. Eh quoi! une créature si docile, si tendre, si sainte, qui jamais ne fit verser une larme à personne; tendre mère, épouse immaculée, il fallait qu'elle mourût ainsi, torturée, mordue par la dent tenace d'une maladie sans pitié? Tout cela, je l'avoue, me semblait obscur, incongru; un non-sens.
Triste chapitre... Passons à un autre plus allègre.
Je demeurai prostré. Et cependant, j'étais à cette époque un ensemble de trivialité et de présomption. Jamais le problème de la vie et de la mort ne m'avait traversé le cerveau. Jamais jusqu'à ce jour je ne m'étais penché sur l'abîme de l'inexplicable. Il me manquait l'essentiel, c'est-à-dire le stimulant, le vertige.
Pour tout dire, je reflétais les opinions d'un barbier de Modène qui se distinguait justement parce qu'il n'en avait aucune. C'était la fleur des barbiers et des coiffeurs. Pour longue que fût une opération capillaire, jamais il ne se lassait. Il faisait aller les coups de peigne d'accord avec des plaisanteries pimentées et d'une saveur!... Il n'avait point d'autre philosophie; moi non plus. L'Université m'en avait bien inculqué quelques notions, mais je n'avais retenu que les formules, le vocabulaire, le squelette. Je traitais la philosophie comme le latin. J'avais dans la poche trois vers de Virgile, deux d'Horace, une douzaine de locutions morales et politiques pour les faux frais de la conversation. Il en était de même pour l'histoire de la jurisprudence. De tout, je sus prendre la phraséologie, l'ornementation et l'écorce.
Sans doute, le lecteur s'étonnera de la franchise avec laquelle j'expose et je mets ma médiocrité en évidence. Mais la franchise est la première qualité d'un défunt. Pendant la vie, l'opinion publique, le contraste des intérêts, la lutte des ambitions obligent à cacher les vilains dessous, à dissimuler les déchirures et les raccommodages, à ne point prendre le monde pour confident des révélations de la conscience; et le plus grand avantage de cette obligation c'est qu'il fait éviter l'horrible vice de l'hypocrisie, attendu qu'à force de leurrer les autres, on finit par se leurrer soi-même. Après la mort, quelle différence, quelle liberté, quel soulagement! On secoue le manteau somptueux; les oripeaux tombent; on se met à l'aise, on se dépeigne, on se dégrafe; on confesse franchement ce qui fut et ce qui ne fut pas. Il n'y a plus ni voisins, ni amis, ni ennemis, ni gens connus ou inconnus: il n'y a plus de public. Les considérations de l'opinion, son regard aigu et judiciaire, perd sa vertu dès que nous foulons le domaine de la mort. On peut bien encore nous critiquer et nous juger, mais le jugement nous laisse indifférents. Messieurs les vivants, il n'y a rien de plus incommensurable que le dédain des morts.
Mais ne voilà-t-il pas que j'allais glisser à l'emphase!... Soyons simple, comme l'était la vie Je menai à la Tijuca pendant les premières semaines qui suivirent la mort de ma mère.
Le septième jour, aussitôt après le service funèbre, je pris un fusil, quelques livres, des vêtements, des cigares, mon domestique mulâtre nommé Prudencio,—le Prudencio du chapitre XI,—et j'allai m'enterrer dans une vieille propriété que nous possédions. Mon père fit tout son possible pour me détourner de ma résolution; mais je sentais qu'il était au-dessus de forces de lui obéir. Sabine eût désiré que j'habitasse quelque temps avec elle: deux semaines pour le moins. Mon cousin voulait à toute force m'emmener. Un brave garçon, ce Cotrim: de prodigue, il était devenu circonspect. Il faisait alors le commerce des produits alimentaires, et travaillait avec ardeur du matin au soir, sans perdre un moment. Le soir, assis devant sa fenêtre, il caressait ses favoris sans penser à rien. Il aimait sa femme et son fils qui mourut quelques années plus tard. On le disait avare.
Je refusai toutes les propositions, tant je me sentais abattu. Ce fut alors, je crois, que commença à s'épanouir en moi la fleur jaune de l'hypocondrie, solitaire et morbide, d'un si subtil et si enivrant parfum. «Qu'il est bon d'être triste et de ne rien dire!» Quand je tombai sur cette phrase de Shakespeare, j'avoue qu'elle trouva en moi un écho délicieux. Je me rappelle que j'étais assis sous un dattier, le livre du poète ouvert sur mes genoux, l'esprit attristé plus encore que le visage. J'avais l'air d'une poule triste. Je serrais dans mon sein ma douleur taciturne, et j'éprouvais une sensation unique qu'on pourrait appeler la volupté de l'ennui. La volupté de l'ennui: retenez cette expression, lecteur, méditez-la, et si vous ne parvenez à la comprendre, c'est que vous ignorez une des sensations les plus subtiles de ce monde et de notre temps.
Je chassais de temps à autre, ou bien je dormais, ou bien je lisais; je lisais beaucoup. Parfois encore je restais à ne rien faire, passant d'une idée à une autre, laissant mon imagination vagabonder comme un papillon qui flâne ou qui a faim. Les heures tombaient, une à une, le soleil déclinait, les ombres de la nuit voilaient la montagne et la cité. Personne ne venait me rendre visite: j'avais expressément recommandé qu'on me laissât à moi-même. Un jour, deux jours, une semaine entière passa de la sorte. Cette quiétude devait être suffisante pour me lasser de la Tijuca, et me rendre à mon agitation habituelle. Au bout de sept jours, j'étais parfaitement saturé de solitude. Ma douleur s'apaisait. Mon fusil, mes livres, le spectacle des arbres et du ciel ne me suffisaient plus. La jeunesse bouillait en moi: je voulais vivre. Je fourrai dans ma malle le problème de la vie et de la mort, les hypocondries du poète, mes chemises, mes méditations, mes cravates, et j'allais la fermer, quand le mulâtre Prudencio me dit qu'une personne de ma connaissance demeurait depuis la veille dans la maison violette située à deux cents pas de la nôtre.
—Qui donc?
—Peut-être Monsieur ne se rappelle-t-il plus de Dona Eusebia...
—Je me rappelle... C'est elle?
—Elle et sa fille. Elles sont arrivées hier matin.
L'épisode de 1814 se présenta aussitôt à ma mémoire, et je me sentis embarrassé. Les événements m'avaient donné raison. Oui, vraiment, il avait été impossible d'éviter que les amours de Villaça et de la sœur du sergent-major n'allassent jusqu'aux dernières conséquences. Même avant mon départ, on parlait vaguement de la naissance d'une fille. Mon oncle Jean m'écrivait dans la suite que Villaça, en mourant, avait laissé un legs important à Dona Eusebia, et qu'on avait pas mal glosé à ce sujet dans le quartier. L'oncle Jean, friand de scandale, ne me parla que de cette aventure dans une de ses lettres, longue de plusieurs pages. Oui, les événements m'avaient donné raison. Quoi qu'il en pût être, 1814 était loin, et avait emporté ma gaminerie, Villaça et le baiser du massif. Du reste, il n'existait aucune intimité entre moi et Dona Eusebia. Cette réflexion faite, j'achevai de fermer ma malle.
—Monsieur n'ira pas rendre visite à Dona Eusebia? me demanda Prudencio. C'est elle qui a enseveli le corps de ma défunte maîtresse.
Je me rappelai l'avoir vue parmi d'autres dames, au moment de la mort et au moment de l'enterrement. J'ignorais d'ailleurs qu'elle eût rendu à ma mère ce suprême devoir. La remarque du mulâtre était juste. Je lui devais une visite. Je résolus de m'en acquitter immédiatement et je descendis aussitôt.
Soudain j'entends une voix: «Voyons, mon garçon! ce n'est pas une vie, ça!»
C'était mon père qui arrivait avec deux propositions dans sa poche.
Je m'assis sur ma malle, et je le reçus sans surprise. Il se tint pendant quelques instants debout devant moi, après quoi il me tendit la main d'un geste ému:
—Mon fils, il faut se résigner à la volonté divine.
—Je me suis déjà résigné, dis-je, et je lui baisai la main.
Je n'avais pas encore déjeuné; nous déjeunâmes ensemble. Ni l'un ni l'autre nous ne fîmes allusion au motif de ma réclusion. Une seule fois nous effleurâmes ce sujet, quand mon père fit tomber la conversation sur la Régence, et m'annonça qu'il avait reçu les condoléances de l'un des régents. Il avait la lettre sur lui; elle était même passablement chiffonnée, sans doute à force d'avoir été montrée à des tiers. Je crois avoir dit qu'il s'agissait de l'un des régents. Il me la lut deux fois de suite.
—Je suis déjà allé le remercier de cette preuve de considération, me dit-il, et mon opinion est que tu dois y aller aussi...
—Moi?
—Toi. C'est un homme considérable qui remplace aujourd'hui l'empereur. D'ailleurs, J'ai une idée, un projet, ou... il faut tout dire, deux projets: il s'agit d'un fauteuil de député et d'un mariage.
Mon père me dit tout cela avec quelque emphase, en donnant à ses paroles une certaine allure qui avait pour but de me les graver plus profondément dans l'esprit. La proposition combinait si mal avec mes sensations antérieures que tout d'abord je ne compris pas très bien. Mon père ne se découragea pas et répéta: «le fauteuil et la fiancée».
—Tu acceptes?
—Je n'entends rien à la politique, dis-je au bout d'un instant. Quant à la fiancée, laissez-moi vivre comme un ours que je suis.
—Mais les ours se marient, me répliqua-t-il.
—Eh bien! trouvez-moi une ourse: la grande Ourse, par exemple...
Mon père se mit à rire, et recommença à parler sérieusement. Je devais me lancer dans la politique pour plus de vingt raisons qu'il énuméra avec une singulière vélocité, en prenant des exemples parmi nos relations. Quant à la fiancée, il me suffirait de la voir. Aussitôt après l'avoir vue, j'irais de moi-même la demander à son père, sans plus larder. Il essaya ainsi d'abord de la fascination, ensuite de la persuasion, ensuite de l'intimidation. Je ne répondais pas, je taillais la pointe d'un cure-dent, je faisais des boulettes de pain, souriant ou réfléchissant. Je n'étais, pour tout dire, ni rebelle ni docile à la proposition. Je me sentais abasourdi. Une partie de moi-même disait oui: une belle femme, une position politique n'étaient pas choses à dédaigner. L'autre partie disait que non; la mort de ma mère m'apparaissait comme un exemple de la fragilité des affections de famille...
—Je ne sors point d'ici sans une réponse définitive, me dit mon père, dé-fi-ni-ti-ve! répéta-t-il en scandant les syllabes avec le doigt.
Il but une dernière gorgée de café, se mit à son aise, et commença à parler de tout: du Sénat, de la Régence, de la Restauration, d'Evariste, d'une voiture qu'il avait l'intention d'acheter, de notre maison de la rue Matta-Cavallos... Je restais au bout de la table, et j'écrivais distraitement sur un morceau de papier avec la pointe d'un crayon; je traçais une parole, une phrase, un vers, un nez, un triangle et je réfutais les mots suivants sans ordre, au hasard, de la façon suivante:
Arma virumque cano
A
Arma virumque cano
Arma virumque
Arma virumque cano
Arma virumque cano
virumque
Tout cela était fait machinalement, et cependant avec une certaine logique et une certain déduction. Par exemple ce fut virumque qui me fit passer au nom du propre poète, par l'entraînement de la première syllabe; j'allais écrire virumque, ce fut Virgile qui tomba de ma plume et je continuai:
Vir Virgile
Virgilie Virgile
Virgile
Virgile
Mon père, quelque peu dépité de mon indifférence, se leva, vint à moi, et lança un regard sur le papier.
—Virgile! s'écria-t-il. Tu y es, mon garçon, ta fiancée s'appelle justement Virgilia.
Virgilia? mais alors, c'est la même personne qui, quelques années plus tard...? la même, oui la même, qui, en 1869, devait assister à mes derniers moments, et qui longtemps auparavant eut une si large part dans mes plus intimes sensations. À cette époque, elle comptait a peine quinze ou seize ans. C'était peut-être la plus audacieuse créature de notre race et c'en était en tous cas la plus volontaire. Je ne dirai pas qu'elle méritait la pomme de la beauté entre toutes les jeunes filles de son temps, parce que je n'écris pas un roman où l'auteur dore la réalité et ferme les yeux aux taches de rousseur et autres: ce qui ne veut pas dire qu'elle en eût au visage, non. Elle était jolie, fraîche, elle sortait des mains de la nature, pleine de ce charme précaire et éternel qu'un individu transmet à un autre pour les fins secrètes de la procréation. Telle était Virgilia avec son teint clair, très clair, sa grâce ignorante et puérile, sujette aux mystérieuses impulsions, sa paresse et sa dévotion,—sa dévotion qui n'était peut-être que de la peur, comme j'ai tout lieu de le supposer.
Voici, lecteur, en peu de lignes, le portrait physique et moral de la personne qui devait avoir plus tard une si grande influence sur ma vie. Oui, elle était cela même, à seize ans. Si tu lis ces lignes, ô Virgilia toujours aimée, ne t'étonne point du langage que j'emploie aujourd'hui, qui contraste avec celui que j'employai quand je te connus. Tu peux croire que l'un était alors aussi sincère que l'autre l'est maintenant. La mort a pu me rendre grincheux, mais non injuste.
—Mais, me diras-tu, comment peux-tu ainsi discerner la vérité de ce temps lointain, et l'exprimer ainsi après tant d'années?
—Ah! indiscrète, ah! ignorante, mais c'est cela même qui nous rend maîtres de l'univers; c'est ce pouvoir de refaire le passé, pour bien comprendre l'instabilité de nos impressions et la vanité de nos affections. Laisse dire Pascal: l'homme n'est pas un roseau pensant, c'est une page d'errata qui pense: cela, oui. Chaque saison de la vie est une édition qui corrige l'édition antérieure, et qui sera corrigée à son tour, jusqu'à l'édition définitive, dont l'éditeur fait présent aux vers.
—Virgilia, interrompis-je.
—Oui, Monsieur, tel est le nom de votre fiancée. Un ange, mon grand dadet, un ange moins les ailes. Figure-toi une jeune fille comme ça, de cette hauteur, vive comme du vif-argent et des yeux... c'est la fille de Dutra...
—Dutra?
—Le conseiller Dutra, voyons. C'est une influence politique. Allons tu acceptes?
—Non, répondis-je. Après quoi, je regardai pendant quelques secondes la pointe de mes bottines; et je déclarai que j'étais prêt à étudier les deux questions, la candidature et le mariage pourvu que...
—Pourvu que?
—Pourvu que je ne sois point obligé de les accepter conjointement. Je crois que je puis être séparément un homme marié et un homme politique...
—Tout homme qui entre dans la vie publique doit être marié, interrompit sentencieusement mon père. Mais il en sera comme il te plaira. Je me prête à tout, persuadé qu'il te sera suffisant de voir Virgilia. D'ailleurs, le Parlement et la fiancée, c'est tout un. Tu protestes... tu verras plus tard. C'est bon, j'accepte l'atermoiement, pourvu que...
—Pourvu que? interrompis-je à mon tour en imitant sa voix.
—Ah! farceur! pourvu que tu ne restes pas ici, futile, obscur et désespéré. Mon argent, mes soins, je ne les ai dépensés que pour te voir briller comme il convient, à moi, à toi, et à nous tous. Tu dois continuer à illustrer notre nom que tu perpétues. Écoute, j'ai soixante ans, mais s'il était nécessaire que je recommence ma vie, je le ferais sans hésiter une minute. Crains l'obscurité, Braz, fuis ce qui est infime. Les hommes valent de différentes façons, mais le plus sûr moyen de s'affirmer est l'opinion des autres hommes. Ne perds point les avantages de ta position, ni tes moyens...
Et le magicien continua d'agiter devant moi le hochet, comme on faisait lorsque j'étais petit pour me faire aller plus vite. La fleur de l'hypocondrie se referma, laissant s'ouvrir une autre fleur moins jaune, et qui n'a rien de morbide—l'amour de la renommée, l'emplâtre Braz Cubas.
Mon père était arrivé à ses fins. Je me disposai à accepter le fauteuil et le mariage, Virgilia et la Chambre des députés:—les deux Virgilia, comme le dit mon père, dans un accès de tendresse politique. Et pour me payer de ma docilité, il me serra fortement dans ses bras. C'était son propre sang qu'il reconnaissait enfin.
—Tu descends avec moi?
—Non, je descendrai demain. Aujourd'hui, je prétends faire une visite à Dona Eusebia.
Mon père fit la grimace, mais ne répondit rien. Il prit congé de moi et partit. Dans l'après-midi, je me rendis chez Dona Eusebia. Elle avait maille à partir avec son jardinier noir, mais elle quitta tout pour venir me recevoir, avec une hâte, un plaisir si sincère que je me sentis tout de suite à mon aise. Je crois bien qu'elle alla jusqu'à me serrer entre ses bras robustes. Elle me fit asseoir auprès d'elle, sous la véranda, en multipliant ses exclamations.
—Comment, c'est le petit Braz! mais c'est un homme, maintenant... Tout à fait!... et joli garçon!... Et vous, vous rappelez-vous bien de moi?
—Comment donc!...
Était-il possible que j'eusse oublié une amie si intime de notre maison. Dona Eusebia commença à parler de ma mère avec tant de sympathie et de regrets, qu'elle me captiva tout de suite, bien qu'elle ravivât ma douleur... Elle lut mon émotion dans mes yeux, et détourna la conversation. Elle me demanda de lui conter mes voyages, mes travaux, mes amourettes... les amourettes aussi; «je suis une vieille curieuse, je le confesse, et je suis restée bon vivant». En ce moment, je me rappelai l'épisode de 1814, elle, Villaça, le buisson, le baiser, et mon cri d'alarme. Et voici qu'une porte crie sur ses gonds, j'entends un frou-frou de jupes, et cette parole:
—Maman... maman...
Les jupes et la voix appartenaient à une jeune brunette qui s'arrêta sur le pas de la porte pendant quelques instants, en apercevant un étranger. Dona Eusebia mit fin à ce court silence et à cet embarras, avec sa franchise résolue.
—Viens ici, Eugenia, dit-elle, viens faire connaissance avec le Dr Braz Cubas, fils de Cubas, et qui arrive d'Europe.
Et se tournant vers moi:
—Ma fille Eugénie.
Eugénie, la fleur du buisson, répondit à peine au salut que je lui adressai. Elle me regarda avec éprise et timidité, et lentement s'approcha la chaise de sa mère. Celle-ci remit en ordre les tresses de la jeune fille, tout en disant: «Ah! petite endiablée.» Et elle l'embrassa avec une tendresse si expansive que je me sentis quelque peu ému. Je me souvins de ma mère, et, je le confesse, je me sentis quelques velléités d'être père.
—Petite endiablée? dis-je. Il me semble que mademoiselle est déjà une grande jeune fille.
—Quel âge lui donnez-vous?
—Dix-sept ans.
—Moins un.
—Seize ans: à cet âge, on est une jeune fille.
Eugenia ne put dissimuler la satisfaction que lui produisirent mes paroles. Mais elle reprit aussitôt son attitude froide, rigide et muette. Elle paraissait en réalité plus femme que son âge. Mais son impassibilité, son attitude digne, lui donnaient l'air d'une femme mariée. Peut-être perdait-elle ainsi un peu de son charme virginal. La glace fut bientôt rompue entre nous. Sa mère faisait d'elle les plus grands éloges; j'écoutais de bonne grâce, et elle souriait. Ses yeux brillaient comme si dans son cerveau un papillon eût étendu ses ailes d'or au-dessus de la multitude des yeux de diamants en couronne.
Je dis dans son cerveau, parce que, au dehors, ien de morbide—l'amour de la renommée, l'emplâtre Braz Cubas.
—Je t'adjure... va-t'en, malin! Vierge, Notre-Dame!...
—Calmez-vous, dis-je, et prenant mon mouchoir, je chassai le papillon.
Dona Eusebia s'assit une autre fois, suffoquée, un peu honteuse. Sa fille, toute pâle de peur, dissimulait son émotion avec beaucoup de force de volonté. Je leur serrai la main et je sortis, riant d'un rire philosophique, désintéressé et supérieur, de la superstition des deux femmes. Le soir, je vis passer à cheval la fille de Dona Eusebia, accompagnée d'un valet de chambre. Elle me salua du bout de sa cravache. Je m'attendais à ce que, un peu plus loin, elle retournât la tête. Mais elle ne la retourna point, et j'en fus quelque peu vexé.
Le jour suivant, tandis que je faisais mes apprêts de départ, un papillon, noir comme celui de la veille, entra dans ma chambre. Il était de dimensions bien supérieures à l'autre. Le souvenir de celui-ci me fit sourire, et je me mis à penser à la peur qu'avait eue la fille de Dona Eusebia, et à la dignité de maintien qu'elle avait su conserver. Le papillon, après avoir décrit ses courbes autour de moi, se posa sur ma tête. Je l'effrayai, et il se réfugia sur la vitre. Je le forçai de nouveau à prendre son vol, et cette fois, il alla se percher sur un vieux portrait de mon père. La bestiole était noire comme la nuit, et la façon dont elle commença de remuer les ailes me parut ironique et me porta sur les nerfs. Je tournai le dos, et je sortis de la chambre. Mais en y rentrant, quelques minutes plus tard, je trouvai l'insecte à la même place, et dans un mouvement de mauvaise humeur, je pris une serviette, je l'en frappai, et il tomba.
Il n'était pas mort tout à fait; il tordait son corps et secouait ses antennes. J'en eus pitié et, l'ayant pris dans ma main, j'allai le déposer sur le bord de la croisée. Mais le sort en était jeté; la pauvre bête ne dura que quelques secondes, et je me sentis ennuyé et repentant.
—Aussi, pourquoi n'était-il pas bleu? me dis-je.
Et cette réflexion, l'une des plus profondes qui aient été faites depuis l'invention des papillons, me consola de ma méchante action, et me réconcilia avec moi-même. Je contemplai le cadavre avec quelque sympathie, je l'avoue. Je vis, en pensée, le papillon sortir du bois, content et repu; la matinée était belle, et il était venu jusque chez moi, papillonnant sous la vaste coupole du ciel bleu, toujours bleu, pour toutes les ailes. Ma fenêtre est ouverte, il entre et me trouve. Je suppose qu'il n'a jamais vu d'hommes. Il ignore ce que c'est et, décrivant des circuits autour de mon corps, il voit que j'ai des yeux, des bras, des jambes, que mes mouvements ont un air divin, que je suis d'une stature colossale. Alors il se dit en lui-même: «Ce monsieur est sans doute l'inventeur des papillons.» Cette idée le domine et l'épouvante. Mais la peur, qui est suggestive, lui insinue que le meilleur moyen de plaire à son créateur est de le baiser sur le front, et il s'exécute. Quand je le chasse, il va sur la vitre, aperçoit de là le portrait de mon père, et il n'est pas impossible qu'il devine cette demi-vérité, à savoir que c'est là le père de l'inventeur des papillons. Et il vole vers lui pour lui demander miséricorde.
Et voilà qu'un coup de serviette sert de dénouement à l'aventure. Ni l'immensité l'azur, ni l'allégresse des fleurs, ni la pompe des feuilles vertes, n'ont tenu contre une serviette de toilette, deux palmes de fil écru. Voyez comme il est bon d'être supérieur aux papillons. Car s'il eût été bleu ou couleur d'orange, sa vie n'eût guère été plus en sûreté. Non certes. J'aurais fort bien pu le piquer d'une épingle, pour le régal de mes yeux. Cette dernière pensée me rendit la tranquillité de ma conscience. Je réunis le médium et le pouce et j'envoyai, d'une chiquenaude, le cadavre dans le jardin. Il était temps: les fourmis prévoyantes s'avançaient déjà... Tout de même, j'en reviens à ma première idée: il eût mieux valu pour lui être né bleu.
J'allai ensuite terminer mes préparatifs de voyage. Cette fois je pars, je pars décidément, même si quelque lecteur me demande si mon dernier chapitre est une gageure ou une façon de me moquer du monde... Mais j'ai compté sans Dona Eusebia. J'étais déjà prêt quand elle entra chez moi. Elle venait me prier de différer mon départ, et d'aller ce jour-là dîner avec elle. Je refusai d'abord; mais elle insista tellement que je cédai. Je lui devais bien d'ailleurs cette satisfaction.
Ce jour-là, Eugenia se mit en négligé, à mon intention. C'est-à-dire, je le suppose, car peut-être se mettait-elle souvent ainsi. Plus de boucles d'or, comme la veille, à ses oreilles, deux oreilles finement dessinées sur une tête de nymphe. Un simple vêtement blanc en batiste, sans enjolivures. Au cou, au lieu de broche, un bouton d'écaille, d'autres identiques aux poignets pour fermer les manches, et pas l'ombre d'un bracelet.
Telle elle était mise, et tel me parut aussi son esprit: des idées claires, des manières simples, une certaine grâce naturelle, l'air d'une dame, et un je ne sais quoi... oui, c'est cela: la bouche, exactement la bouche de sa mère, qui me rappelait l'épisode de 1814, et il me venait alors l'envie de chanter avec la fille la même chanson.
—Maintenant je vais vous montrer le jardin, me dit la mère dès que nous eûmes vidé nos tasses de café.
Nous sortîmes en passant par la véranda, et je m'aperçus alors qu'Eugenia boitait un peu: si peu que je lui demandai si elle s'était fait mal au pied. La mère se tut. La fille me répondit sans hésitation:
—Non, monsieur, je suis boiteuse de naissance.
Je me donnai à tous les diables; je me traitai de maladroit et de grossier. En effet, le simple fait de la voir boiter aurait dû être suffisant pour que je ne lui posasse aucune question. Je me rappelai alors que la première fois que je l'avais vue, la veille, elle s'était approchée lentement du fauteuil de sa mère, et que ce jour-là je l'avais trouvée, en arrivant, déjà près de la table, dans la salle à manger. Peut-être était-ce pour cacher ce défaut. Mais alors, pourquoi l'avouait-elle maintenant? Je la regardai, et je vis qu'elle était triste.
J'essayai de détruire le mauvais effet produit. Ce ne me fut pas difficile; sa mère qui était, comme elle le disait elle-même, une vieille curieuse, se mit à causer. Nous parcourûmes toute la propriété, admirant les fleurs, la mare aux canards, le lavoir, un tas de choses qu'elle me montrait, en faisant ses commentaires, tandis que je contemplais, à la dérobée, les yeux d'Eugenia.
Parole d'honneur, son regard n'était rien moins que boiteux: il était au contraire droit et parfaitement sain. Il partait de deux yeux noirs et tranquilles. Je crois me rappeler que ceux-ci se baissèrent deux ou trois fois, un peu confus, mais deux ou trois fois seulement. En général, ils me fixaient avec franchise, sans audace, ni pruderie.
Le malheur, c'est qu'elle était boiteuse. Des yeux si lucides, une bouche si fraîche, un maintien si imposant, et boiteuse! Ce contraste était un exemple évident des ironies de la nature. Pourquoi était-elle jolie, étant boiteuse? pourquoi était-elle boiteuse, étant jolie? Telle était la question que je me posais à moi-même, sans y trouver une solution satisfaisante, tandis que je rentrais chez moi cette nuit-là. Ce qu'il y a de mieux à faire, quand on ne trouve pas le mot d'une énigme, c'est de la flanquer par la fenêtre; et c'est ce que je fis. Je pris une serviette, et je chassai cet autre papillon, qui faisait ses randonnées dans mon cerveau. Je me sentis plus à mon aise, et j'allai dormir. Mais le rêve, qui est une lézarde de l'esprit, laissa de nouveau pénétrer l'insecte et, pendant toute la nuit, je continuai à chercher la clef du mystère.
Le jour se leva avec la pluie, et je transférai mon départ. Mais le lendemain le ciel était pur, et je n'en restai pas moins, de même que le troisième et le quatrième jour, et jusqu'à la fin de la semaine! Quelles belles matinées, fraîches et tentatrices. Là-bas, ma famille, ma fiancée et le Parlement m'attendaient; et je faisais le sourd, soupirant aux pieds de ma Vénus boiteuse. Soupirant est peut-être exagéré: je n'étais point épris; j'éprouvais auprès d'elle une certaine satisfaction physique et morale. Elle me plaisait: je l'aimais bien. Aux pieds de cette créature si simple, fille bâtarde et boiteuse, faite d'amour et de mépris, je me sentais à mon aise, et je crois qu'elle éprouvait une satisfaction plus grande encore près de moi. Cela se passait à la Tijuca: une véritable églogue. Dona Eusebia nous surveillait, si peu: juste assez pour sauvegarder les convenances. Et sa fille, dans cette première explosion de la nature, me livrait son âme en fleur.
—Vous allez partir demain? me demanda-t-elle, le samedi.
—C'est tout au moins mon intention.
—Ne partez pas.
J'obéis, et j'ajoutai ainsi un verset nouveau à l'Évangile: «Bienheureux ceux qui savent rester, car ils auront le premier baiser des jeunes filles.» Ce fut, en effet, le dimanche que je reçus le premier baiser d'Eugenia, celui qu'aucun homme ne put recevoir d'elle désormais. Il ne fut point volé, ni pris de force, il fut candidement octroyé, comme une dette payée par un débiteur honnête. Pauvre Eugenia, si tu avais pu savoir quelles pensées me passaient par la tête en ce moment. Toute tremblante d'émotion, les mains sur mes épaules, tu contemplais en moi l'époux bienvenu, tandis que je revoyais en pensée Villaça et le buisson de 1814, en me disant que tu ne pouvais mentir à ton sang et à ton origine...
Dona Eusebia entra inopinément, mais pas assez vite pour nous surprendre. J'allai à la fenêtre; Eugenia s'assit et refit ses nattes. Quelle gracieuse dissimulation! Quel art infiniment délicat! quelle profonde tartuferie! Tout cela si naturellement fait, avec tant d'à-propos, si simplement, comme on mange, comme on dort. Tant mieux! Dona Eusebia n'eut vent de rien.
Y a-t-il, parmi les cinq ou dix personnes qui me lisent, une âme sensible, qui mise en émoi par le chapitre précédent, commence à craindre pour le sort d'Eugenia, et peut-être, oui, peut-être dans le fond de son cœur me traite de cynique? Moi cynique, âme sensible? Par la cuisse de Diane, cette injure mériterait d'être lavée dans le sang, si le sang pouvait laver quoi que ce soit dans ce bas monde. Non, âme sensible, je ne suis point cynique, mais je fus homme. Mon cerveau était le tréteau où furent représentées des pièces de tout genre, le drame sacré, le drame austère, des comédies, des autos-da-fés, des bouffonneries, un pandémonium, âme sensible, un mélange d'aventures et de personnes où tu retrouverais depuis la rose de Smyrne et la rue du Jardin, depuis le lit somptueux de Cléopâtre jusqu'au coin de la place où le mendiant grelotte en dormant. Des pensées de toutes les castes et de tous les genres s'y croisaient. Dans la même atmosphère respiraient l'aigle et l'oiseau-mouche, la limace et le crapaud. Retire donc l'expression, âme sensible, apaise tes nerfs, nettoie tes besicles,—c'est parfois la faute des besicles,—et finissons-en d'une fois avec cette fleur du buisson.
Or il arriva que, huit jours plus tard, comme je me trouvais sur le chemin de Damas, j'entendis une voix mystérieuse qui me murmura les paroles de l'Écriture (Act., IX, 7): «Lève-toi, et entre dans la cité.» Cette voix sortait de moi-même, et avait une origine double: la pitié qui me désarmait devant la candeur de la petite, et la terreur de l'aimer pour de vrai, et de l'épouser une femme boiteuse! Quant au motif de mon départ, elle le devina, et ne se gêna pas pour me le dire. Ce fut sous la véranda, un lundi soir, quand je lui annonçai que je descendis le lendemain. «Adieu, me dit-elle avec simplicité, vous avez raison.» Et comme je me taisais, elle continua: «Vous avez raison de fuir le ridicule d'un mariage avec moi.» J'allais protester, elle se retira lentement en dévorant ses larmes. Je la rejoignis en jurant mes grands dieux que j'étais obligé de partir, et que je continuais à avoir beaucoup d'affection pour elle. Elle écouta mes froides hyperboles en silence.
—Me crois-tu? lui dis-je enfin.
—Non, et je trouve que vous faites bien.
Je voulus la retenir, mais elle me lança un regard qui n'était déjà plus de supplication, mais de commandement.
Je descendis, le jour suivant, de la montagne, un peu contristée et pas très satisfait de moi-même. Je me disais, chemin faisant, qu'il était juste d'obéir à mon père, qu'il était convenable d'embrasser la carrière politique..., que la constitution..., que ma fiancée..., que mon cheval...
Mon père, qui ne m'attendait pas, m'embrassa avec tendresse et effusion:
—Maintenant, c'est pour de vrai, me dit-il. Je puis enfin...
Nous restâmes sur cette réticence, et j'allai retirer mes bottes qui étaient trop justes. Je me sentis soulagé, je respirai à mon aise, et je me couchai sur mon lit tout de mon long, tandis que mes pieds et tout ce qu'il y avait au-dessus entraient dans une béatitude relative. J'observai alors que des souliers serrés sont un des plus grands avantages terrestres, parce que, en faisant mal aux pieds, ils procurent le plaisir de les déchausser. Ils font souffrir d'abord, ils sont l'origine d'un soulagement, ensuite, et voilà un bonheur à bon marché, au goût des savetiers et d'Épicure. Tandis que cette idée faisait des voltiges sur mon fameux trapèze, je regardais dans le lointain la silhouette de la Tijuca, et j'aperçus la petite boiteuse qui se perdait à l'horizon du prétérit. Je sentis soudain que mon cœur ne tarderait pas à déchausser ses bottes lui aussi. Quatre ou cinq jours plus tard, le sybarite savourait ce rapide, cet ineffable et incoercible moment de joie qui succède à une douleur poignante, à une préoccupation, à un ennui... J'en inférai que la vie est le plus curieux des phénomènes, attendu qu'elle n'aiguise la faim que pour procurer l'occasion de manger, et qu'elle n'a inventé les cors que parce qu'ils perfectionnent la félicité terrestre. Je vous le dis en vérité, toute la science humaine ne vaut pas une paire de bottes trop étroites.
Toi, ma pauvre Eugénie, tu n'as jamais déchaussé les tiennes. Tu t'en es allée sur le chemin de la vie, boiteuse de jambe et boiteuse d'amour, triste comme un enterrement pauvre, solitaire, silencieuse, laborieuse, jusqu'au jour où tu passas sur l'autre bord. Ce que j'ignore, c'est si ton existence était bien nécessaire au siècle. Qui sait! Peut-être un comparse de moins eût-il fait siffler la tragédie humaine.
Enfin nous arrivons à Virgilia! Avant d'aller chez le conseiller Dutra, je demandai à mon père s'il y avait déjà quelque promesse de mariage, quelque arrangement préalable.
—Aucun, me répondit-il. Il y a quelque temps, comme nous parlions de toi, je lui ai avoué mon désir de te voir député. Je lui ai parlé avec tant d'éloquence, qu'il m'a promis de faire quelque chose pour toi, et je crois qu'il tiendra sa promesse. Quant au mot «fiancée», c'est le nom que je donne à une créature qui est un vivant bijou, une étoile, une chose rare... sa fille à lui. D'ailleurs, je pense que si tu l'épouses, tu seras bien plus vite député.
—C'est tout?
—C'est tout.
Nous allâmes jusque chez Dutra. C'était une perle que cet homme, jovial, bon patriote, un peu irrité contre les malheurs du temps, mais ne désespérant pas d'en venir à bout. Il trouva ma candidature légitime; il convenait pourtant d'attendre quelques mois. Et tout de suite il me présenta à sa femme, une estimable matrone, à sa fille, qui ne démentit pas le panégyrique que mon père avait fait d'elle, je vous le jure. Relisez, d'ailleurs, le chapitre XXVII. Je la regardai comme quelqu'un qui a des idées préconçues. Je ne sais si elle en avait de son côté; elle ne me contempla point différemment. Notre premier regard fut tout simplement conjugal. Au bout d'un mois, nous étions au mieux.
—Venez donc demain dîner avec nous, me dit Dutra un certain soir.
J'acceptai l'invitation. Le lendemain, je dis au cocher de m'attendre place San-Francisco avec le cabriolet, et j'allai faire un tour en ville. Vous rappelez-vous encore ma théorie des éditions humaines? Eh bien! j'en étais alors à la quatrième édition, déjà revue et augmentée, mais encore remplie de négligences et de coquilles. Ces défauts étaient rachetés par l'élégance des caractères et le luxe de la reliure. Au bout d'un moment, comme je passais rue des Ourives, je voulus consulter ma montre, et le verre tomba sur le pavé. J'entre dans la première boutique que je trouve. C'était un taudis ou guère mieux, obscur et poussiéreux.
Au fond, derrière le comptoir, se trouvait assise une femme, dont le visage jaune et crevassé de petite vérole n'appelait pas tout d'abord l'attention. Mais sitôt qu'on l'observait, elle offrait un spectacle curieux. Elle ne pouvait avoir été laide; au contraire, on voyait tout de suite qu'elle avait dû être jolie, et même fort jolie. Mais la maladie et une vieillesse précoce lui avaient enlevé tous ses charmes. Elle était horriblement grêlée. Les traces des boutons formaient des hauts et des bas, des creux et des reliefs, et donnaient l'impression d'une peau de chagrin extrêmement rugueuse. Les yeux conservaient quelque beauté, mais l'expression en était étrange et désagréable, qui s'adoucit pourtant dès que je commençai à parler. Quant aux cheveux, ils étaient roux et presque aussi poussiéreux que les portes de la boutique. À l'un des doigts de la main gauche, un diamant étincelait. Le croira-t-on dans la postérité? cette femme, c'était Marcella.
Je ne la reconnus point tout d'abord. Mais elle me remit aussitôt que je lui adressai la parole. Ses yeux brillèrent, et l'expression habituelle fit place à une autre, plus douce et mélancolique. Elle fit un mouvement comme pour se cacher ou s'enfuir. C'était l'instinct de la vanité, qui ne dura qu'un moment. Elle se remit.
—Il vous faut quelque chose? me dit-elle me tendant la main.
—Non, répondis-je, rien.
Marcella comprit la cause de mon silence. Il ne fallait pas être sorcier. Elle dut seulement hésiter en se demandant ce qui dominait en moi: si c'était la stupeur du présent ou le souvenir du passé. Elle m'offrit une chaise, et de l'autre côté du comptoir, elle me parla d'elle, de son existence, des larmes qu'elle avait versées en me perdant, de ses regrets, de ses revers, de la maladie qui l'avait défigurée, et du temps qui contribuait à sa décadence. Elle avait en vérité l'âme décrépite. Elle avait tout vendu, ou presque tout. Un homme qui l'avait aimée autrefois lui avait laissé cette bijouterie, qui était par malheur mal achalandée, peut-être à cause de cette singularité d'être tenue par une femme. Ensuite elle m'interrogea sur ma vie. Ce fut vite fait; mes aventures n'étaient ni intéresses ni longues à redire.
—Vous êtes marié? me demanda Marcella quand j'eus fini.
—Non, répondis-je sèchement.
Marcella regarda dans la rue avec l'atonie de quelqu'un qui médite ou qui se souvient. Moi aussi, je me rappelais le passé, et non sans quelques regrets, je me demandais pourquoi j'avais fait tant de folies. Ce n'était certes plus la Marcella de 1822; mais la beauté de l'autre valait-elle vraiment le tiers des sacrifices que j'avais faits? C'était ce que je désirais savoir, et j'interrogeais le visage de Marcella. Ce visage me répondait que non. En même temps ses yeux ma confessaient que, naguère comme maintenant, ils brillaient de toute l'ardeur des convoitises. C'était mes yeux qui autrefois n'y voyaient goutte, mes yeux de la première édition.
—Mais pourquoi êtes-vous entré? Vous m'avez aperçue de la rue? me demanda-t-elle en sortant de cette espèce de torpeur.
—Non. Je croyais entrer chez un horloger. Je voulais acheter un verre pour cette montre. Je vais ailleurs. Vous m'excuserez, je suis un peu pressé.
Marcella ne put retenir un soupir. La vérité c'est que je me sentais ému et attristé et que je mourais d'envie de me trouver loin de cette maison. Marcella appela un gamin, loi donna la montre et, malgré mes protestations, l'envoya chez un horloger du voisinage acheter un autre verre. Je n'avais qu'à me résigner. Elle me dit alors qu'elle désirait avoir la pratique de ses anciennes connaissances. Elle remarqua qu'il était fort naturel qu'un jour ou l'autre je me mariasse, et elle s'offrit à me vendre de fins bijoux au plus bas prix. Elle n'employa pas ce terme, elle se servit d'une métaphore délicate et transparente. J'en vins à me demander si elle avait vraiment eu des revers, abstraction faite de sa maladie, si elle n'avait pas toujours de beaux deniers sonnants, et si elle ne faisait pas du négoce à seule fin de satisfaire sa passion du lucre, qui était le ver rongeur de cette existence. Je sus depuis que mes soupçons étaient fondés.
Tandis que je faisais ces réflexions, un individu de petite taille, sans chapeau, tenant par la main une gamine de quatre ans, entra dans la boutique...
—Comment ça va-t-il depuis ce matin? demanda—t-il à Marcella.
—Comme ci comme ça; viens ici, Maricota.
L'individu prit l'enfant dans ses bras, et la fit passer par-dessus le comptoir.
—Allons, dit-il, demande à Dona Marcella comment elle a passé la nuit. Elle mourait d'envie de venir ici, mais sa mère n'avait pas eu le temps de l'habiller. Voyons, Maricota, dis bonjour à la dame... Gare la fessée... C'est bien... Vous ne pouvez vous figurer comme elle est chez nous. Elle parle de vous tout le temps; et ici, elle a l'air empaillée. Hier encore... faut-il raconter l'histoire, Maricota?
—Non, papa, je ne veux pas.
—C'est donc quelque chose de bien laid? dit Marcella en donnant une petite tape à l'enfant.
—Je vais vous dire: sa mère lui a appris à réciter chaque soir un pater et un ave, en l'honneur de la Sainte Vierge. Mais la petite est venue me demander hier, d'une voix si humble, devinez quoi?... si elle pouvait offrir sa prière à santa Marcella.
—Pauvre chérie, dit Marcella en l'embrassant.
—C'est un amour, une passion qu'elle a pour vous... Vous ne vous figurez pas... Sa mère dit que vous lui avez lancé un charme.
L'individu continua sur ce ton à raconter toutes sortes de choses aimables, et sortit enfin, emmenant la petite, non sans m'avoir lancé un regard d'interrogation ou de suspicion. Je demandai à Marcella qui il était.
—C'est un horloger du voisinage, un brave homme; sa femme est bien bonne aussi. Sa fille est gentille, n'est-ce pas? Ils ont l'air de beaucoup m'aimer... Ce sont de bonnes gens.
En proférant ces paroles, Marcella parlait d'une voix où il y avait un frémissement d'allégresse. Et un rayon de joie parut s'étendre sur sa face.
Sur ces entrefaites, le gamin entra, apportant la montre avec le verre. Il était temps; j'en avais assez de ma visite. Je donnai une monnaie d'argent au gamin, je dis à Marcella que je reviendrais dans une autre occasion, et je sortis au plus vite. Pour tout dire, je dois avouer que le cœur me battait un peu, mais c'était une espèce de glas. Mon âme se débattait entre des impressions opposées. Notez bien que la journée s'était passée gaiement pour moi. Au déjeuner, mon père m'avait récité par anticipation le premier discours que je devais proférer au Parlement. Nous en rîmes beaucoup, et le soleil aussi qui était dans ses bons jours de clarté. Virgilia aussi rirait sans doute, en entendant le récit de nos fantaisies. Et voilà que je perds mon verre de montre, que j'entre dans un magasin, le premier que je trouve sur ma route, et j'y rencontre le passé qui me déchire, qui m'embarrasse, qui m'interroge avec un visage couvert de cicatrices et de mélancolie.
Je le laissai où je l'avais trouvé. Je montai dans mon cabriolet qui m'attendait place S.-Francisco de Paula, et j'ordonnai au cocher partir au plus vite. Il cingla les mules, la voiture fit des soubresauts, les roues tracèrent leur sillon dans la boue formée par une pluie récente, et pourtant il me semblait que nous ne marchions pas. De temps à autre nous faisons connaissance avec un certain vent tiède et lourd, qui n'est ni violent ni âpre, qui n'emporte point les chapeaux et ne soulève pas les jupes, mais qui est pire que s'il faisait tout cela, parce qu'il abat, amollit et semble un dissolvant de l'âme. Ce vent, je l'avais en moi. Je sentais le courant d'air qu'il formait comme dans une gorge, entre le passé et le présent, désireux sans doute de s'étendre sur les plaines de l'avenir. Et la voiture qui ne marchait pas.
—Jean! criai-je au cocher, avancerons-nous bientôt?
Avancer! Monsieur! mais nous sommes à la porte de Monsieur le Conseiller.
C'était vrai. J'entrai en coup de vent. Je trouvai Virgilia anxieuse, de mauvaise humeur, le front soucieux. Sa mère, qui était sourde, se trouvait dans le salon avec elle. Après les compliments d'usage, la jeune fille me dit d'un ton sec:
—Nous vous attendions plus tôt.
Je me défendis le mieux que je pus; je pris prétexte du cheval, qui était rétif, et d'un ami qui m'avait retenu. Et soudain voici que la parole meurt sur mes lèvres, et je demeure pétrifié. Virgilia... Eh quoi! c'est Virgilia, cette jeune fille?... Je la regardai fixement, et l'impression fut si cruelle que je reculai d'un pas en détournant mes regards. Sa carnation, si rose, si pure, si fraîche la veille encore, était maintenant jaune, stigmatisée par la même maladie qui avait frappé l'Espagnole. La petite vérole lui avait dévoré le visage. Ses yeux si vifs s'étaient étiolés. Ses lèvres pendaient, et toute son attitude disait la fatigue. Je la regardai bien; je lui pris la main et l'attirai doucement à moi. Je ne me trompais point. C'était bien la petite vérole. Je crois que je fis un geste de dégoût.
Virgilia s'éloigna et alla s'asseoir sur le sofa. Pendant un moment je contemplai la pointe de mes bottines. Devais-je sortir ou rester? La première hypothèse était absurde; je la rejetai, et je me dirigeai vers Virgilia qui demeurait assise et muette. Ciel! de nouveau je la retrouvai fraîche, juvénile, et tout en fleur. En vain je cherchais sur son visage les traces du mal, il n'y en avait aucune. La peau était blanche et fine comme de coutume.
—Vous ne m'avez donc jamais vue? me demanda-t-elle en voyant mon insistance.
—Aussi jolie, jamais.
Je m'assis, tandis qu'elle faisait craquer ses ongles sans rien dire. Je parlai de choses tout à fait étrangères à l'incident; mais elle ne répondait point et ne me regardait même pas. Moins le bruit de ses doigts, c'était la statue du silence. Une seule fois elle me contempla de très haut, en relevant un coin de ses lèvres, et en fronçant les sourcils au point de les unir. Et toute cette mimique lui donnait une expression mixte, entre le comique et le tragique.
Il y avait bien quelque affectation dans ce dédain. Elle avait pris un masque. Elle devait souffrir,—soit tristesse, soit dépit; et comme la douleur contenue est plus âpre, il est probable qu'elle souffrait en double sa propre souffrance. Mais je crois que c'est là de la métaphysique.
Et à propos de métaphysique, que dites-vous de ceci? On lance une boule; elle en rencontre une autre, lui transmet l'impulsion reçue, et celle-ci se met à rouler ni plus ni moins que la première. Supposons que la première boule s'appelle Marcella (c'est une simple supposition), la seconde Braz Cubas, la troisième Virgilia. Marcella reçoit une pichenette du passé et roule et vient buter contre Braz Cubas. Celui-ci, cédant à la force impulsive, va battre contre Virgilia, qui n'a rien de commun avec la première boule. Et voilà comment, par la simple transmission d'une force, les extrêmes se touchent dans la société humaine; et il s'établit ce qu'on pourrait appeler la solidarité de la tristesse humaine. Ce chapitre a pourtant échappé à Aristote.
Positivement Virgilia était un petit diable, un petit diable angélique, si l'on veut, mais c'en était un tout de même, et alors...
Alors apparut Lobo Neves. Il n'était ni plus svelte, ni plus élégant, ni plus instruit, ni plus sympathique que moi, et cependant il m'enleva de haute main Virgilia et la candidature, en peu de semaines, avec une fougue vraiment césarienne. Il n'y eut de la part de Virgilia aucun dépit, pas la moindre violence de la part de sa famille. Dutra me dit un beau jour que je devais attendre une époque plus opportune pour ma candidature, attendu que celle de Lobo Neves était appuyée par de puissantes influences. Je cédai. Ce fut le commencement de ma défaite. Une semaine plus tard, Virgilia demanda en souriant à Lobo Neves quand il prétendait être ministre.
—Tout de suite, s'il dépendait de moi; d'ici un an, puisque cela dépend de la volonté d'autrui.
Virgilia répliqua:
—Et vous me promettez qu'un jour vous me ferez baronne?
—Marquise, voulez-vous dire, car j'ai l'intention d'être marquis.
Dès lors je fus perdu. Virgilia compara l'aigle au dindon et choisit l'aigle, abandonnant le dindon à sa stupeur, à son dépit, et au souvenir de trois ou quatre baisers qu'elle lui avait donnés. Mais quand c'eût été dix, qu'est-ce que cela signifiait? La lèvre de l'homme n'est point comme le sabot du cheval d'Attila qui stérilisait le sol qu'il avait foulé; c'est justement le contraire.
Mon père fut tout désappointé de ce dénouement, et je crois bien qu'il en mourut. Il avait bâti tant de châteaux, caressé tant et tant de beaux rêves, qu'il ne pouvait voir s'effondrer tout cet échafaudage, sans que le contre-coup fût grand dans son organisme. D'abord il se refusa à l'évidence. «Un Cubas»! et il disait cela avec une telle conviction, que moi, qui connaissais déjà la tonnellerie originelle, j'oubliai un instant la dame de mes pensées pour contempler un moment ce phénomène qui n'est point rare, mais qui est toujours curieux, d'une imagination qui s'impose à la conscience.
—Un Cubas! répétait-il le lendemain matin au déjeuner.
Ce déjeuner ne fut point très gai. Je me sentais tomber de sommeil. J'avais veillé une partie de la nuit. Était-ce l'amour? Non point. On ne peut aimer deux fois la même femme, et comme j'allais aimer celle-là même quelque temps après, je ne devais lui être en ce moment attaché que par les liens d'une fantaisie passagère, un peu d'habitude et beaucoup de fatuité. Et cela seul suffit pour expliquer l'insomnie. C'était le dépit, un dépit aigu comme une pointe d'épingle, et que j'entretins en fumant, en donnant des coups de poing dans l'air, en lisant machinalement jusqu'au lever de l'aurore, de la plus tranquille des aurores.
Mais j'étais jeune, et je portais en moi-même le remède à mes maux. Mon père, lui, ne put supporter le coup. À y bien penser, peut-être ne mourut-il pas de cette contrariété; mais sûrement elle aggrava son état. Il dura encore quatre mois, silencieux, triste, continuellement préoccupé, comme s'il se fût agi d'un remords, d'une déception sans remède, qui lui tînt lieu de rhumatisme et de toux. Il eut cependant un dernier instant de satisfaction: un des ministres d'État lui rendit visite. Je vis alors sur ses lèvres,—et il me semble le voir encore,—le sourire d'un autre temps. Ses regards brillèrent d'une flamme concentrée, qui fut comme la dernière lueur d'une lampe qui s'éteint. Mais la tristesse revint: la tristesse de s'en aller sans me voir occuper le haut poste auquel j'avais droit.
—Un Cubas!
Il mourut quelques jours après cette visite, un matin de mai, entre ses deux enfants, Sabine et moi. Mon oncle Ildefonso et mon beau-frère étaient aussi présents. La science des médecins, notre tendresse, tous les soins dont on l'entoura furent vains: il devait mourir, et il mourut.
—Un Cubas!
Larmes et sanglots, la maison tendue de noir, un homme qui vient habiller le cadavre, un autre qui prend les dimensions du corps, un cercueil qu'on apporte, un catafalque que l'on dresse, de grands chandeliers, des lettres de faire-part, des gens qui entrent, lentement, à pas de loup, qui serrent la main aux personnes de la famille, les uns tristes, les autres sérieux et muets, un prêtre et un sacristain, des prières, des aspersions d'eau bénite, l'ensevelissent, le choc du marteau sur les clous, six personnes qui s'emparent du cercueil, l'emportent, descendent difficilement l'escalier malgré les cris, les sanglots et les larmes renouvelées de la famille, et placent la caisse funèbre sur le char; les courroies qu'on attache et que l'on serre, la voiture qui se met en branle, et les autres voitures qui défilent une à une... tous ces aspects qui paraissent une liste d'inventaire, sont autant de notes que j'avais prises pour un chapitre triste et après tout banal, que je n'écrirai pas.
Regarde-nous, maintenant, lecteur. Huit jours se sont passés depuis la mort de mon père. Ma sœur est assise sur un sofa, un peu plus loin. Cotrim, debout, appuyé sur une console, les bras croisés, mord ses moustaches. Je fais les cent pas, les regards au plancher. Grand deuil, profond silence.
—Mais enfin, dit Cotrim, cette maison vaut tout au plus trente contos; mettons trente-cinq.
—Elle en vaut cinquante, répondis-je; Sabine sait parfaitement qu'elle en a coûté cinquante-huit.
—Et quand on l'aurait payée soixante, repartit Cotrim; d'abord cela ne veut pas dire qu'elle les valait, et encore bien moins qu'elle les vaille encore aujourd'hui. Tu sais bien que les immeubles ont beaucoup baissé de prix depuis quelques années. Si celle-ci vaut cinquante contos, combien alors vaudra celle du Campo, que tu désires pour toi?
—Allons donc! une vieille bicoque!
—Vieille! s'écria Sabine en levant les mains au ciel.
—Je parie que vous la trouvez neuve.
—Voyons! frérot, dit Sabine en se levant du canapé. Nous pouvons tout arranger de bonne amitié et de façon décente. Par exemple, Cotrim ne veut point des noirs, il ne gardera que le cocher de papa et Paulo.
—Le cocher, non; je garde le cabriolet, et je ne vais pas acheter un autre cocher.
—Bon. Alors nous garderons Paulo et Prudencio.
—Prudencio a été libéré.
—Libéré?
—Il y a deux ans.
—Libéré! Voilà comment papa faisait les choses, sans rien dire à personne. C'est bon. Quant à l'argenterie..., je suppose qu'il n'a pas libéré l'argenterie?
Nous avions parlé de l'argenterie, une vieille vaisselle plate du temps de D. José. C'était la question la plus grave de la succession, par la valeur artistique, l'ancienneté, et l'origine même, car mon père disait que le comte de Cunha, quand il était vice-roi du Brésil, en avait fait présent à mon bisaïeul Luiz Cubas.
—Quant à l'argenterie, continua Cotrim, je m'en désintéresserais, n'était le désir que ta sœur a de la garder. Je trouve ce désir raisonnable. Sabine est mariée; elle a besoin d'un service présentable. Toi tu es garçon, tu ne reçois pas, tu...
—Mais je puis me marier.
—Pourquoi faire? s'écria Sabine.
Cette sublime question me fit pour un instant oublier mes intérêts. Je souris; je pris la main de Sabine en battant doucement sur la paume, de si aimable manière que Cotrim interpréta le geste comme un acquiescement et me remercia.
—De quoi? répondis-je; je n'ai point souscrit et ne souscrirai pas à vos exigences.
—Tu ne céderas pas?
Je secouai négativement la tête.
—Laisse-le, Cotrim, dit ma sœur à son mari. Peut-être veut-il aussi que nous lui donnions les vêtements que nous portons. Il ne manque plus que cela.
—Oui, c'est complet. Il veut le cabriolet, il veut le cocher, il veut l'argenterie, il veut tout. Il serait infiniment plus simple de nous citer en justice, et de prouver par témoins que Sabine n'est pas ta sœur, que je ne suis pas ton beau-frère, et que Dieu n'est pas Dieu. Voilà le bon moyen de ne rien perdre. Mon cher garçon, tu nous prends pour d'autres.
Nous en étions arrivés à un tel degré d'irritation que je crus devoir offrir un moyen terme: répartir l'argenterie entre nous. Il ricana et me demanda qui garderait la théière, et qui le sucrier. Et il ajouta que nous avions le temps de discuter nos prétentions, tout au moins judiciairement. Sabine s'était accoudée à la fenêtre qui donnait sur le jardin, et au bout d'un instant elle revint et proposa de me céder Paulo et l'autre noir contre l'argenterie. J'allais accepter, mais Cotrim s'étant approché, elle répéta sa proposition.
—Ça, jamais, dit-il, je ne fais pas l'aumône.
Nous dinâmes tristement. Mon oncle le chanoine arriva quand nous en étions au dessert. Et il assista encore à une légère altercation.
—Mes enfants, dit-il, rappelez-vous que mon frère vous a laissé un pain assez grand pour être réparti entre tous.
Et Cotrim:
—C'est vrai, c'est fort vrai. Mais il n'est pas question de pain; il est question de beurre. Je ne me contente pas de pain sec.
On fit enfin le partage; mais nous étions brouillés. Et vraiment il m'en coûta de me fâcher avec Sabine. Nous étions si bons amis. Nous avions tant de choses en commun, jeux d'enfants, fureurs puériles, sourires et tristesses de l'âge adulte, nous avions partagé le pain de l'allégresse et celui des misères, fraternellement, comme un bon frère et une bonne sœur que nous étions. Et pourtant nous étions fâchés. C'était comme la beauté de Marcella qui disparu sous la grêle de la variole.
Marcella, Sabine, Virgilia... me voilà en train de fondre tous ces contrastes, comme si ces noms et ces personnes étaient autre chose que des modalités de mon affection intime. Plume de mauvaises mœurs, mets une cravate au style, revêts-le d'un habit moins sordide. Ensuite nous rentrerons dans mon ancienne demeure, nous nous coucherons dans ce hamac, où j'ai passé la plus grande partie des années qui s'écoulèrent depuis l'inventaire des biens paternels jusqu'à l'année 1842. S'il s'exhale de la pièce de vagues senteurs de toilette, il ne faut pas croire que c'est moi qui ai versé les parfums. C'est un relent de Z, de N, ou de U. Toutes ces lettres majuscules bercèrent dans ce boudoir leur élégante abjection. Mais si, outre l'arôme, on est curieux d'autre chose, c'est peine perdue: je n'ai gardé ni les portraits, ni les lettres, ni les factures. L'émotion même s'est éteinte, il ne reste que les initiales.
Je vécus ainsi en reclus. De temps à autre, j'allais au bal, au théâtre, à une réunion; mais la plus grande partie du temps, je l'ai passée avec moi-même. J'ai vécu; je me suis laissé porter par le flux et le reflux des événements et des jours, tantôt agité tantôt apathique, entre l'ambition et l'indifférence. Je faisais de la politique et de la littérature, j'envoyais des articles et des vers aux journaux, j'acquis même une certaine réputation de polémiste et de poète. Quand je me souvenais de Lobo Neves, qui était député, et de Virgilia, future marquise, je me demandais à moi-même si je n'aurais pas fait un meilleur député et un plus élégant marquis que Lobo Neves, car je valais mieux que lui, beaucoup mieux que lui. Et je me disais cela en regardant le bout de mon nez.
—Sais-tu qui est arrivé hier de S. Paulo? me demanda un soir Luiz Dutra.
Luiz Dutra était un cousin de Virgilia, qui vivait aussi dans l'intimité des muses. Ses vers plaisaient, et valaient du reste mieux que les miens. Mais il lui fallait la sanction d'une élite qui lui confirmât les applaudissements de la masse. Il était timide et n'interrogeait perdue. Mais il se délectait à entendre des paroles louangeuses. Il prenait alors de nouvelles forces, et se remettait au travail avec une ardeur juvénile.
Ce pauvre Dutra! à peine avait-il publié quelque chose qu'il accourait chez moi, et commençait à tourner autour de moi, dans l'attente d'un jugement, d'une parole, d'un geste qui fût de ma part une approbation de sa nouvelle production. Moi, je parlais de mille choses différentes,—du dernier bal du Catete, d'une séance des Chambres, d'équipages et de chevaux,—de tout, moins de ses vers et de sa prose. Il me répondait d'abord avec animation, puis mollement, et tâchait de faire tourner la conversation sur le sujet qui l'intéressait. Il ouvrait un livre, me demandait si j'avais quelque travail en train; je lui répondais oui ou non, puis je passais à un autre chapitre. À la fin, il se taisait et sortait tout triste. Mon désir était de le faire douter de lui-même, de le décourager, de l'éliminer. Et tout en prenant cette résolution, je regardais le bout de mon nez...
Combien de fois dans ma vie, pour me faire une conscience sans remords, je me suis servi de ce système: regarder le bout de mon nez... Avez-vous quelquefois médité sur le destin du nez, cher lecteur? Le docteur Pangloss disait qu'il est fait pour l'usage des lunettes.—Je confesse que cette explication m'avait d'abord paru définitive. Mais un certain jour que je méditais sur ce point obscur de philosophie, et sur d'autres encore, je découvris enfin l'unique, véritable et suprême utilité de cet appendice.
Il me suffit pour cela de me rappeler l'habitude des fakirs. On sait que ces gens-là demeurent, en effet, des heures en contemplation, les regards fixés sur le bout de leur nez, à seule fin de voir la lumière céleste. Ils perdent alors la notion du monde extérieur, s'envolent dans l'invisible, touchent l'impalpable, se délivrent des liens terrestres, se dissolvent et s'éthérisent. Cette sublimation de l'être par le bout du nez est le phénomène le plus prodigieux de l'esprit et il n'appartient pas en propre aux fakirs; il est universel. Chaque homme éprouve le besoin et a le pouvoir de contempler son propre nez pour voir la lumière céleste, et cette contemplation, dont l'effet est de subordonner l'univers à un nez seulement, constitue l'équilibre des sociétés. Si les nez se contemplaient exclusivement les uns les autres, le genre humain n'aurait pas duré deux siècles; il se serait éteint avec les premières tribus.
J'entends d'ici une objection du lecteur. Comment peut-il en être ainsi? Car enfin l'on ne surprend jamais les gens en train de contempler leur nez.
Lecteur obtus, cela prouve que tu n'est jamais entré dans le cerveau d'un chapelier. Un chapelier passe devant une chapellerie. C'est le magasin d'un rival, qui a commencé il y a deux ans. Il y avait alors deux portes à sa boutique; il l'a agrandie, et maintenant, il y en a quatre. Il se promet que d'ici peu il y en aura six ou huit. Le chapelier voit dans la vitrine les chapeaux du rival; par les différentes portes, entrent les clients du rival. Le chapelier compare cette boutique à la sienne, qui est plus ancienne et qui pourtant n'a que deux portes, et ces chapeaux à ceux qu'il vend, et que l'on achète moins, bien qu'ils soient d'un prix égal. Cela le mortifie, naturellement. Il poursuit son chemin, pensif, les yeux baissés ou fixés devant lui. Il cherche les causes de la prospérité de l'autre et de son propre abandon, alors qu'il est un chapelier bien supérieur à l'autre chapelier... C'est en cet instant que ses yeux se fixent sur la pointe de son nez.
La conclusion c'est qu'il y a deux forces capitales au monde. L'amour qui multiplie l'espèce, et le nez qui la subordonne à l'individu. Procréation, et équilibre.
—C'est ma cousine Virgilia, la femme de Lobo Neves, qui est arrivée de S. Paulo, continua Luiz Dutra.
—Ah!
—Et ce n'est qu'aujourd'hui que je sais une chose, cachotier que tu es...
—Laquelle?
—Tu voulais l'épouser.
—Une idée de mon père... Qui t'a dit ça?
—Elle-même. Je lui ai beaucoup parlé de toi, et elle s'est laissé aller aux confidences.
Le lendemain, comme je me trouvais rue d'Ouvidor, à la porte de la typographie Plancher, je vis de loin une femme superbe. Elle s'approcha; c'était elle. Je ne la remis qu'à deux pas de moi, tant l'art et la nature l'avaient changée à son avantage. Je la saluai; elle passa. Je la vis monter avec son mari dans leur voiture, qui les attendait un peu plus loin. Je demeurai confondu.
Huit jours après, je la rencontrai dans un bal. Je crois que nous échangeâmes au plus deux ou trois mots. Mais à un autre bal, un mois plus tard, chez une dame qui avait fait l'ornement des salons du premier règne, et qui brillait encore dans ceux du second, le rapprochement fut plus intime et plus long, car nous conversâmes et nous valsâmes ensemble. La valse est un délicieux passe-temps. Nous valsâmes, et j'avoue qu'au contact de ce corps flexible et magnifique, j'éprouvai une singulière sensation: celle d'un homme qui a été victime d'un vol.
—Comme il fait chaud! dit-elle aussitôt nous eûmes fini. Allons sur la terrasse?
Non; vous pourriez vous enrhumer. Passons de préférence dans l'autre salon.
Nous y trouvâmes Lobo Neves, qui me fit compliment sur mes écrits politiques, en ajoutant qu'il se taisait sur mes productions littéraires parce qu'il se jugeait un profane dans la matière. Mais ce qui avait trait à la politique était excellent, bien pensé et d'un bon style. Je lui répondis sur le même ton de courtoisie, et nous nous séparâmes contents l'un de l'autre.
Trois semaines se passèrent, et je reçus une invitation de lui pour assister à une soirée intime. J'y allai. Virgilia me reçut avec cette aimable phrase: «Aujourd'hui vous valsez avec moi». J'étais, il est vrai, un valseur émérite; rien d'étonnant à ce qu'elle me distinguât. Nous valsâmes, une fois, deux fois. Un livre perdit Françoise; ce fut une valse qui nous perdit. Je crois bien que ce soir-là je lui serrai la main avec force. Elle se laissa faire, feignant de ne pas comprendre. Je l'étreignais; tous les regards étaient fixés sur nous et sur les autres couples enlacés et tournants... Un délire.
—Elle est à moi! me dis-je en la remettant aux mains d'un autre cavalier. Pendant tout le reste du bal, cette idée, je l'avoue, m'entra dans l'esprit, non pas comme à coups de marteau, mais comme si on me l'avait insinuée avec une vrille.
—Elle est à moi, me disais-je en arrivant à la porte de chez moi.
À ce moment même, comme si le destin ou qui que ce soit eût la fantaisie de donner une proie de plus à mes velléités de possession, je vis relire sur le sol quelque chose de jaune et de rond. Je me baissai; c'était une monnaie d'or, un demi-doublon.
—Elle est à moi, répétai-je en riant; et je la mis dans ma poche.
Cette nuit-là je ne me souvins plus de la monnaie; mais le jour suivant, j'éprouvai des scrupules en y pensant, et je me demandai de quel droit j'allais garder une monnaie dont je n'avais pas hérité, que je n'avais point gagnée, que j'avais seulement trouvée dans la rue. Évidemment, elle ne m'appartenait point. Elle appartenait à celui qui l'avait perdue, riche ou pauvre, pauvre peut-être, quelque ouvrier qui en avait besoin pour donner du pain à sa femme et à ses enfants. D'ailleurs, même s'il était riche, mon devoir n'en restait pas moins le même. Je devais restituer la pièce, et le meilleur moyen, l'unique même, était de mettre une annonce dans les journaux, ou de m'adresser à la police. J'envoyai une lettre au chef de police, en lui remettant ma trouvaille, et en le priant de la faire parvenir, par tous les moyens possibles, aux mains de son légitime propriétaire.
J'expédiai la lettre, et je déjeunai tranquille; je puis dire joyeux. Ma conscience avait tant valsé la veille qu'elle en était demeuré suffoquée et sans respiration. Mais la restitution de la pièce fut comme une fenêtre qui s'ouvrit sur un autre côté de la morale. Une onde d'air pur entra, et la pauvre dame respira à son aise. Il est bon de ventiler la conscience: je ne vous en dis pas plus long. En tous cas, en abstrayant les circonstances, ma façon de procéder était louable, elle exprimait un juste scrupule, le sentiment d'une âme délicate. C'est ce que me disait la bonne dame, d'un ton à la fois austère et tendre. C'est ce qu'elle me disait, penchée sur l'appui de la croisée.
—C'est fort bien fait, Cubas; parfaitement agi. Non seulement cet air est pur, mais il est balsamique; c'est un effluve des éternels jardins. Veux-tu voir ce que lu as fait, Cubas?
Et l'aimable personne, tirant un miroir, l'ouvrit devant mes yeux. Je vis clairement le demi-doublon de la veille, rond, brillant, qui se multipliait à mes yeux, dix fois, trente fois, cinq cents fois, me démontrant amplement le bénéfice que je retirerai pendant ma vie et après ma mort de cette simple restitution. Et je concentrai tout mon être dans la contemplation do mon acte, m'y reconnaissant, m'y trouvant bon, peut-être grand. Une simple monnaie, hein! Ce que c'est que d'avoir un peu trop valsé.
C'est ainsi que moi, Braz Cubas, je découvris la loi sublime de l'équivalence des fenêtres, et que j'établis que, pour compenser la fermeture d'une croisée, il suffisait d'en ouvrir une autre, afin que la morale puisse aérer constamment la conscience. Peut-être ne comprendra-t-on pas ce que je dis; peut-être vaudrait-il mieux parler d'une chose plus concrète, d'un paquet, par exemple, d'un paquet mystérieux? Parlons donc du paquet mystérieux.
Le fait est que, quelques jours plus tard, en allant à Botafogo, je heurtai contre un paquet qui se trouvait sur la plage. Je m'exprime mal; je ne heurtai point, j'y donnai un coup de pied volontaire. En voyant ce paquet, pas très grand, mais propre et correctement noué d'une ficelle, ce quelque chose qui avait une certaine apparence, j'eus l'idée de le pousser du pied, par curiosité. Je sentis une résistance. Un coup d'œil lancé alentour me fit voir la plage déserte. Des gamins s'amusaient au loin. Plus loin encore, un pêcheur raccommodait ses filets. Personne ne pouvait me remarquer. Je m'inclinai, je paquet, et je poursuivis mon chemin.
Je poursuivis mon chemin, non sans quelque hésitation. Ce pouvait être une mauvaise farce. J'eus l'idée de rejeter le paquet sur la plage, mais, en le palpant, j'écartais cette pensée. Un peu plus loin, je fis un détour, et revins chez moi.
—Allons voir ça, dis-je en entrant dans mon cabinet.
J'hésitai encore un instant, par crainte, je crois. La pensée d'une mauvaise farce se présenta encore à mon esprit. Il est certain que je me trouvais sans témoins; mais j'avais en moi un gavroche prêt à siffler, à huer, à rire, à s'esclaffer, à glousser, à faire les cent coups, s'il me voyait ouvrir le paquet et en tirer une douzaine de vieux mouchoirs ou un certain nombre de goyaves pourries. Il était trop tard; ma curiosité était excitée comme doit l'être celle du lecteur. Je défis le paquet, et je vis... je trouvai... je comptai... je recomptai cinq contos de reis tout au long; peut-être dix mil reis en cinq contos en bonne monnaie et billets de banque, le tout bien plié, bien arrimé: une trouvaille rare. Je remis tout en ordre. Au dîner, il me sembla que les petits nègres de service clignaient des yeux. M'auraient-ils épié? Je les interrogeai discrètement, et conclus par la négative. Après le dîner, je retournai dans mon cabinet, je recomptai l'argent, et je souris de ces soins maternels, donnés aux cinq contos, moi qui étais riche.
Pour n'y plus penser, j'allai passer ma soirée chez Lobo Neves, qui avait insisté pour que je ne manquasse point aux réceptions de sa femme. Je rencontrai le chef de police, et on me présenta à lui. Il se rappela ma lettre tout de suite et le demi-doublon que je lui avais fait tenir quelques jours auparavant. Il raconta l'anecdote. Virgilia parut goûter le procédé, et chacune des personnes présentes plaça son histoire. J'écoutai la série avec une impatience de femme hystérique.
La nuit suivante, le jour suivant, et pendant toute la semaine, je pensai le moins possible aux cinq contos et je les laissai dormir bien tranquillement dans le tiroir de mon secrétaire. Je parlais de tout, excepté d'argent, et surtout d'argent trouvé; pourtant ce n'est pas un crime de trouver de l'argent; c'est une heureuse aventure, un hasard propice; c'était peut-être un décret de la Providence. Ce ne pouvait même être autre chose. On ne perd point cinq contos, comme on perd un mouchoir de poche. Cinq contos que l'on transporte sont l'objet de toute notre attention. On les palpe; on ne les quitte pas des yeux ni des mains, ils ne nous sortent pas de l'esprit; et pour les perdre totalement, comme ça, sur une plage, il faut que... En tous cas ce n'était pas un crime de les avoir trouvés: ni un crime, ni un déshonneur, ni rien qui rabaisse le caractère d'un homme. C'était une trouvaille, un heureux hasard, comme de gagner le gros lot ou un pari aux courses, comme avoir de la chance à n'importe quel jeu honnête; je dirai même que cette chance était ici méritée, car je ne me sentais ni mauvais, ni indigne des bienfaits de la Providence.
—Ces cinq contos, me disais-je trois semaines plus tard, il va falloir que je les emploie à quelque bonne action, à la dot de quelque pauvre fille ou à quelque œuvre semblable... Il faudra voir...
Ce jour-même, je les portai à la banque du Brésil. J'y fus reçu avec de délicates allusions au demi-doublon. Mon aventure faisait le tour de mes connaissances. Je répondis, assez gêné, qu'il n'y avait pas là de quoi faire tant de bruit. Et on loua ma modestie par-dessus le marché. Alors je me fâchai pour tout de bon, et l'on me répondit qu'on me trouvait grand, tout simplement.
Virgilia, elle, ne se rappelait plus du tout du demi-doublon. Toute sa pensée se concentrait en moi, dans mes yeux, dans ma vie, dans ma pensée. Elle le disait, et c'était vrai.
Il y a des plantes qui naissent et poussent vite; d'autres sont au contraire lentes et tardives. Notre amour était comme les premières. Il poussa avec tant de fougue et de sève qu'en peu de temps il devint comme les plus exubérantes et les plus touffues productions des forêts. Je ne pourrais vous dire au juste combien de jours furent nécessaires à sa croissance. Je me souviens qu'un certain soir, la fleur, ou le baiser, comme on voudra l'appeler, s'épanouit sur la bouche de la jeune femme; elle me le donna, la pauvrette, avec un tremblement, car nous étions à la porte du jardin. Cet unique baiser, rapide comme l'occasion, ardent comme l'amour, prologue d'une vie de délices, de terreurs, de remords, de plaisirs qui se transforment en douleurs, d'afflictions qui deviennent de l'allégresse, nous unit en cet instant. Et depuis, ce fut une hypocrisie patiente et systématique, unique frein d'une passion sans frein, une vie d'agitation, de désespoirs et de jalousies, qu'une heure compensait plus que largement. Puis il en venait une autre qui se substituait à celle-là, et alors les agitations et le reste, la fatigue et la satiété, qui sont la fin de tout, remontaient à la surface. Tel fut le volume de ce prologue.
Je sortis en emportant le goût de ce baiser. Je ne pus dormir. Je me jetai sur mon lit, mais bien inutilement. En général, pendant mes insomnies, le tic-tac de la pendule m'était fort désagréable. Ce bruit vague et sec m'avisait à chaque instant que j'avais quelques secondes de moins à vivre. Je me figurais alors un vieux diable, assis entre deux sacs, celui de la vie et celui de la mort, et retirant les monnaies de l'un pour les passer dans l'autre, en comptant de la sorte:
—Un de moins.
—Un de moins.
—Un de moins.
—Un de moins.
Chose singulière, quand la pendule s'arrêtait, je la remontais aussitôt, pour qu'elle ne cessât jamais de battre, et que je pusse supputer tous les instants perdus. Il y a des inventions qui se transforment ou se perdent. Les institutions succombent; l'horloge est définitive.
BRAZ CUBAS
. . . . . . . .!
VIRGILIA
. . . . . . . . . .
BRAZ CUBAS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRGILIA
. . . . . . . . . . .!
BRAZ CUBAS
. . . . . . . . .
VIRGILIA
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ? . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
BRAZ CUBAS
. . . . . . . .
VIRGILIA
. . . . .
BRAZ CUBAS
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ! . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ! . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . !
VIRGILIA
. . . . . . . . . . . . . . !
BRAZ CUBAS
. . . . . . . . !
VIRGILIA
. . . . . . . . . . . !
Mais enfin, qui m'expliquera la raison de ce changement? Un jour, nous nous rencontrons, nous nous faisons des promesses de mariage, nous les retirons, nous nous séparons, froidement, sans douleur, parce qu'aucune passion n'existait en nous. C'est à peine si j'éprouve quelque dépit, et rien de plus. Les années se passent, je la revois, nous faisons trois ou quatre tours de valse, voilà que nous nous aimons jusqu'au délire. Il est vrai que la beauté de Virgilia était parvenue à un haut degré de perfection, mais, substantiellement, nous étions restés les mêmes, et quant à moi, je n'étais devenu ni plus élégant ni plus beau. Qui m'expliquera le motif de ce changement?
Il ne pouvait résider que dans l'opportunité du moment. Notre première rencontre n'était pas opportune, parce qu'alors, si nous n'étions pas verts l'un et l'autre pour l'amour, nous l'étions encore pour notre amour. Il n'y a d'amour possible sans l'opportunité des acteurs. Cette explication, je la trouvai moi-même, deux ans après le baiser, un jour que Virgilia se plaignait d'un quidam ridicule qui allait chez elle, et lui faisait la cour avec ténacité.
—Quel importun! disait-elle en faisant une grimace de rage.
Je tressaillis; et je vis en la regardant que son indignation était sincère. Il me vint à l'idée que moi-même j'avais peut-être naguère provoqué cette même grimace, et je compris aussitôt toute l'importance de mon évolution. D'inopportun j'étais devenu opportun.
Oui certes, nous nous aimions. Maintenant que toutes les lois sociales étaient contre nous, nous nous aimions pour de bon. Nous étions liés l'un à l'autre comme les deux âmes que le poète rencontre dans le purgatoire:
Di pari como buoi che vanno a giogo.
Et je dis mal en nous comparant à des bœufs, car nous étions une autre espèce d'animaux moins lents, plne préoccupation sérieuse. Il riait, d'un rire sombre et désabusé; ensuite, il me pria de ne raconter à personne ce qui s'était passé entre nous. Je lui répondis qu'à la rigueur, il ne s'était rien passé du tout. Deux députés entrèrent, accompagnés d'un chef politique de district. Lobo Neves les reçut avec une joie qui au début, était un peu feinte, mais qui devint bientôt tout à fait naturelle. Au bout d'une demi-heure, personne n'eût dit qu'il n'était pas le plus fortuné des hommes. Il causait, il faisait des mots, il en riait, et les autres avec lui.
J'éprouvais d'abord un certain émoi quand je me rencontrais avec Lobo Neves. Illusion pure! Comme il adorait sa femme, il ne se gênait pas pour me le dire. Il trouvait que Virgilia était la perfection même, un tissu de qualités solides et profondes, aimable, élégante, austère, un vrai modèle. Et sa confiance ne s'arrêta pas là. Elle n'était qu'entr'ouverte; bientôt il ouvrit la porte toute grande. Un jour, il me confessa qu'il y avait un ver rongeur dans son existence: il lui manquait la gloire. Je l'encourageai. Je lui dis de fort agréables choses, qu'il écouta avec l'onction religieuse de son désir, qui ne consentait pas à mourir. Alors je compris que son ambition était lasse de battre de l'aile sans pouvoir prendre largement son vol. Quelques jours après, il me dit tous ses dégoûts, ses amertumes, ses fureurs concentrées. Il confessa que la vie politique est faite d'envies, de dépits, d'intrigues, de perfidies, d'intérêts et de vanités. Évidemment, il traversait une crise de mélancolie; j'essayai de la combattre.
—Je sais ce que je dis, répliqua-t-il avec tristesse. Vous ne pouvez vous imaginer tout ce que j'ai dû supporter. Je suis entré dans la politique par goût, par relations de famille, par ambition, et un peu par vanité. Vous voyez que j'ai réuni en moi tous les motifs qui poussent un homme dans la vie publique. Mais je ne voyais le théâtre que du côté des spectateurs; et vraiment le décor était beau et le spectacle magnifique, la représentation mouvementée et divertissante. Je signai un engagement; on m'a donné un rôle qui... Mais pourquoi vous fatiguerais-je de mes plaintes? Abandonnez-moi à tribulations. J'ai passé des heures et des jours!... Il n'y a ni constance de sentiments, ni gratitude, il n'y a rien!... rien!... rien!...
Il se tut, profondément abattu, les regards au ciel, paraissant ne plus rien entendre que l'écho de ses propres pensées. Après quelques instants, il se leva et me tendit la main. Vous allez vous moquer de moi, me dit-il; mais pardonnez-moi ce mouvement d'expansion. J'avais en tête une préoccupation sérieuse. Il riait, d'un rire sombre et désabusé; ensuite, il me pria de ne raconter à personne ce qui s'était passé entre nous. Je lui répondis qu'à la rigueur, il ne s'était rien passé du tout. Deux députés entrèrent, accompagnés d'un chef politique de district. Lobo Neves les reçut avec une joie qui au début, était un peu feinte, mais qui devint bientôt tout à fait naturelle. Au bout d'une demi-heure, personne n'eût dit qu'il n'était pas le plus fortuné des hommes. Il causait, il faisait des mots, il en riait, et les autres avec lui.
La politique doit être un vin énergique, me disais-je en sortant de la maison de Lobo Neves. Chemin faisant, j'aperçus dans la rue dos Barbonos un de mes anciens condisciples, alors ministre, et qui passait dans sa voiture. Nous nous saluâmes affectueusement. La voiture passa, et je m'en allai, cheminant, cheminant, cheminant...
—Pourquoi ne serais-je pas ministre?
Cette idée triomphale,—cette idée à falbalas, comme dirait le père Bernardes,—cette idée commença une série de voltiges que je suivis du regard en la trouvant divertissante. Je ne me souvins plus du découragement de Neves. Je sentis l'attraction de l'abîme. Je ne pensais qu'à mon ancien camarade, à nos courses à travers les collines, à nos jeux et à nos gamineries; et en comparant l'homme et l'enfant, je me demandais pourquoi je n'atteindrais pas où il avait atteint lui-même. J'entrai dans le jardin public et, là encore, tout semblait me répéter:
—Pourquoi donc, Cubas, ne serais-tu pas ministre? Pourquoi ne serais-tu pas ministre, Cubas?
En entendant cette voix universelle, j'éprouvais une délicieuse sensation dans tout mon organisme. J'entrai, j'allai m'asseoir sur un banc, tout en ruminant cette pensée. C'est Virgilia qui serait contente! Quelques instants plus tard, je vis s'approcher de moi un individu qui ne m'était pas inconnu. Je le connaissais, mais d'où?
Figurez-vous un homme de trente-huit à quarante ans, haut, maigre et pâle. Ses vêtements, abstraction faite de la forme, paraissaient revenus de la captivité de Babylone; son chapeau était contemporain de celui de Gessle. Imaginez maintenant une redingote plus large que ne comportaient les chairs, ou plus littéralement les os, du nouveau venu. La couleur noire du vêtement passait au jaune terne. Il n'en restait que la corde. Trois boutons avaient subsisté sur une rangée de huit. Les pantalons, de toile grise, étaient fortement marqués aux genoux, et s'effrangeaient sous la friction d'un talon qui appartenait à un soulier dépourvu de miséricorde et de cirage. À son cou flottait une cravate aux pointes bicolores, mais déteintes, et qui s'enroulait autour d'un col qui datait de huit jours. Je crois bien qu'il portait aussi un gilet, un gilet de soie obscure, déchiré par espaces et déboutonné.
—Je parie que vous ne me reconnaissez pas, Monsieur le Docteur Cubas? me dit-il.
—Non, je ne vous remets pas...
—Je suis Borba, Quincas Borba.
Je fis un mouvement de recul... Qui me donnera le verbe solennel d'un Bossuet ou d'un Vieira, pour dire une si complète désolation. C'était Quincas Borba, le gracieux enfant d'un autre temps, mon ancien condisciple, si intelligent et de si bonne famille. Quincas Borba! impossible! cela ne pouvait être. Je ne pouvais arriver à me persuader que cette misérable figure, cette barbe poivre et sel, que ce truand vieux avant l'âge, que toute cette ruine constituât le Quincas Borba que j'avais connu autrefois. Et pourtant, c'était lui. Les yeux conservaient encore l'expression d'un autre temps; le sourire n'avait point perdu l'ironie caractéristique. D'ailleurs il supporta tranquillement mon ébahissement. Au bout de quelques instants, je détournai les regards. Si son aspect était répugnant, la comparaison était abasourdissante.
—Pas besoin de longs commentaires, n'est-ce pas? vous devinez tout: une vie de misère, de tribulations et de luttes. Vous rappelez-vous nos réunions où je jouais le rôle de roi? Quelle dégringolade! Me voilà passé mendiant.
Haussant les épaules et la main droite, d'un air d'indifférence, il paraissait résigné aux coups de la fortune, et peut-être même satisfait. Oui content, et, en tous cas, impassible. Ce n'était ni la résignation chrétienne, ni l'acceptation philosophique. La misère lui avait recouvert l'âme de durillons, au point qu'il avait perdu la sensation de la boue. Il traînait ses haillons comme autrefois la pourpre: avec je ne sais quelle grâce indolente.
—Venez me voir, lui dis-je; je tâcherai de vous trouver quelque chose.
Un sourire magnifique entr'ouvrit ses lèvres.
—Vous n'êtes pas le premier qui me promet quelque chose, et sans doute, vous ne serez pas le dernier qui ne fera rien pour moi. Du reste, à quoi bon? Est-ce que je demande autre chose que de l'argent? De l'argent, oui; il faut bien manger, et les gargotes ne font pas crédit. Les fruitières non plus. Un rien du tout, deux sous de cruzade, il faut tout payer au comptant, Un enfer, quoi!... Un enfer, mon... j'allais dire mon ami... Un enfer de tous les diables! Tenez, je n'ai pas encore déjeuné.
—Non?
—Non; je suis sorti de très bonne heure de chez moi. Savez-vous où je demeure? Sur la troisième marche de l'église de S. Francisco, à droite, en montant. Pas besoin de frapper à la porte. L'appartement est on ne peut plus frais. Eh bien! je suis sorti de bonne heure, et je suis à jeun...
Je tirai mon porte-monnaie, j'y pris un billet de cinq mil reis,—le moins propre,—et je le lui donnai. Il le reçut avec un éclair de contentement. Il éleva le papier au-dessus de sa tête, et l'agita avec enthousiasme:
—In hoc signo, vinces! s'écria-t-il.
Ensuite il baisa le billet, avec des airs de tendresse et une si bruyante expansion que j'en éprouvai à la fois de la pitié et du dégoût. Il n'était point sot, et devina la nuance: il devint sérieux, grotesquement sérieux, et s'excusa de sa gaieté, gaieté d'un pauvre diable qui depuis nombre d'années ne voyait pas la couleur d'un billet de cinq mil reis.
—Il ne tient qu'à vous d'en posséder bien d'autres.
—Vraiment? fit-il en faisant un saut de mon côté.
—Vous n'avez qu'à travailler.
Il fît un geste de dédain, demeura un instant sans parler, puis me déclara positivement qu'il ne voulait rien faire. J'étais écœuré de cette abjection si tristement comique, et je me levai pour partir.
—Vous ne partirez pas sans que je vous enseigne ma philosophie de misère, me dit-il en se plantant devant moi.
Je supposai que le pauvre diable était quelque peu fou, et j'allais m'éloigner, quand il me prit par le poignet, et contempla pendant quelques instants le brillant que je portais au doigt. Je sentis courir sur sa chair un frémissement de désir, un prurit de possession.
—Superbe! dit-il.
Ensuite il commença à tourner autour de moi, en m'examinant des pieds à la tête.
—Vous vous mettez bien, me dit-il. Des bijoux, du linge fin, élégant et... Comparez donc vos souliers aux miens. Quel contraste! Vraiment, vous vous mettez bien. Et les donzelles? Comment sont-elles? Vous êtes marié?
—Non...
—Moi non plus.
—J'habite rue...
—Je veux ignorer votre adresse, interrompit-il. Si nous nous revoyons, donnez-moi de temps à autre un billet de cinq mil reis; mais permettez que je n'aille pas le demander chez vous. C'est un reste d'orgueil... Maintenant, adieu; je vois que vous vous impatientez.
—Adieu.
—Et merci. Laissez-moi vous remercier de plus près.
Ce disant, il m'embrassa avec tant d'impétuosité que je ne pus éviter son étreinte. Nous nous séparâmes finalement, et je m'éloignai rapidement, triste, écœuré, et la chemise salie par l'accolade. La partie sympathique de la sensation avait fait place à l'autre. J'aurais voulu le trouver digne dans sa détresse. Et je comparai de nouveau l'enfant d'autrefois et l'homme d'aujourd'hui, les espérances passées et la réalité du présent...
—Bah! dis-je, allons dîner.
Je mets la main dans la poche de mon gilet, pour y chercher ma montre.—Suprême désillusion! Borba me l'avait volée en m'embrassant.
Je dînai tristement. Ce n'était pas la perte de la montre qui me désolait; c'était le souvenir de l'auteur du vol, et les images d'autrefois, et le contraste et la conclusion.... Depuis le potage, la fleur jaune et morbide du chapitre XXV s'ouvrit en moi, et je dînai à la hâte pour me rendre chez Virgilia. Elle était le présent; je voulais me réfugier en elle, pour échapper aux impressions du passé, car la rencontre de Quincas Borba m'avait ramené vers un passé, non pas réel, mais vers un passé imaginaire, abject, loqueteux, mendiant et voleur.
Je sortis, mais il était encore trop tôt. Je les aurais trouvés à table. L'idée me vint alors de retourner au jardin public pour y chercher Quincas Borba. La pensée de le régénérer surgit en moi, forte et impérative. Il était déjà parti. Je m'adressai au garde; il me répondit qu'en effet «cet individu» apparaissait de temps à autre.
—À quelle heure?
—Il n'a pas d'heure.
Il n'était donc pas impossible de le rencontrer. Je me promis de revenir. La nécessité de le régénérer, de le ramener au travail et an respect de lui-même me remplissait le cœur. Je commençai à sentir un bien-être, une sublimation, une admiration de moi-même... La nuit tombait, j'allai retrouver Virgilia.
J'allai retrouver Virgilia. Je ne tardai pas à oublier Quincas Borba. Virgilia était le traversin de mon esprit: un traversin doux, tiède, profond, aromatique, couvert d'une taie de fine toile de Bruxelles. Je m'y reposais habituellement de toutes les sensations tristes ou douloureuses. Et à bien penser, c'était l'unique raison d'être de Virgilia; l'unique. En cinq minutes, j'avais complètement oublié Quincas Borba, en cinq minutes de mutuelle contemplation, les mains dans les mains. Cinq minutes et un baiser emportèrent Quincas Borba, scrofule de la vie, loque du passé. Que m'importait son existence? Il pouvait à volonté attrister les regards des passants, puisque j'avais deux palmes d'un divin traversin, pour y fermer les yeux et y dormir.
Hélas! on ne saurait toujours se reposer et dormir. Trois semaines plus tard, en arrivant sur les quatre heures chez Virgilia, je la trouvai triste et abattue. D'abord elle refusa de me dire ce qui la préoccupait; mais comme j'insistais:
—Je crois que Damian se doute de quelque chose, me dit-elle. Je remarque en lui des bizarreries... Je ne sais comment dire... Il est toujours prévenant, sans doute, mais son regard n'est plus le même. Je dors mal: cette nuit encore, je me suis réveillée atterrée. Je rêvais qu'il allait me tuer. Peut-être est-ce une simple illusion; mais j'imagine qu'il nous soupçonne.
Je la tranquillisai de mon mieux; ce pouvait être des préoccupations politiques. Virgilia avoua que c'était possible; mais elle n'en demeura pas moins excitée et nerveuse. Nous nous trouvions dans le salon, qui donnait sur le jardin où nous avions échangé notre premier baiser. Une fenêtre ouverte laissait pénétrer une brise qui secouait doucement les rideaux, et j'y fixais mes regards sans les voir. À travers la lorgnette de mon imagination, j'entrevoyais dans le lointain une maison, une vie qui fussent nôtres, un monde où il n'y aurait ni Lobo Neves, ni mariage, ni morale, ni aucun lien qui entravât notre volonté. Cette idée me grisa. Le monde, la morale, le mari, se trouvant ainsi éliminés, il n'y avait plus qu'à pénétrer dans cette habitation de délices.
—Virgilia, lui dis-je, je vais te faire une proposition.
—Laquelle?
—M'aimes-tu?
—Oh! soupira-t-elle, en m'enlaçant de ses bras.
Et c'était vrai qu'elle m'aimait avec furie. Sa réponse traduisait une vérité patente. Les bras à mon cou, silencieuse et palpitante, elle me regardait de ses beaux grands yeux qui donnaient une singulière impression de lumière humide. Je m'oubliais à les contempler, à admirer cette bouche fraîche comme le matin et insatiable comme la mort. La beauté de Virgilia avait pris un caractère de splendeur qu'elle ne possédait pas avant son mariage. C'était une figure taillée dans un marbre du Pentélique, d'un modelage très noble, très large et très pur. Elle était tranquillement belle comme les statues, mais non apathique ni froide. Bien au contraire, elle avait l'apparence des natures chaudes, et dans la réalité, l'on pouvait dire qu'elle résumait l'amour en elle. Elle le résumait surtout en cette occasion où elle exprimait silencieusement tout ce que peut traduire la pupille humaine. Mais le temps pressait. Je dénouai le nœud formé par ses mains, je la pris par les poignets, je lui demandai si elle aurait le courage...
—De quoi faire?
—De fuir. Nous irons où nous pourrons être le plus à notre aise, dans une maison grande ou petite, à la campagne ou à la ville, ou en Europe, où il te plaira pourvu qu'on nous laisse tranquilles, que nous puissions vivre l'un pour l'autre et que te ne coures point de danger. Oui, fuyons. Tôt ou tard, il peut découvrir quelque chose, et tu serais perdue... entends-tu, perdue! Ce serait ta mort... et la sienne, car je le tuerais, sois-en sûre.
Je me tus. Virgilia, toute pâle, les bras tombant s'assit sur le canapé. Elle demeura dans cette attitude pendant quelques instants, vacillante, peut-être, ou atterrée par l'idée de la découverte possible, et de la mort subséquente. Je m'approchai d'elle, j'insistai, je fis miroiter les avantages d'une vie à deux, exempte de jalousies, de terreurs et d'afflictions. Virgilia m'écouta en silence, puis elle me répondit:
—Est-il certain que nous lui échapperions? il nous rejoindrait et me tuerait de la même manière.
Je lui démontrai le contraire. Le monde est vaste, j'avais le moyen de vivre où bon me plairait, où je trouverais un air pur et beaucoup de soleil. Il ne nous rejoindrait pas. Seules, les grandes passions sont capables de grandes actions, et l'amour qu'il avait pour elle n'était pas assez puissant pour qu'il lui courût après au bout du monde. Virgilia fit un geste de stupeur, et presque d'indignation. Et elle murmura que son mari avait pour elle une grande affection.
—C'est bien possible, lui répondis-je; c'est bien possible...
Je m'approchai de la fenêtre, et je commençai à tapoter sur l'accoudoir. Virgilia m'appela. Je continuai à ruminer mes haines et ma jalousie, pensant au plaisir avec lequel je tordrais le cou au mari si je l'avais là sous la main. Et voilà qu'à cet instant même, il franchit la porte du jardin. Rassure-toi, lectrice déjà défaillante, je ne marquerai pas cette page d'une tache de sang. Je fis, de loin, un geste amical au nouveau venu, en lui adressant une parole gracieuse. Virgilia battit en retraite, pour revenir deux ou trois minutes après.
—Il y a longtemps que vous êtes ici? me dit-il.
—Non.
Il était entré, l'air sérieux, en promenant, suivant son habitude, des regards distraits autour de lui. Mais son fils Nhonhô, le futur avocat du chapitre VI, survint, et la physionomie de Neves s'éclaira d'une expression joviale. Il le prit dans ses bras, le souleva, l'embrassa à plusieurs reprises. Je m'éloignai d'eux, car je ne pouvais souffrir cet enfant. Sur ces entrefaites, Virgilia rentra.
—Ouf! soupira Lobo Neves, en s'étendant paresseusement sur un sofa.
—Fatigué? lui dis-je.
—Horriblement: j'ai eu des tracas, à la Chambre d'abord, dans la rue ensuite, et encore un troisième ennui, ajouta-t-il en regardant sa femme.
—De quoi s'agit-il? demanda Virgilia.
—D'une... devine...
Virgilia s'assit à côté de lui, lui caressa la main, lui refit son nœud de cravate, et l'interrogea de nouveau.
—Ce n'est rien moins qu'une loge pour ce soir.
—Pour entendre la Candiani?
—Pour entendre la Candiani.
Virgilia battit des mains, se leva, donna un baiser à son fils, d'un air d'allégresse puérile, qui seyait mal à son genre de beauté. Ensuite elle voulut savoir si c'était une loge de côté ou de face, demanda des conseils à voix basse au sujet de sa toilette, puis s'enquit de l'opéra qu'on jouerait, et de mille autres choses.
—Vous dînez avec nous, docteur, me dit Lobo Neves.
—Il s'est invité lui-même, confirma Virgilia; il dit que vous avez le meilleur vin de Rio.
—Il n'en boit pas davantage pour cela.
Je le démentis au dîner. Je bus plus que de coutume, sans en être égayé. J'étais un peu nerveux, je le devins davantage. C'était la première grande colère que je ressentais contre Virgilia. Je ne regardai pas une seule fois de son côté durant tout le repas. Je parlai politique, journaux, ministère, j'aurais parlé de théologie, ma foi! si l'idée m'en était passée par la tête. Lobo Neves m'écoutait avec une dignité placide et une certaine bienveillance supérieure. Cela m'irritait encore plus, et me faisait paraître le dîner encore plus assommant. Je pris congé au sortir de table.
—À tout à l'heure, n'est-ce pas? me dit Lobo Neves.
—Peut-être bien.
Et je partis.
Je flânai par les rues, et je rentrai chez moi à neuf heures. Ne pouvant dormir, je me mis à lire et à écrire. À onze heures, je me repentis de ne point être allé au théâtre; je consultai ma montre, je voulus m'habiller et sortir. Mais sûrement j'arriverais trop tard, et du reste c'était donner une preuve de faiblesse. Évidemment Virgilia commence à avoir assez de moi, me disais-je. Et cette idée me trouvait tout à la fois désespéré et impassible, prêt à l'oublier et à la tuer. Il me sembla la voir inclinée sur le rebord de la loge, fascinant tous les yeux de ses bras nus, ses magnifiques bras nus qui étaient miens, son col couleur de lait, ses cheveux en bandeaux suivant la mode du temps, ses élégants atours et ses diamants moins brillants que ses yeux... Je la vis et je souffrais que d'autres la vissent aussi. Ensuite je commençai à la dévêtir, à enlever bijoux et soieries, à la dépeigner de mes mains hâtives et lascives, et elle était ainsi, je ne sais si plus belle ou plus simplement naturelle, plus mienne, uniquement mienne.
Le jour suivant, je ne pus me contenir. J'allai de bonne heure chez Virgilia, et la trouvait les yeux rougis de pleurs.
—Que s'est-il passé? lui demandai-je.
—Tu ne m'aimes pas: jamais tu n'as eu pour moi le moindre amour. Hier, tu paraissais me détester. Si au moins je savais de quoi je me suis rendue coupable. Mais en vérité, je l'ignore. Auras-tu la bonté de m'en informer?
—T'informer de quoi? Il ne s'est rien passé.
—Rien passé!... Tu m'as traitée comme un chien.
À ces mots, je lui pris les mains, je les baisai tandis que deux larmes coulaient de ses yeux.
—C'est fini; c'est passé, lui dis-je.
Je n'eus pas le courage de discuter; et d'ailleurs, discuter sur quoi? Était-ce de sa faute si son mari l'aimait? Je lui dis que je n'avais rien contre elle, que j'étais naturellement jaloux de l'autre, qu'il ne m'était pas toujours possible de lui faire bon visage; que d'ailleurs il dissimulait peut-être, et que le meilleur moyen de couper court aux terreurs et aux dissensions était de mettre à exécution mon idée de la veille.
—J'y ai pensé, me dit-elle. Une petite maison, à nous, solitaire, au fond d'un jardin, dans quelque rue discrète? L'idée est bonne. Mais est-il nécessaire de fuir?
Elle dit tout cela d'un ton ingénu et paresseux, et le sourire qui relevait le coin de sa bouche avait la même expression de candeur. Alors, m'éloignant un peu, je répondis:
—C'est toi qui ne m'as jamais aimé.
—Moi?
Oui. Tu es une égoïste! Tu préfères me voir souffrir tous les jours. Tu es une égoïste sans nom.
Virgilia se mit à pleurer et pour ne point attirer l'attention, elle enfonçait son mouchoir dans sa bouche et dévorait ses sanglots. Cette explosion de douleur me déconcerta. Si quelqu'un l'entendait, tout était perdu. Je m'inclinai vers elle, je lui saisis les mains, je lui murmurai les noms les plus doux de notre intimité. Je lui fis comprendre le danger qu'elle courait. La crainte la calma.
—C'est impossible, me dit-elle au bout de quelques instants. Je n'abandonnerai pas mon fils. Si je l'emmène, «il» ira me chercher au bout du monde. Impossible. Tue-moi plutôt, ou laisse-moi mourir... Ah! mon Dieu! Ah! mon Dieu!
—Calme-toi; on peut nous entendre.
—Qu'on entende si l'on veut!...
Elle était encore trop excitée. Je la priai de me pardonner, de ne plus se souvenir de ce qui s'était passé. Je lui dis que j'étais fou, mais que ma folie venait d'elle et ne finirait qu'avec elle. Virgilia essuya ses yeux et me tendit la main. Quelques minutes plus tard, nous en revînmes à l'idée de la maison solitaire dans quelque rue discrète.
Le bruit d'une voiture qui entrait dans le jardin interrompit notre conversation. Un esclave annonça la baronne X***. Virgilia me consulta du regard.
—Si vous vous sentez mal de tête, il vaut peut-être mieux ne pas recevoir.
—Est-elle déjà descendue?
—Oui, elle est descendue; elle dit qu'elle a besoin de parler à Madame.
—Faites entrer.
La baronne fit son entrée au bout d'un instant. Je ne sais si elle s'attendait à me voir. Mais il est impossible de montrer plus de surprise qu'elle ne fit.
—Quelle excellente rencontre! Qu'êtes-vous donc devenu qu'on ne vous voit nulle part? Hier je croyais bien vous apercevoir au théâtre. La Candiani était exquise. Quelle charmeuse! Elle vous plaît? C'est naturel. Les hommes sont tous les mêmes. Le baron me disait hier dans notre loge qu'une Italienne vaut cinq Brésiliennes. Quel toupet! et chez un vieux, ce qui est bien pis. Mais pourquoi donc n'étiez-vous pas au théâtre?
—Le mal de tête.
—Allons donc! une amourette, je parie. Qu'en dites-vous, Virgilia? Et bien! mon cher, hâtez-vous, car vous devez friser la quarantaine. Vous n'avez pas encore quarante ans?
—Je ne puis vous dire exactement. Mais si vous me permettez, je vais allez consulter mon extrait de naissance.
—Faites, faites...
Et, me tendant la main:
«Jusqu'à quand?... Samedi nous restons chez nous. Le baron me parle sans cesse de vous...»
En me retrouvant dans la rue, je me repentis d'être parti. La baronne était une des personnes qui avaient sur nous les pires soupçons. Bien qu'elle eût cinquante ans, elle n'en paraissait pas plus de quarante; et rieuse, fine et élégante, elle conservait des vestiges de son ancienne beauté. Elle ne parlait pas constamment, mais elle possédait grand art d'écouter et d'observer. Elle se courbait alors sur sa chaise, en dégainant son long regard aigu. Autour d'elle, on continuait à parler, à gesticuler sans défiance; elle regardait, poussant l'astuce au point de rentrer parfois en elle-même la flamme mobile ou fixe de ses yeux, en laissant tomber les paupières. Mais alors ses cils étaient autant de persiennes par où elle continuait de scruter l'âme et la vie des gens.
À ce point de vue, elle ressemblait à un parent de Virgilia, nommé Viegas, vieux rameau courbé sous soixante-dix hivers, tout sec et jauni, qui souffrait d'un rhumatisme entêté, d'un asthme non moins rebelle, et d'une lésion du cœur: une vraie réduction d'hôpital. Mais les yeux demeuraient pleins de vie et de santé. Pendant les premières semaines, Virgilia ne faisait pas attention à lui. Elle disait que lorsque Viegas paraissait en observation derrière son regard fixe, il était tout simplement en train de compter mentalement son argent. C'était en effet un avare fieffé.
Il y avait aussi le cousin de Virgilia, le fameux Luiz Dutra, que je désarmais à force de lui parler de ses vers et de sa prose, et de la présenter à mes amis. Quand l'un d'eux, qui le connaissait déjà de nom, se montrait satisfait de lier plus amplement connaissance, Luiz Dutra exultait. De mon côté, je guérissais mon dépit par l'espérance de n'être point dénoncé. Il y avait enfin une ou deux dames, quelques galantines, et des domestiques qui, naturellement, se vengeaient ainsi de leur condition servile. Tout cela constituait une véritable forêt d'yeux et d'oreilles, à travers lesquels nous devions manœuvrer avec la souplesse de serpents.
Or tandis que je songeais à tous ces gens-là, mes jambes me faisaient descendre la rue, de telle sorte que, sans y penser, je me trouvai à porte de l'hôtel Pharoux. C'est là que je dînais d'habitude. Mais comme je n'avais point marché de propos délibéré, je n'avais aucun mérite à être arrivé jusque-là. Tout l'honneur en revenait à mes jambes. Jambes bénies! dire qu'il y a des gens qui vous traitent avec dédain ou indifférence. Moi-même jusqu'alors, je vous avais tenues en médiocre estime, me fâchant contre vous lorsque vous vous fatiguiez, lorsque vous refusiez d'aller au delà de certaines limites et que vous me laissiez en proie à l'inutile désir d'avancer, dans la ridicule position d'une poule dont on a lié les pattes.
Mais cette aventure fut pour moi un rayon du ciel... Oui, jambes amies, tout en laissant mon cerveau occupé de Virgilia, vous vous étiez dit l'une à l'autre: «Voici l'heure de dîner, il faut qu'il mange, emmenons-le au quai Pharoux. Une partie de sa conscience reste occupée de la dame; chargeons-nous du reste, pour qu'il aille bien droit, sans heurter les piétons ni les voitures, et qu'après avoir salué les gens connus au passage, il arrive sain et sauf à l'hôtel.» Et vous avez rempli votre programme, jambes aimables, ce qui m'oblige à vous immortaliser dans ces pages.
Je dînai; après quoi, je rentrai chez moi. Je trouvai une boîte de cigares que m'envoyait Lobo Neves, et qui était entourée de papier de soie et ornée de faveurs roses. Je compris, j'ouvris le paquet, et y trouvai ce billet:
Mon cher B...
On nous soupçonne; tout est perdu; oublie-moi pour toujours. Nous ne nous verrons plus. Adieu. Oublie la malheureuse.
V...a.
Quel choc! Nonobstant sa défense, dès que la nuit fut venue, je courus chez Virgilia. Il était temps. Elle se repentait de sa précipitation. Dans l'embrasure d'une fenêtre, elle me raconta sa conversation avec la baronne. Celle-ci lui avait franchement répété les commentaires qu'on avait faits, la veille, en ne me voyant pas dans la loge de Lobo Neves. On glosait sur mon intimité dans la maison; en somme, nous étions l'objet des soupçons d'un chacun. Elle termina en me disant qu'elle ne savait vraiment à quel parti s'arrêter.
—Le meilleur est de fuir.
—Ça, jamais! dit-elle en secouant la tête.
Je vis qu'il était impossible de séparer deux choses qui étaient étroitement liées dans son esprit: notre amour, et l'idée de la considération publique. Virgilia était capable des plus grands sacrifices pour conserver ces deux avantages, et elle en perdait un en fuyant. Je ressentis en ce moment une impression qui ressemblait à du dépit; mais les émotions des deux derniers jours avaient émoussé ma sensibilité et le dépit disparut presque aussitôt.
—C'est bon, dis-je, va pour la petite maison!
Effectivement en deux jours, je trouvai notre affaire, dans un recoin de la Gamboa. Un bijou! La maisonnette était toute neuve, fraîchement crépie, ayant quatre fenêtres sur le devant, et deux sur les côtés. Les persiennes étaient couleur brique; des plantes grimpantes s'agriffaient aux quatre angles, le jardin s'étendait devant moi. Mystère et solitude: un bijou!
Il fut résolu que la garde en serait confiée à une ancienne couturière de Virgilia, qui avait habité chez elle, et était demeurée familière de la maison. Virgilia exerçait sur elle une sorte de fascination. On lui dirait ce que l'on voudrait, et elle accepterait le reste de confiance.
C'était pour moi une phase nouvelle de notre amour, avec l'apparence de la possession exclusive, capable de calmer les scrupules dans la conversation d'un certain décorum. J'en avais assez des rideaux, des chaises, du canapé, de tous les meubles du prochain, qui me reprochaient sans cesse notre duplicité. Je pouvais désormais éviter les dîners trop fréquents, le thé quotidien, et la présence de l'enfant qui était mon complice et mon ennemi. La maison m'épargnait tout cela. Le monde vulgaire finirait sur le seuil. Au delà s'ouvrait l'infini, l'éternité d'un monde supérieur, exceptionnel, nôtre, seulement nôtre, au-dessus des institutions, des lois, inaccessible aux baronnes, et aux curieux de toute sorte: un seul monde, un seul couple, une seule vie, une seule volonté, une seule affection, l'unité morale de tout par l'exclusion des contraires.
Telles étaient les réflexions que je me faisais, en suivant mon chemin, après avoir visité et arrêté la maison, quand je tombai sur un groupe en contemplation devant un nègre qui en fouettait un autre sur la place publique. La victime n'essayait même pas de fuir. Elle gémissait seulement, en prononçant ces seules paroles: «Non! pardon! maître, pardon!» Mais l'autre ne se laissait pas attendrir, et à chaque supplication, il répondait par un nouveau coup de fouet.
—Attrape! animal! encore une dose de pardon, soulard.
—Maître! gémissait l'autre.
—Te tairas-tu? disait le foueteur.
Je m'arrêtai par curiosité... Juste ciel! que vis-je? C'était Prudencio, mon petit valet Prudencio, affranchi quelques années auparavant par mon père, et qui exerçait en ce moment son autorité et sa fureur. Je lui demandai si le nègre qu'il battait était son esclave.
—Oui, Monsieur.
—Que t'a-t-il donc fait?
—C'est un fainéant et un ivrogne. Je lui avais confié la boutique, tout à l'heure, pendant que j'allais en ville; et il atout abandonné pour aller boire chez le mastroquet.
—Allons! pardonne-lui, dis-je.
—Comment donc, maître! Vos désirs sont des ordres. Rentre à la maison, ivrogne.
Je sortis du groupe, où l'on me regardait avec stupéfaction tout en faisant des conjectures. Je poursuivis mon chemin en déroulant une infinité de réflexions, dont je regrette d'avoir perdu le souvenir. C'eût été matière à un chapitre intéressant et probablement assez gai, comme je les aime: c'est même un faible chez moi. À première vue, l'épisode était ignorable. Mais en l'approfondissant, en y mettant le bistouri, j'y trouvai un côté comique, fin et même profond. C'était un moyen pour Prudencio de se libérer des coups qu'il avait lui-même reçus, Il les transmettait tout simplement. Enfant, je montais à cheval sur son dos, je mettais un mors dans sa bouche, je le rossais sans la moindre pitié. Il gémissait et peinait. Maintenant qu'il était libre, qu'il disposait de ses bras et de ses jambes, qu'il pouvait, à son gré, travailler, se reposer, dormir, délivré des menottes de son ancienne condition, maintenant, il prenait sa revanche. Il avait acheté un esclave à son tour, et lui payait avec usure les sommes qu'il avait reçues de moi. Voyez donc les subtilités de ce maraud.
Cette histoire me fait penser à un fou qui s'appelait Romualdo et qui disait être Tamerlan. C'était son unique manie, dont l'origine était singulière.
—Je suis, disait-il, l'illustre Tamerlan. Naguère, je n'étais que Romualdo; mais étant tombé malade, j'ai pris tant de tartre[3], tant de tartre, tant de tartre que je suis devenu Tartare, et même roi des Tartares. Le tartre a la propriété de naturaliser les gens.
Le pauvre Romualdo! on riait de ses réponses, mais je suppose que le lecteur n'en rira pas plus que moi. Je n'y trouve aucun sel. C'était drôle de l'entendre. Mais quand on lit son histoire, contée, comme cela, à propos de coups de fouet reçus et transmis, on doit penser qu'il vaut mieux retourner dans la petite maison de la rue de la Gamboa. Laissons là Romualdo et Prudencio.
Nous revoici dans la petite maison. Aujourd'hui, lecteur curieux, tu serais fort empêché d'y entrer. Quand elle eut vieilli, noirci; quand ses ais se trouvèrent pourris, le propriétaire la jeta bas pour en construire une autre trois fois plus grande, et pourtant bien inférieure à la première. Le monde était petit pour Alexandre; le creux d'une tuile sur un toit semble sans borne aux hirondelles. Considère maintenant la neutralité de ce globe qui nous emporte à travers l'espace comme un radeau de naufragés qui les jettera peut-être à la côte. Deux époux vertueux dorment aujourd'hui sur l'espace occupé hier par un ménage irrégulier. Un prêtre y dormira demain, puis un assassin, puis un forgeron, puis un poète, et tous béniront ce coin de terre qui leur fournit quelques illusions.
Virgilia meubla notre nid, et disposa tout suivant son instinct esthétique de femme élégante. J'y portai quelques livres, et il demeura sous la garde de Dona Placida, maîtresse supposée, et jusqu'à un certain point très réelle, de céans.
Il lui en coûta d'accepter la maison. Elle avait flairé l'intention, et elle répugnait à son rôle. Mais, enfin, elle céda. Je crois bien que tout d'abord elle en versa des larmes; elle se faisait horreur. Il est certain, tout au moins, que pendant les deux premiers mois, elle n'osa pas me regarder en face. Elle me parlait les yeux baissés, sérieuse et renfrognée, ou avec un air de tristesse. Je voulais gagner ses bonnes grâces et sa confiance, et ne me montrais pas offensé de ses réluctances. Quand je fus parvenu à mes fins, j'imaginai une histoire pathétique de mes amours avec Virgilia, une sympathie mutuelle antérieure au mariage, la résistance du père, la dureté du mari, et d'autres passages de roman. Dona Placida n'en récusa pas une seule page. Elle accepta le tout par nécessité de conscience. Au bout de six mois, on eût cru, en nous voyant tous trois, que Dona Placida était ma belle-mère.
Je ne fus pas ingrat: je lui constituai un petit capital de cinq contos,—les cinq contos trouvés sur la plage de Botafogo.—J'assurai ainsi le pain de sa vieillesse. Elle me remercia, les larmes aux yeux, et depuis, tous les soirs, elle pria pour moi devant une image de la Vierge qui se trouvait dans sa chambre,—et cette donation mit fin à ses remords.
Je commence à me repentir d'avoir commencé ce volume. Ce n'est pas que je me fatigue: au contraire; je me distrais un peu de l'éternité en envoyant quelques maigres chapitres dans le monde des vivants. Mais c'est une œuvre triste, qui sent le sépulcre. C'est un grave défaut; mais le pire de tous, ô lecteur, c'est ta hâte de vieillir alors que ma narration, au lieu de galoper, va d'un pas lent. Tu aimes les récits coulants, le style ordonné, tandis que le mien va comme les ivrognes, de droite et de gauche, ainsi qu'ils font, titubant, s'arrêtant, grognant, criant, riant, menaçant, glissant et tombant.
Car ils tombent.—Et vous aussi, pauvres feuilles de cyprès, vous tomberez tout comme les feuilles des arbres allègres. Et si j'avais encore des yeux, je verserais sur vous un pleur. Mais voilà les avantages de la mort: si l'on n'a plus de bouche pour rire, on n'a pas non plus d'yeux pour pleurer... Oui, vous tomberez, hélas!
Il est bien possible que je supprime le chapitre précédent. Entre autres motifs, il s'y trouve, dans les dernières lignes, une phrase qui ressemble pas mal à une balourdise, et je ne veux pas prêter à la critique des générations futures.
Pensez donc: d'ici à soixante-dix ans, un individu maigre, poivre et sel, n'aimant rien que les livres, s'incline sur la page précédente pour y chercher ce qu'il peut bien y avoir d'absurde. Il lit, il relit, il relit encore, mot par mot, syllabe par syllabe, les examinant extérieurement et intérieurement, sur toutes les faces, à contre-jour; il les époussète, les frotte sur son genou, les lave à grande eau, et n'arrive point à trouver la sottise.
C'est un bibliomane. Il ignore l'auteur; ce nom de Braz Cubas, il l'a en vain cherché dans les dictionnaires biographiques. Il a trouvé le volume, par hasard, sur l'étagère d'un bouquiniste, et l'a eu pour deux cents reis. Après mille et mille recherches, il s'est convaincu qu'il s'agit d'un exemplaire unique... Unique! Ô vous qui non seulement aimez les livres, mais encore avez la passion du collectionneur, vous connaissez bien la valeur de ce mot, et vous devinez par conséquent la joie de notre bibliophile. Il eût refusé la couronne des Indes, la papauté, tous les musées d'Italie et de Hollande si on lui eût offert de les échanger contre cet unique exemplaire. D'ailleurs, si au lieu de mes Mémoires, c'eût été un almanach, il aurait agi de la même manière, pourvu que l'exemplaire fût unique.
Pourtant il y a une absurdité. Notre homme demeure penché sur la page, une loupe collée à l'œil droit, tout à l'idée de trouver l'erreur. Il s'est promis d'écrire un mémoire succinct, où il relaterait, avec la découverte du livre, celle qu'il cherche en ce moment. Il ne découvre rien, et se contente de son acquisition. Il ferme le livre, le regarde, s'approche de la fenêtre, et le montre au soleil. À ce moment, un Cromwell ou un César passe au-dessous de lui, à la conquête du pouvoir. Il tourne le dos, ferme la fenêtre, se jette sur un hamac, et feuillette le livre, lentement, avec amour, à petites gorgées... Un exemplaire unique!
Les lignes saugrenues dont j'ai parlé m'ont gâté un autre chapitre. Comme je ferais mieux de dire les choses d'une bonne fois, en m'abstenant de tourner autour du pot. J'ai déjà comparé mon style à la marche des ivrognes. Si cette comparaison vous choque, je me servirai d'une autre, tirée de ces agréables lunchs que nous faisions avec Virgilia dans notre petite maisonnette de la Gamboa. Du vin, des fruits, des compotes: tel était le menu. Nous mangions, c'est vrai, mais nous entrecoupions le repas de douces paroles, d'œillades, d'enfantillages, d'une infinité de ces apartés de cœur qui constituent le vrai langage ininterrompu de l'amour. Parfois un léger dépit pimentait la situation, sucrée jusqu'à la fadeur. Virgilia se réfugiait alors sur un canapé, ou allait entendre les mièvreries de Dona Placida. Cinq ou dix minutes après, nous reprenions la causerie comme je reprends ma narration, pour l'interrompre une autre fois. Ce n'était pas de notre part horreur à la méthode. Nous l'invitions même dans la personne de Dona Placida. Mais jamais elle ne voulait s'asseoir à notre table.
—Je finirai par croire que vous ne m'aimez pas, lui dit un jour Virgilia.
—Grand Dieu! s'écria la bonne dame en levant les mains au ciel; mais si je ne vous aimais pas, Yaya[4]! qui donc aimerais-je au monde.
Et lui prenant la main, elle la regarda si fixement que les larmes ne tardèrent point à paraître. Virgilia lui fit force caresses, et je mis une monnaie d'argent dans la poche de cette excellente Placida.
Je n'eus pas à me repentir de ma générosité. La petite monnaie me valut une confidence de Dona Placida, et partant un chapitre de plus pour ces Mémoires. Quelques jours plus tard, je me trouvai seul avec elle, et elle en profita pour me conter son histoire.
Elle était fille naturelle d'un sacristain de l'archevêché, et d'une femme qui faisait des pâtisseries à domicile pour les vendre en ville. Elle avait dix ans quand son père mourut. À cet âge, elle râpait les noix de coco et vaquai déjà aux travaux de pâtisserie compatibles avec son âge. Lorsqu'elle eut quinze ou seize ans on la maria à un tailleur, qui mourut peu après phtisique, en lui laissant une fille. La jeune veuve se trouva avoir sur les bras une enfant de deux ans, et une vieille maman fatiguée de travailler. Pour faire vivre trois personnes, elle faisait des pâtisseries, cousait jour et nuit pour trois ou quatre maisons de confection, et donnait des leçons à quelques enfants du voisinage qui la payaient à raison de dix tostons par mois. Les années s'écoulèrent ainsi, non la beauté, par le simple motif qu'elle n'avait jamais été jolie. Pourtant des amoureux se présentèrent; elle résista à leurs séductions.
—Si j'avais pu rencontrer un autre mari, me disait-elle, sûrement je me serais remariée; mais personne ne voulait m'épouser.
Un des prétendants fut agréé par elle; quand elle se convainquit qu'il n'était pas plus délicat que les autres, Dona Placida l'éconduisit, quitte à pleurer beaucoup ensuite. Elle continua comme par le passé à coudre et à écumer des chaudrons. Sa mère avait l'acrimonie des années, de la misère et de son propre tempérament. Elle engageait sa fille à accepter les maris de passage qui la sollicitaient et elle s'écriait:
—Tu as la prétention d'être meilleure que moi. Je ne sais d'où te vient ce scrupule de personne riche. Ma chère, on a la vie qu'on peut, et l'on ne se nourrit pas de l'air du temps. Voyez-vous ça! un brave garçon comme l'épicier Polycarpe, le pauvre... Il te faut quelque marquis, n'est-ce pas?
Dona Placida me jura qu'elle ne visait pas si haut. Question de caractère: elle voulait être mariée. Elle savait fort bien que sa mère n'avait pas fait tant de façons, et elle connaissait plusieurs femmes qui vivaient avec un seul homme d'une façon irréprochable; mais elle voulait être mariée. Et ce qu'elle exigeait pour elle, elle l'exigeait aussi pour sa fille. Elle travaillait sans répit, se brûlait les doigts aux casseroles, les yeux à la lampe, pour vivre sans faiblir. Elle maigrit; elle tomba malade; elle perdit sa mère qui fut enterrée par la générosité publique, et elle continua de travailler. Sa fille atteignit l'âge de quatorze ans; elle était de constitution faible, et passait son temps à se laisser faire la cour par les fainéants du voisinage. Dona Placida l'entourait de sa surveillance, et l'emmenait avec elle quand elle allait porter son ouvrage dans les magasins, dont le personnel clignait de l'œil en pensant qu'elle lui cherchait un mari ou autre chose. On lui faisait des compliments de plus ou moins bon goût. Elle reçut même des propositions.
Elle s'interrompit un instant et continua:
—Ma fille s'est enfuie avec un individu dont je veux ignorer jusqu'au nom. Elle me laissa seule, et si triste que je pensai mourir. Je n'avais plus personne au monde; je n'étais plus jeune et ma santé s'était affaiblie. Ce fut à cette époque que je connus la famille de Yaya. Ces bonnes gens me donnèrent du travail, et je finis par habiter chez eux. J'y restai plusieurs mois, un an, plus d'un an même, à coudre pour eux. Je sortis de là après le mariage de Yaya. Depuis j'ai vécu comme il a plu au ciel. Voyez mes doigts, voyez mes mains... Et elle me montrait ses mains rugueuses et la pointe des doigts tout piqués au contact des aiguilles.
—Ces cicatrices-là, Dieu sait comment elles se forment. Heureusement que Yaya m'a protégée, et vous aussi, Docteur... J'avais bien peur de finir au coin de quelque rue, à demander l'aumône...
En prononçant cette dernière phrase, elle eut un frisson. Ensuite elle se reprit et dut se demander s'il était habile de sa part de faire une semblable confidence à l'amant d'une femme mariée. Elle rit d'un air gêné, se traita de sotte s'accusa de «faire des façons» comme disait sa mère, et enfin, lassée de mon silence, elle sortit, me laissant en contemplation devant la pointe de mes bottines.
Si quelqu'un de mes lecteurs a sauté le chapitre précédent, je l'avise qu'il est nécessaire d'en prendre connaissance pour comprendre les réflexions que je fis dès que Dona Placida fut sortie de la salle.
—Ainsi, me dis-je, le sacristain de la cathédrale vit un jour, tandis qu'il servait la messe, entrer une dame qui devait être sa collaboratrice dans l'œuvre de procréation de Dona Placida. Il la revit pendant des semaines, l'aima, et tout en allumant les candélabres aux jours de fête, il lui faisait sans doute du pied sous les chaises. Il lui plut et il s'unirent. De cet échange de banale luxure naquit Dona Placida. Il est à supposer qu'elle ne parlait pas en venant au monde; sinon, elle eût pu dire aux amateurs de ses jours: «Me voici: pourquoi m'avez-vous fait venir?» Et le sacristain et la sacristaine de lui répondre: «Nous t'avons fait venir pour que tu te brûles les doigts aux chaudrons, les yeux à la couture, que tu manges mal ou pas du tout, que tu ailles à l'aventure, malade un jour, bien portante le lendemain, puis de nouveau malade et de nouveau guérie, triste ou désespérée, puis résignée à ton sort, mais toujours les mains au chaudron et les doigts à la couture, jusqu'au moment où tu finiras dans la boue ou sur un lit d'hôpital. Voilà pourquoi nous t'avons fait venir dans un moment de sympathie.»
Brusquement, ma conscience hésita. Elle m'accusa d'avoir fait capituler l'honnêteté de Dona Placida, de l'avoir ravalée à un rôle suspect, après une longue vie de travail et de privations. Le métier d'entremetteuse ne vaut pas mieux que celui de concubine, et c'est à force d'argent et de compromis que j'avais obtenu d'elle ses services. Pendant une dizaine de minutes je ne sus que répondre aux arguments de ma conscience qui m'objectait encore d'avoir mis à profit la nécessité, la gratitude, et la fascination que Virgilia exerçait sur l'ex-couturière. Elle me remémora la résistance de Dona Placida pendant les premiers jours, ses grimaces, ses réticences, ses regards baissés, et ma constance à supporter tout cela pour arriver à la vaincre. Et elle me censura de nouveau avec une vive et nerveuse irritation.
J'avouai qu'il en était ainsi, mais j'alléguai que la vieillesse de Dona Placida était dorénavant à l'abri de la mendicité, ce qui faisait compensation. N'étaient mes amours, et probablement Dona Placida était vouée à la triste fin de tant d'autres créatures humaines. D'où l'on peut conclure que le vice est souvent le fumier de la vertu. Cela n'empêche que la vertu ne soit une fleur saine et parfumée. La conscience fut de mon avis, et j'allai ouvrir la porte à Virgilia.
Virgilia entra souriante et tranquille. Le temps avait emporté ses craintes. Quel charme j'éprouvais, pendant les premiers jours, à la voir survenir toute tremblante et honteuse! Elle arrivait en voiture, le visage couvert d'un voile, enveloppée d'une espèce de manteau qui dissimulait les ondulations de sa taille. La première fois, elle se jeta sur le canapé, rougissante, palpitante, les regards à terre. Et franchement! jamais elle ne me parut si belle; peut-être parce que je me sentais plus flatté dans mon amour-propre.
Maintenant, comme je viens de le dire, c'en était fait de ses craintes et de ses tourments. Nos entrevues en arrivaient à la période chronométrique. L'intensité de l'amour était la même; seulement, la flamme n'était plus agitée comme les premiers jours. C'était maintenant un faisceau de rayons tranquilles et constants, quelque chose comme un mariage.
—Je suis très fâché contre toi, me dit-elle en s'asseyant.
—Pourquoi?
—Parce que nous t'avons attendu hier. Tu m'avais promis la visite, et Damian m'a demandé plusieurs fois si tu ne viendrais pas au moins prendre le thé. Pourquoi n'es-tu pas venu?
J'avais en effet manqué à ma parole, mais la faute en était toute à Virgilia. Questions de jalousie. Cette femme splendide connaissait sa beauté, aimait à s'entendre louer discrètement ou à haute voix. L'avant-veille, chez la baronne, elle avait dansé deux fois avec le même galantin, après avoir écouté ses fadaises dans l'angle d'une croisée. Elle était si infatuée, si enflée, si satisfaite d'elle-même... Quand elle vit entre mes sourcils la ride interrogative et menaçante, elle n'en eut pas le moindre émoi; elle ne devint pas subitement sérieuse. Elle envoya tout simplement promener le muscadin et ses galanteries. Puis elle vint à moi, me prit le bras, m'emmena dans une autre salle, et se plaignit d'être fatiguée et d'un tas d'autres choses, de l'air puéril qu'elle prenait en certaines occasions; et je l'écoutai sans presque lui répondre.
Il m'en coûtait de répondre à sa question, mais enfin je lui drtante le lendemain, puis de nouveau malade et de nouveau guérie, triste ou désespérée, puis résignée à ton sort, mais toujours les mains au chaudron et les doigts à la couture, jusqu'au moment où tu finiras dans la boue ou sur un lit d'hôpital. Voilà pourquoi nous t'avons fait venir dans un moment de sympathie.»
Quelques mois se passèrent, et un certain jour Lobo Neves entra en disant que peut-être il irait prendre le gouvernement d'une province. Je considérai Virgilia qui pâlit. Il s'aperçut de son émotion et lui dit:
—Cette perspective ne paraît pas te sourire, Virgilia.
Elle secoua négativement la tête.
—Pas précisément, dit-elle.
Ils en restèrent là; mais le même soir, Lobo Neves reparla du projet avec un peu plus d'insistance que dans l'après-midi. Deux jours après, il déclara à sa femme que c'était chose faite. Virgilia ne put dissimuler son ennui. Il alléguait les nécessités politiques.
—Je ne saurais refuser ce que l'on me demande. Il y va de notre avenir, de ton blason, mon amour, car j'ai juré que tu seras marquise, et tu n'es même pas baronne. Tu diras que je suis ambitieux; et je le suis en effet. Mais il ne faut pas couper les ailes à mon ambition.
Virgilia ne savait que faire. Le lendemain, je la trouvai qui m'attendait toute triste dans notre petite maison de la Gamboa. Elle avait tout dit à Dona Placida, et celle-ci cherchait à la consoler comme elle pouvait. Je n'étais pas moins abattu.
—Tu nous accompagneras, me dit Virgilia.
—Es-tu folle? tu n'y penses pas!
—Mais alors...
—Il faut renverser ce projet.
—Impossible.
—Il a déjà accepté?
—Il paraîtrait.
Je me levai, je lançai mon chapeau sur une chaise, et je commençai à marcher de long en targe, sans rien trouver. J'avais beau m'efforcer, aucune solution ne se présentait à mon esprit. Enfin je m'approchai de Virgilia, qui était assise, et je lui pris la main. Dona Placida s'en alla à la fenêtre.
—Toute ma destinée est dans cette petite main, lui dis-je. Tu en es responsable. Agis comme tu jugeras devoir le faire.
Virgilia fit un geste de désespoir. J'allai m'accouder à une console en face d'elle, et nous nous tûmes pendant quelques instants. On n'entendait que l'aboiement d'un chien, et je crois aussi la rumeur de l'eau qui venait mourir sur la plage. Comme elle continuait à se taire, je la regardai. Elle tenait les yeux baissés, fixes, amortis, et ses mains étaient croisées sur ses genoux, dans une attitude de suprême angoisse. Dans toute autre occasion, je me serais jeté à ses pieds, pour lui prodiguer mes raisonnements et ma tendresse. Mais cette fois, il fallait la résoudre à l'effort, au sacrifice, à la responsabilité de notre vie commune, et par conséquent l'abandonner à elle-même. C'est ce que je fis.
—Je le répète, dis-je, notre bonheur est entre tes mains.
Virgilia voulut me retenir, mais j'avais déjà franchi la porte. J'entendis encore un bruit de sanglots, et j'avoue que je fus sur le point de revenir, pour essuyer ses larmes sous mes baisers. Mais je me dominai, et je partis.
Je n'en finirais pas si je voulais conter tout au long ce que je souffris pendant les premières heures. J'oscillais entre des impulsions diverses. La pitié me poussait à aller trouver Virgilia, et un autre sentiment, l'égoïsme, peut-être, m'ordonnait de rester. Ces deux forces avaient, je crois, la même intensité; elles m'investissaient en même temps et se faisaient équilibre, avec une égale ardeur, et aucune ne cédait définitivement. Parfois, je sentais une pointe de remords. Il me semblait que j'abusais de la faiblesse d'une femme aimante et coupable, sans rien risquer de moi-même. Mais quand je me sentais prêt à capituler, l'amour revenait avec ses conseils égoïstes, et je demeurais irrésolu et inquiet, désireux de la voir, et craignant que sa vue ne me poussât à partager avec elle la responsabilité de la solution.
Je trouvai enfin un moyen terme entre l'égoïsme et la pitié. J'irais la voir chez elle, rien que chez elle, sans qu'il me soit possible de lui parler, et dans l'attente de l'effet de mon intimation. De la sorte, je jugeais pouvoir concilier les deux forces. Mais en écrivant ces lignes, je vois bien que cette compromission était une farce, et que la pitié était encore une forme de l'égoïsme, et que ma résolution d'aller consoler Virgilia n'était, au fond, qu'une suggestion de ma propre souffrance.
Le jour suivant, dans la soirée, j'allai effectivement chez Lobo Neves. Je le trouvai en gaîté et Virgilia, la mine sombre. Je jurerais qu'elle se sentit consolée quand nos regards se croisèrent, brillants de curiosité et humides de tendresse. Lobo Neves me conta les plans qu'il avait formés pour sa présidence, m'exposa les difficultés locales, ses espérances et ses résolutions. Il était si content, si rempli d'espérances. Virgilia feignit de lire un livre, auprès la table, mais par-dessus la page, elle me regardait de temps à autre, interrogative et anxieuse.
—Le plus triste, me dit tout à coup Lobo Neves, c'est que je n'ai pas encore trouvé de secrétaire.
—Non?
—Non; et il m'est venu une idée.
—Ah!
—Une idée... Que diriez-vous d'une promenade dans le Nord?
Je ne sais trop ce que je lui répondis.
—Vous êtes riche, continua-t-il. Vous n'avez point besoin d'un maigre salaire. Mais vous me feriez plaisir en m'accompagnant comme secrétaire.
Mon esprit fit un saut en arrière, comme s'il eût découvert un serpent devant lui. Je regardai Lobo Neves, fixement, impérieusement, cherchant à découvrir en lui quelque pensée occulte... Mais non: son regard venait droit et franc, la tranquillité de son visage n'avait rien de forcé; elle était assaisonnée d'allégresse. Je respirai, et n'eus pas le courage de regarder du côté de Virgilia. Je sentis son regard qui me suppliait par-dessus les pages, et je répondis que oui, que j'étais prêt à l'accompagner. En vérité, un président une présidente, un secrétaire, c'était résoudre le problème d'une façon administrative.
Pourtant, dès que je me trouvai dehors, j'hésitai. Je me demandai si je n'allais pas exposer d'une façon insensée la réputation de Virgilia, et s'il n'y avait pas d'autre moyen de concilier l'État et la Gamboa. Je ne trouvai rien. Le lendemain, au saut du lit, mon parti était pris d'accepter la nomination. À midi, le domestique vint me dire qu'une dame, couverte d'un voile, m'attendait dans le salon. J'y courus; c'était ma sœur Sabine.
—Les choses ne sauraient durer comme elles vont me dit-elle; une fois pour toutes, faisons la paix. Notre famille disparaît peu à peu; il n'est que temps de nous réconcilier.
—Je ne demande pas mieux, m'écriai-je en lui ouvrant les bras.
Je m'assis à côté d'elle; je lui parlai de son mari, de sa fille, de leurs affaires, de tout. Elle éfemme, j'avais la confiance du mari; tous les deux m'emmenaient comme secrétaire, et je me réconciliais avec les miens. Que pouvais-je désirer de plus en vingt-quatre heures?
Ce jour-là même, pour tâter l'opinion, je commençai à répandre le bruit de mon prochain départ pour le Nord, en qualité de secrétaire du président d'une province, afin de réaliser certains projets politiques que j'avais en vue. J'en parlai rue d'Ouvidor, et le jour suivant au Pharoux et au théâtre. Des gens établissant une corrélation entre ma nomination et celle de Lobo Neves, qui était déjà dans l'air, souriaient malicieusement ou me battaient sur l'épaule. Au théâtre une dame me dit que c'était pousser bien loin l'amour de la sculpture, faisant ainsi allusion à la plastique de Virgilia. Mais l'allusion la plus transparente fut faite trois jours plus tard chez Sabine, par un vieux chirurgien, nommé Garcez, petit de taille, trivial et bavard, qui aurait pu atteindre à soixante-dix, à quatre-vingts, à quatre-vingt-dix ans, sans jamais acquérir cette dignité austère qui est le charme des vieillards. La vieillesse ridicule est sans doute la dernière, mais aussi la plus triste des surprises de notre humanité.
—Je sais que cette fois-ci vous allez vous mettre à traduire Cicéro, me dit-il en apprenant mon voyage.
—Cicéro! s'écria Sabine.
—Mais oui, votre frère est un excellent latiniste. Il traduit Virgile à la lecture. Remarquez que j'ai dit Virgile et non Virgilia... Ne confondons pas.
Et il riait d'un gros rire, bas et frivole. Sabine me regarda; elle craignait quelque réplique de ma part; quand elle me vit sourire, elle fit de même et se détourna pour cacher son geste. Les autres personnes présentes me considéraient avec indulgence et sympathie. Il était clair qu'on ne leur avait rien appris qu'ils ne sussent de longue date. Mes amours étaient bien plus connues que je ne pouvais le supposer. Et pourtant je souris, d'un sourire court, fugitif et bavard comme les pies de Cintra. Virgilia était une belle faute, et rien n'est plus facile à confesser. Au commencement, je prenais une mine renfrognée, quand on y faisait allusion. Mais en réalité je sentais au dedans de moi une impression suave et flatteuse. Une fois pourtant, il m'arriva de sourire, et je continuai dans la suite. Comment expliquer ce phénomène? Pour moi je ne trouve qu'une explication plausible: tout d'abord, mon contentement, étant intérieur, était pour ainsi dire en bourgeon. Avec le temps il s'épanouit en une fleur, et apparut aux yeux de tous. Simple question de botanique.
Laissons dire les hypocondriaques: la vie est une douce chose. C'est ce que je pensais en voyant Sabine, son mari et sa fille, descendre en débandade les escaliers, tout en faisant monter vers moi de douces paroles et que j'en faisais descendre d'autres jusqu'à eux. Je continuai à me sentir heureux. J'aimais une femme, j'avais la confiance du mari; tous les deux m'emmenaient comme secrétaire, et je me réconciliais avec les miens. Que pouvais-je désirer de plus en vingt-quatre heures?
Ce jour-là même, pour tâter l'opinion, je commençai à répandre le bruit de mon prochain départ pour le Nord, en qualité de secrétaire du président d'une province, afin de réaliser certains projets politiques que j'avais en vue. J'en parlai rue d'Ouvidor, et le jour suivant au Pharoux et au théâtre. Des gens établissant une corrélation entre ma nomination et celle de Lobo Neves, qui était déjà dans l'air, souriaient malicieusement ou me battaient sur l'épaule. Au théâtre une dame me dit que c'était pousser bien loin l'amour de la sculpture, faisant ainsi allusion à la plastique de Virgilia. Mais l'allusion la plus transparente fut faite trois jours plus tard chez Sabine, par un vieux chirurgien, nommé Garcez, petit de taille, trivial et bavard, qui aurait pu atteindre à soixante-dix, à quatre-vingts, à quatre-vingt-dix ans, sans jamais acquérir cette dignité austère qui est le charme des vieillards. La vieillesse ridicule est sans doute la dernière, mais aussi la plus triste des surprises de notre humanité.
—Je sais que cette fois-ci vous allez vous mettre à traduire Cicéro, me dit-il en apprenant mon voyage.
—Cicéro! s'écria Sabine.
—Mais oui, votre frère est un excellent latiniste. Il traduit Virgile à la lecture. Remarquez que j'ai dit Virgile et non Virgilia... Ne confondons pas.
Et il riait d'un gros rire, bas et frivole. Sabine me regarda; elle craignait quelque réplique de ma part; quand elle me vit sourire, elle fit de même et se détourna pour cacher son geste. Les autres personnes présentes me considéraient avec indulgence et sympathie. Il était clair qu'on ne leur avait rien appris qu'ils ne sussent de longue date. Mes amours étaient bien plus connues que je ne pouvais le supposer. Et pourtant je souris, d'un sourire court, fugitif et bavard comme les pies de Cintra. Virgilia était une belle faute, et rien n'est plus facile à confesser. Au commencement, je prenais une mine renfrognée, quand on y faisait allusion. Mais en réalité je sentais au dedans de moi une impression suave et flatteuse. Une fois pourtant, il m'arriva de sourire, et je continuai dans la suite. Comment expliquer ce phénomène? Pour moi je ne trouve qu'une explication plausible: tout d'abord, mon contentement, étant intérieur, était pour ainsi dire en bourgeon. Avec le temps il s'épanouit en une fleur, et apparut aux yeux de tous. Simple question de botanique.
Cotrim m'arracha à ces agréables pensées en m'emmenant dans l'embrasure de la fenêtre. «Voulez-vous un conseil? me dit-il, n'entretenez pas ce voyage: ce serait insensé et périlleux.
—Pourquoi?
—Ne faites pas l'ignorant. Ce serait dangereux, fort dangereux. Ici, dans la capitale, une intrigue comme la vôtre disparaît dans la multitude des intérêts et des gens. Mais en province, le cas est autre. Quand il s'agit de personnages politiques, il se complique encore. Les journaux de l'opposition s'empareront de l'aventure, dès qu'ils en auront vent; on en fera des gorges chaudes, on vous tournera en ridicule.
—Mais je ne comprends pas bien...
—Eh! si, vous comprenez fort bien. Vraiment, il serait étrange que vous niiez, à nous, qui sommes vos amis, ce que les indifférents n'ignorent pas. Voilà des mois que l'on m'a mis au courant. Encore une fois, abstenez-vous de ce voyage. Supportez l'absence, cela vaudra mieux. Vous éviterez un grand scandale et vous vous épargnerez bien des ennuis.»
Cela dit, il s'éloigna. Je demeurai, les yeux fixés sur le quinquet du coin de rue, un vieux lampion à huile, triste, obscur et recourbé comme un point d'interrogation. Que faire? C'était le cas d'Hamlet: ou lutter contre la fortune et la soumettre, ou m'incliner devant elle. En d'autres termes: embarquer ou ne pas embarquer, telle était la question. Le quinquet ne répondait point. Les paroles de Cotrim résonnaient dans mon souvenir, d'une façon bien différente de celles de Garcez. Peut-être Cotrim avait-il raison, mais pouvais-je me séparer de Virgilia?
Sabine s'approcha de moi, et me demanda à quoi je pensais.
—À rien, lui répondis-je; j'ai sommeil et Je vais dormir.
Elle me contempla quelques instants en silence:
—Je sais bien ce qu'il te faudrait, me dit-elle. Tu as besoin de te marier. Laisse-moi faire, je vais te trouver une jeune fille qui fasse ton affaire...
Je sortis de là, triste et désorienté. Tout en moi était prêt au voyage: l'esprit et le cœur. Et voilà que surgit devant moi le portier des convenances qui se refuse à me laisser embarquer sans que j'exhibe mon passage. J'envoyai au diable les convenances, et avec elles la constitution, le corps législatif, le ministère, tout enfin.
Le lendemain, j'ouvre un journal politique et j'y lis que, par décrets du 13, Lobo Neves et moi avions été nommés, respectivement, président et secrétaire pour la province de ***. J'envoyai immédiatement un mot à Virgilia, et deux heures après, j'allai me rencontrer avec elle à la Gamboa. Pauvre Dona Placida! elle était chaque fois plus triste. Elle me demanda si nous oublierions notre vieille amie, si la province était éloignée, si nous y demeurerions longtemps. Je la consolai de mon mieux; mais moi-même j'avais besoin d'être réconforté. L'objection de Cotrim me poursuivait. Virgilia survint au bout d'un instant, légère comme une hirondelle. Mais en me voyant tout morose, elle changea de visage.
—Qu'y a-t-il?
—J'hésite, je ne sais trop si je dois accepter.
Virgilia, prise d'un fou rire, se laissa aller sur le canapé.
—Pourquoi? dit-elle.
—C'est braver l'opinion...
—Mais puisque nous ne partons plus.
—Comment ça!
Elle me dit alors que son mari allait refuser la nomination, pour un motif qui lui avait été confié sous toute réserve. «C'est puéril, lui avait-il dit, c'est ridicule, en somme, mais pour moi, la raison que j'ai de rester est puissante.» Le décret était signé du 13, et ce nombre lui rappelait de tristes souvenirs. Son père était mort un 13! treize jours après un dîner où se trouvaient treize personnes! La maison où sa mère était morte portait le numéro 13; etc. C'était un nombre fatidique. Une pouvait donner une semblable raison au ministre; il alléguerait des motifs personnels. Je demeurai assez surpris, comme doit l'être le lecteur, de ce sacrifice à un nombre, sacrifice qui devait être sincère, étant donnée l'ambition de Lobo Neves.
Ô nombre fatidique, combien de fois ne t'ai-je pas béni! Ainsi durent le bénir les vierges de Thebes, jument à crinière rousse, qu'on leur substitua à l'occasion du sacrifice de Pelopidas, belle jument que l'on immola, couverte de fleurs, sans que personne lui consacrât une parole de regrets. Cette parole, je la prononce, moi, non seulement à cause de ta triste fin, mais parce qu'il n'est pas impossible que, parmi les vierges sauvées par toi, il se trouvât une ancêtre des Cubas. Nombre fatidique, nous te dûmes le salut. Le mari se garda bien de m'avouer la cause de son refus. Il me dit aussi qu'il avait ses motifs particuliers, et l'air sérieux, convaincu, avec lequel je l'écoutai fait honneur à la dissimulation humaine. Il cachait mal son ennui. Il parlait peu, s'enfermait chez lui, passait le temps à lire. D'autres fois, il ouvrait les portes, causait et riait avec affectation. Il souffrait doublement. Son ambition lui reprochait ses scrupules; il hésitait; peut-être se repentait-il; mais si l'alternative s'était représentée, il eut agi la seconde fois comme la première dans sa superstition invétérée. Il doutait de cette superstition sans pouvoir s'en dépêtrer. Cette persistance d'un sentiment, odieux à l'individu qui en était la victime, est un phénomène digne de quelque attention. Mais je préfère la parfaite ingénuité de Dona Placida lorsqu'elle avouait qu'elle ne pouvait voir un soulier avec la semelle en l'air, sans le retourner aussitôt.
—Pourquoi?
—Ça porte malheur.
C'était son unique réponse, qui valait pour elle le livre de la Sagesse: «Ça porte malheur». On lui avait appris cela quand elle était enfant et, sans plus ample informé, elle l'acceptait comme article de foi. Au contraire, quand on parlait d'indiquer une étoile avec le doigt, elle savait parfaitement qu'il résulte de ce geste une verrue.
Une verrue ou autre chose, peu importe, pourvu que ce ne soit pas la perte d'un poste de président de province. On tolère une superstition gratuite ou à bon marché. Le cas est plus grave, lorsque cette superstition dérange toute une existence. C'était celui de Lobo Neves, avec, en plus, le doute et la crainte du ridicule. Ajoutez à cela que le ministre ne crut pas aux motifs particuliers. Il attribua le refus de Lobo Neves à des manœuvres politiques; son erreur avait des apparences de vraisemblance. Il battit froid à Lobo Neves, et communiqua sa défiance à ses collègues. Des incidents se produisirent, et avec le temps, le président résignataire tomba dans l'opposition.
Celui qui échappe à un péril aime la vie avec une recrudescence d'intensité. Je me mis à aimer Virgilia avec une ardeur nouvelle après avoir été sur le point de la perdre, et elle fit de même à mon égard. Ainsi la présidence raviva la passion primitive. Ce fut la drogue qui nous rendit plus cher notre amour et lui donna une plus délectable saveur. Pendant les premiers jours après cette aventure nous imaginions à plaisir quelles eussent été les tristesses de la séparation, de part et d'autre, à mesure que l'océan se fût étendu entre nous comme un tissu élastique. Et semblables à des enfants qui se jettent au cou de leurs mères pour fuir d'une simple grimace, nous fuyions le péril supposé en nous jetant aux bras l'un de l'autre.
—Ma bonne Virgilia!
—Mon amour!
—Tu m'appartiens, n'est-ce pas?
—Oh! oui, je suis à toi...
Et c'est ainsi que nous renouâmes notre intrigue, comme la sultane Schéhérazade le fil de ses contes. Ce fut, je crois, le point culminant de notre amour, le sommet de la montagne d'où nous aperçûmes, pendant quelque temps, les vallées de l'est et de l'ouest, et au-dessus de nous, le ciel tranquille et bleu. Ensuite, nous commençâmes à descendre la côte, les mains liées ou détachées l'une de l'autre, mais dans une descente progressive et ininterrompue.
Au revers de la colline, comme je la trouvais un peu différente d'elle-même, l'air un peu fatiguée, peut-être, je lui demandai ce qu'elle avait. Elle se tut, fit un geste d'ennui, de malaise, de fatigue. J'insistai, elle me dit que... Un frisson subtil parcourut tout son corps. Ce fut une sensation forte, rapide, singulière, que je ne jurais fixer sur le papier. Je lui pris les mains, je l'attirai à moi, je l'embrassai sur le front, avec une délicatesse de zéphyr et une gravité d'Abraham. Elle frissonna, me prit la tête entre les mains, me regarda dans les yeux, et me fit une caresse maternelle. Voilà un mystère: laissons au lecteur le temps de le déchiffrer.
À cette époque, il arriva un malheur: Viegas mourut. Il mourut tout à coup, chargé de soixante-dix hivers, suffoquant d'asthme, désarticulé par le rhumatisme, avec une lésion du cœur par-dessus le marché. Ce fut un des fins apréciateurs de notre intrigue. Virgilia fondait de grandes espérances sur ce vieux parent, avare comme un sépulcre; elle comptait bien qu'il laisserait quelque héritage, non pas à elle, mais à son fils. Lobo Neves, s'il nourrissait les mêmes espérances, les étouffait ou tout au moins les dissimulait. Il faut bien le dire, il y avait chez Lobo Neves une certaine dignité fondamentale, une couche de granit, qui résistait au commerce des hommes. Quant aux autres couches plus superficielles, le torrent limoneux de la vie les a emportées. Si le lecteur se souvient du chapitre XXIII, il remarquera que pour la seconde fois je compare la vie à un torrent boueux; mais cette fois, j'ajoute un adjectif: perpétuel. Et Dieu sait la puissance d'un adjectif, principalement dans un pays nouveau et chaud.
C'est une nouveauté dans ce livre que l'étude de la géologie morale de Lobo Neves, et probablement aussi du monsieur qui est en train de me lire. Oui, ces couches du caractère, que la vie altère, conserve ou dissout, ces couches mériteraient qu'on leur consacrât un chapitre, et si je ne l'écris point, c'est pour ne pas allonger cette narration. Je dirai seulement que l'homme le plus honnête que j'ai rencontré dans ma vie fut un certain Jacob Medeiros ou Jacob Valladares, je ne me rappelle plus bien; Jacob Rodriguez je crois: enfin Jacob. C'était la probité en personne. Il aurait pu devenir riche; il lui eût suffi de vaincre un petit scrupule; il ne voulut pas; et il laissa échapper quatre cents contos, ce qui est un joli denier. Sa probité était tellement exemplaire, qu'elle en arrivait à être minutieuse et fatigante. Un jour que nous nous trouvions chez lui en tête à tête, et causant allègrement, on vint lui dire que le Dr B..., qui n'était pas amusant tous les jours, demandait à le voir. Jacob fit répondre qu'il n'y était pas.
—Ça ne prend pas, cria une voix dans le corridor; je suis déjà dans la place.
C'était effectivement le Dr B... qui apparut à la porte du salon. Jacob alla à sa rencontre, en affirmant qu'il avait entendu le nom d'une autre personne, car il avait le plus grand plaisir à le voir. Ces protestations nous valurent une heure d'ennui mortel. Jacob tira sa montre de sa poche, et le Dr B... lui demanda s'il allait sortir.
—Avec ma femme, dit Jacob.
B... s'en alla, et nous respirâmes. Quand nous eûmes fini de respirer, je dis à Jacob qu'il venait de mentir quatre fois, en moins de deux heures: d'abord en faisant dire qu'il n'y était pas, ensuite en feignant une trompeuse allégresse; troisièmement en disant qu'il allait sortir; quatrièmement en ajoutant: «avec ma femme». Jacob réfléchit un instant; ensuite il se rendit à la justesse de mon observation; mais il s'excusa en disant que la véracité absolue est incompatible avec un état social avancé, et que la paix d'une cité civilisée ne se peut obtenir que par des mensonges réciproques... Ah! je me rappelle, maintenant: il s'appelait Jacob Tavares.
Point n'est besoin de dire que je réfutai cette pernicieuse doctrine par les plus élémentaires arguments. Mais il était tellement vexé de mon observation qu'il résista jusqu'à la fin, avec une certaine véhémence, peut-être pour calmer sa conscience.
Le cas de Virgilia était un peu plus grave; elle était moins scrupuleuse que son mari; elle manifestait clairement les espérances qu'elle couvait au sujet de l'héritage; elle comblait son parent d'aménités, elle l'entourait de tous les petits soins capables de mériter au moins un codicille. Enfin, elle l'adulait; mais j'ai remarqué que l'adulation des femmes est différente de celle des hommes. L'une va jusqu'à la servilité; l'autre se confond avec l'affection. Les courbes gracieuses, les douces paroles, la faiblesse physique même de la femme, donnent à sa flatterie une couleur locale, un aspect légitime. Peu importe l'âge de celui qui en est l'objet; la femme aura toujours pour lui des airs de mère ou de sœur,—ou encore d'infirmière, autre office féminin, pour lequel il manquera toujours à l'homme un quid, un fluide, un je ne sais quoi.
C'est ce que je me disais en moi-même, tandis que Virgilia entourait le vieux parent de petits soins. Elle allait le recevoir à l'entrée, bavardeuse et souriante, elle lui prenait des mains sa canne et son chapeau et lui offrait le bras pour l'accompagner jusqu'à un fauteuil, ou plutôt jusqu'à son fauteuil, car il y avait chez elle la «chaise de Viegas», meuble spécial, dorloteur, à l'usage de convalescents ou de vieillards. Ensuite, selon la chaleur ou la brise, elle allait fermer ou bien ouvrir la fenêtre, avec toutes sortes de précautions, pour qu'il ne se trouvât pas dans un courant d'air.
—Alors, ça va mieux, aujourd'hui.
—Non, j'ai mal passé la nuit: ce diable d'asthme ne me quitte pas.
Et il soufflait en se remettant peu à peu des fatigues de l'entrée et de la montée des escaliers, car, en ce qui concerne la promenade, il la faisait toujours en voiture. Virgilia s'asseyait ensuite sur un tabouret, tout près du malade et les mains sur les genoux de celui-ci. Sur ces entrefaites, Nhônhô faisait son entrée dans le salon, non pas en gambadant à sa manière habituelle, mais discret, tendre et sérieux. Viegas l'aimait beaucoup.
—Viens ici, Nhônhô, disait-il; et introduisant avec effort sa main dans son ample poche, il en tirait une petite boîte de pastilles, en mettait une dans sa bouche, et donnait l'autre à l'enfant. Des pastilles antiasthmatiques: le petit disait qu'il les trouvait fort bonnes.
À chaque visite, c'était le même cérémonial aux variantes près. Viegas aimait à jouer aux dames, et Virgilia lui faisait la partie, sans impatience, tandis qu'il remuait les pions de sa main lente et tremblante. D'autres fois, il descendait à son bras dans le jardin; il lui arrivait même de refuser l'aide de Virgilia, pour faire le brave; et il déclarait alors qu'il était capable d'aller ainsi pendant une lieue. On marchait, on s'asseyait, on reprenait la promenade, en causant de choses et d'autres, parfois d'une affaire de famille, d'autres fois d'un racontage de salon, enfin d'une maison qu'il voulait faire construire, pour y demeurer. Il la voulait d'un style moderne, la sienne étant d'un type démodé, contemporaine du roi Dom João VI, et comme on en rencontre, je crois, encore aujourd'hui dans le quartier de S. Christovão, avec leurs grosses colonnes de face. Pour substituer cette vieille bâtisse, il avait déjà demandé le plan d'une autre à un entrepreneur en renom. C'est alors que Virgilia pourrait se convaincre que son vieil ami avait du goût.
Il parlait, comme on pense, lentement et avec peine, soufflant dans les intervalles, d'une façon gênante pour lui et pour les autres. Parfois il lui Venait un accès de toux. Courbé, gémissant, il portait le mouchoir à sa bouche et en inventoriait ensuite le contenu. L'accès passé, il revenait au plan de sa future maison, qui aurait telle et telle chambre, une terrasse, une écurie. Ce serait un bijou.
Demain, j'irai passer la journée chez Viegas me dit-elle un jour. Le pauvre! il n'a personne.
Viegas s'était alité, définitivement. Sa fille, qui était mariée, était justement tombée malade en même temps que lui, de sorte qu'elle ne pouvait lui tenir compagnie. Virgilia, de temps à autre, allait le voir. Je profitai de cet événement pour passer toute la journée auprès d'elle. J'arrivai vers deux heures. Viegas toussait de telle sorte qu'il me faisait mal à ma poitrine. Dans l'intervalle des accès, il débattait le prix d'une maison avec un individu maigre qui offrait trente contos de l'immeuble, tandis que Viegas en voulait quarante. L'acheteur insistait comme quelqu'un qui a peur de manquer le train. Mais Viegas ne cédait point. Il refusa d'abord les trente contos puis trente-deux, puis trente-trois, enfin il eut un fort accès de toux qui lui coupa la parole Pendant un quart d'heure. L'acheteur lui vint en aide, l'installa sur les coussins, et lui offrit trente-six contos.
—Jamais, gémit le malade.
Il envoya chercher une liasse de papiers dans son secrétaire; n'ayant plus la force nécessaire pour retirer l'élastique qui entourait le rouleau, il me pria de le faire. C'étaient les comptes des dépenses de construction de l'immeuble: comptes du maçon, du charpentier, du peintre; comptes du papier pour la salle à manger, pour le salon, pour les chambres à coucher, pour le cabinet de travail; comptes de ferrages, prix d'achat du terrain. Il les déployait, un à un, d'une main tremblante; puis il me demandait de les lire, et je les lisais.
—Voyez, mille deux cents, du papier à mille deux cents reis la pièce. Charnières françaises... Voyez: c'est pour rien, conclut-il après avoir lu le dernier compte.
—Fort bien... mais...
—Quarante contos; vous ne l'aurez pas pour moins. Rien que les intérêts: faites un peu le compte des intérêts...
Ces paroles sortaient avec la toux, par lambeaux, par syllabes, et donnaient l'impression de parcelles d'un poumon déchiqueté. Au fond des orbites, des yeux luisants roulaient, me rappelant la lueur d'une veilleuse hésitante aux approches du matin. Sous le drap, l'ossature du corps se dessinait, saillante aux genoux et aux pieds; la peau, jaune, flasque, rugueuse, suivait les contours d'un crâne décharné et sans expression. Un bonnet de coton lui couvrait le crâne poli parle temps.
—Eh bien? dit l'individu maigre.
Il lui fît signe de ne pas insister, et celui-ci se tut pendant quelques instants. Le malade fixait le toit, silencieux, suffoquant. Virgilia pâlit, se leva, alla à la fenêtre. Elle avait peur de la mort. Je parlai d'autres choses. L'individu maigre conta une anecdote et revint à sa proposition, en renchérissant.
—Trente-huit contos, dit-il.
—Jam...! gémit le malade.
L'individu maigre s'approcha du lit, prit la main du moribond; elle était froide. Je m'approchai à mon tour; je lui demandai s'il se sentait mal, s'il voulait prendre un petit verre de vin.
—Non... non... quar... quaran... quar... quar...
Il fut pris d'un nouvel accès de toux, qui fut le dernier. Au bout d'un instant, il expira, à la grande consternation de l'individu maigre. Celui-ci m'avoua ensuite qu'il eût donné les quarante contos; mais il était trop tard.
Rien: pas un souvenir testamentaire, pas une pastille, rien qui vînt démontrer la gratitude ou le simple souvenir du défunt; rien. Virgilia ne put digérer cette déconvenue, et elle me le confessa avec une certaine réserve, motivée non par la chose en elle-même, mais parce qu'il s'agissait indirectement de son fils, que je n'aimais guère ou même pas du tout. Je lui dis de n'y plus penser. Le mieux était d'oublier le défunt, vieux grigou sans nom, et parler de choses gaies: de notre fils par exemple...
Allons! bon! j'ai laissé échapper le secret, le doux secret que Virgilia m'avait confié quelques semaines auparavant, lorsque je l'avais trouvée un peu différente d'elle-même. Un fils! un être sorti de mon être. C'était ma préoccupation exclusive depuis ce temps. Considérations sociales, jalousie du mari, mort de Viegas, rien ne m'intéressait, pas plus que les conflits politiques, les révolutions, les tremblements de terre, rien. Je ne pensais qu'à l'embryon anonyme, de filiation obscure, et une voix secrète me disait: «C'est ton fils.» Mon fils! Et je répétais ces deux mots avec une certaine volupté indéfinissable, et je ne sais quel suprême orgueil. Je me sentais homme.
Le plus intéressant, c'est que nous causions tous les deux, l'embryon et moi, et que nous parlions de choses présentes et futures. Le petit diable était charmant; il m'aimait déjà; il me donnait de petites tapes sur la face avec ses mignonnes mains grassouillettes, ou bien encore il portait la toque et la robe des avocats, car il serait avocat; et il faisait un discours à la Chambre des députés. De là, il revenait à l'école, et portait son ardoise et ses livres sous son bras; de nouveau je le revoyais au berceau, d'où il se levait avec une stature d'homme. En vain je cherchais à le fixer dans mon esprit dans une attitude et à un âge déterminé. Il avait à mes yeux tous les âges et toutes les attitudes. Il tétait, il écrivait, il valsait, il était interminable dans les limites d'un court quart d'heure: baby et député, collégien et jeune homme à la mode. Parfois, aux pieds de Virgilia, je me laissais distraire, et elle me reprochait mon silence. Elle me disait que je ne l'aimais plus. C'est qu'alors j'étais en train de converser avec l'embryon, je renouvelais le vieux colloque d'Adam et de Caïn, un dialogue sans paroles, entre la vie et la vie, le mystère et le mystère.
À peu près à la même époque, je reçus une lettre extraordinaire, accompagnée d'une lettre non moins extraordinaire. Voici ce qu'elle disait:
Mon cher Braz Cubas,
Il y a quelque temps, au jardin public, je me suis permis de vous emprunter votre montre; j'ai le plaisir de vous la restituer. Il faut pourtant faire une restriction: ce n'est pas tout à fait la même; mais celle que vous recevrez est au moins aussi bonne que l'autre. «Que voulez-vous, Monseigneur», comme disait Figaro, «c'est la misère». Bien des choses se sont passées depuis notre rencontre. J'irai vous les raconter, si vous ne me fermez pas votre porte. Sachez que je ne porte plus ces bottines caduques, et que je n'exhibe plus cette fameuse redingote, dont les pans se perdaient dans la nuit des temps. J'ai cédé à une autre marche de l'église de S. Francisco. Et je déjeune maintenant avec régularité.
Ceci dit, je vous demande la permission d'aller, un de ces jours, vous lire un travail, fruit de longues études, un nouveau système de philosophie, qui, non seulement explique et décrit l'origine et la fin des choses, mais qui encore passe de beaucoup Zénon et Sénèque, dont le stoïcisme n'est que bagatelle auprès de ma recette morale. Car mon système est prodigieux: il rectifie l'esprit humain, supprime la douleur, donne le bonheur, et couvre de gloire notre cher pays. Je l'appelle Humanitisme, de Humanitas, commencement des choses. Ma première intention révélait une excessive infatuation: je voulais l'appeler Borbisme, de Borba, dénomination aussi vaniteuse que rude à l'oreille. Et d'ailleurs, elle disait moins. Vous verrez, mon cher Braz Cubas, vous verrez que c'est véritablement un monument. Et si quelque chose peut me faire oublier les tristesses de la vie, c'est d'avoir enfin trouvé la vérité et le bonheur. Les voici donc dans la main de l'homme, ces deux fugitives! après tant et tant de siècles de luttes, de recherches, de découvertes, de systèmes et de désillusions, les voici dans la main de l'homme. À bientôt, donc, mon cher Braz Cubas. Bons souvenirs du vieil ami,
JOAQUIM BORBA DOS SANTOS.
Je lus cette lettre, sans la bien comprendre. Elle était accompagnée d'un écrin contenant une belle montre avec mes initiales gravées, et cette dédicace: «Souvenir du vieux Quincas». Je repris la lettre, je la relus en la ponctuant et en la méditant. La restitution de la montre excluait toute idée de mauvaise plaisanterie. La lucidité, la conviction, un peu prétentieuse il est vrai, paraissaient exclure toute présomption de folie. Naturellement, Quincas Borba avait hérité de quelqu'un de ses parents de Minas, et le bien-être l'avait rendu à sa dignité première. C'est peut-être excessif. Il y a des choses que l'on ne retrouve jamais intégralement, mais enfin, il n'était pas impossible qu'il se fût régénéré. Je gardai la lettre et la montre, et j'attendis la philosophie.
Il est temps que j'en finisse avec les choses extraordinaires. Je venais de mettre de côté la lettre et la montre, quand je reçus la visite d'un homme maigre et commun, porteur d'une lettre de mon beau-frère qui m'invitait à dîner. Le messager était marié avec une sœur de Cotrim, et il arrivait du Nord. Il s'appelait Damasceno, et avait fait le coup de feu pendant la révolution de 1831. Lui-même me raconta tout cela dans l'espace de cinq minutes. Il était parti de Rio à la suite d'un désaccord avec le régent, qui était un âne, un peu moins âne que les ministres qui servirent sous sa direction. D'ailleurs nous étions à la veille d'une autre révolution. À ce point de vue, et quoique ses idées fussent un peu brouillées, je devinai quel était le gouvernement de sa prédilection: un despotisme tempéré, non par des chansons, comme dit l'autre, mais par les panaches de la garde nationale. Je ne pus tout de même deviner s'il préférait le despotisme d'un seul au despotisme de trois, de trente ou de trois cents, Il opinait pour le développement de la traite, et l'expulsion des Anglais. Il aimait beaucoup le théâtre et aussitôt après son arrivée, il était allé au S. Pedro voir représenter un drame superbe, Marie-Jeanne, et une intéressante comédie, Kettly, ou le Tour de Suisse. Il avait aussi beaucoup aimé la Deperini dans Sapho ou Anna Bolena, il ne se souvenait plus bien. Et la Gandiani!... celle-là oui!... Il brûlait d'envie d'entendre Ernani, que sa fille chantait, en s'accompagnant au piano: Ernani, Ernani, involami... Et ce disant, il se levait et commençait à chantonner. Tout cela n'arrivait dans le Nord que comme un vague écho. Sa fille avait un grand désir d'entendre ces opéras! Elle avait une si jolie voix; et un goût! un goût! Quel délice de se retrouver à Rio. Il avait déjà parcouru toute la ville avec une avidité!... Que de souvenirs il y retrouvait! Parole!... en revoyant certains spectacles, les larmes lui montaient aux yeux. Mais jamais plus il ne remettrait le pied à bord. Il avait eu le mal de mer, comme tous les passagers du reste, à l'exception d'un Anglais. Que le diable emporte les Anglais! On ne fera rien qui vaille sans les expédier tout d'abord. Qu'est-ce que l'Angleterre pouvait bien nous faire? Qu'il trouvât quelques personnes de bonne volonté, et en une seule nuit, il se chargeait de l'expulsion de tous ces godemes... Grâce au ciel, il était patriote,—et il se battait la poitrine,—rien d'étonnant à cela; ça tenait de famille: il descendait d'un ancien capitaine très chauvin. Non, certes, il n'était pas le premier venu, et l'occasion échéante, il montrerait bien de quel bois se chauffent les gens tels que lui. Mais il se faisait tard: il était seulement venu me dire qu'on m'attendait sans faute à dîner. Nous aurions alors l'occasion de reprendre la conversation interrompue... Je le reconduisis jusqu'à la porte du salon. Il se retourna pour me dire qu'il sympathisait beaucoup avec moi. Je me trouvais en Europe à l'époque de son mariage. Il avait connu mon père, qui était un fier gaillard, et il s'était trouvé avec lui dans un bal fameux à Praia Grande... Il avait tant de choses à me dire! Mais nous nous retrouverions plus tard, car il était pressé de rapporter ma réponse à Cotrim. Il partit; je fermai la porte sur son dos.
Quel supplice, ce dîner!... Heureusement que Sabine me donna pour voisine de table la fille de Damasceno, Mlle Eulalia ou plus familièrement Nha-lolo, jeune fille gracieuse et seulement un peu timide de prime abord. Elle était sans élégance, mais ses yeux superbes faisaient compensation. Ils n'avaient qu'un tort, celui de ne se détacher de moi que pour s'abaisser sur son assiette. Et Nha-lolo mangeait très peu... Après dîner, elle chanta. Sa voix était suave. Nonobstant le charme, je pris congé. Sabine m'accompagna jusqu'à la porte et me demanda comment je trouvais la fille de Damasceno.
—Comme ci comme ça.
—Extrêmement sympathique, pas vrai? Il lui manque un peu l'usage du monde. Mais quel cœur! c'est une perle: ça ferait une si gentille petite femme pour toi.
—Je n'aime pas les perles.
—Entêté! quand te décideras-tu à faire une fin? Tu commences pourtant à être mûr. Eh bien! mon cher, que tu le veuilles ou non, Nha-lolo sera ta femme.
Et ce disant, elle me donnait de petites tapes sur la joue, douce comme une colombe, mais pourtant intimant et résolue. Grand Dieu! était-ce là le motif de la réconciliation? Cette idée me contraria. Mais une voix mystérieuse m'appelait chez Lobo Neves. Je dis adieu à Sabine et à ses menaces.
—Comment allons-nous? ma chère petite maman.
À ces mots, Virgilia fit la moue, comme d'habitude. Elle se trouvait dans l'embrasure d'une croisée, en train de regarder la lune, et elle m'avait reçu gentiment. Mais quand je lui parlai de notre fils, elle fit la moue. Elle n'aimait pas ces allusions; mes caresses paternelles anticipées l'ennuyaient. Je la laissai en paix, car elle était alors pour moi une arche sainte, un vase d'élection. Je supposai d'abord que l'embryon, ce profil de l'inconnu, qui se projetait sur notre aventure, troublait la conscience de Virgilia. Mais non. Jamais elle n'avait été plus expansive, plus à son aise, moins préoccupée des autres et de son mari. Elle ne ressentait aucun remords. Je m'imaginai alors que cette grossesse était une pure invention, un moyen de m'attacher davantage, et dont elle se fatiguait à la longue. L'hypothèse était admissible: ma douce Virgilia mentait parfois avec tant de désinvolture!...
Ce soir-là, je compris qu'elle avait peur du dénouement, et qu'elle trouvait son état gênant. Ses premières couches avaient été laborieuses. Et cette heure cruelle, tissée de minutes de vie et de minutes de mort, lui faisait passer le frisson du condamné. Quant à la gêne, elle se impliquait de la privation de certaines habitudes de vie élégante. Ce devait être cela. Je le lui donnai à entendre, en la grondant un peu, au nom de mon autorité paternelle. Virgilia me regarda; puis elle détourna les regards avec un geste d'incrédulité.
Où donc êtes-vous passées, fleurs du souvenir? Un soir, après quelques semaines de gestation, l'édifice de mes chimères paternelles s'écroula tout à coup. L'embryon s'en fut dans cet état où l'on ne saurait distinguer un Laplace d'une tortue. J'en eus la nouvelle par Lobo Neves. Il me laissa dans le salon, et accompagna le médecin jusqu'à la chambre de la mère frustrée dans ses espérances. Je m'accoudai à la fenêtre, les yeux fixés sur le jardin. J'y vis des orangers sans fleurs. Où donc étaient les fleurs d'antan?
Quelqu'un me toucha l'épaule. C'était Lobo Neves. Nous nous regardâmes un instant, muets et inconsolables. Je demandai des nouvelles de Virgilia; puis nous restâmes une demi-heure à causer. Sur ces entrefaites, on lui apporta une lettre. Il la lut, pâlit, et la ferma d'une main tremblante. Je crois lui avoir vu faire un geste comme s'il prenait son élan vers moi. Mais je n'en suis pas très certain. Par exemple, je me souviens fort bien que les jours suivants, il se montra à mon égard froid et taciturne. Enfin quelque temps après, Virgilia me raconta l'aventure, dans notre refuge de la Gamboa.
Son mari lui avait montré la lettre, dès qu'elle avait été rétablie. C'était un écrit anonyme, qui nous dénonçait. Il ne disait pourtant pas tout, et ne parlait point, par exemple, de nos rendez-vous. On se limitait à le prévenir contre notre intimité et à l'aviser des commentaires qu'elle soulevait. Virgilia lut la lettre avec indignation et s'écria que c'était une calomnie infâme.
—Calomnie? insista Lobo Neves.
—Infâme!...
Le mari respira. Mais il reprit la lettre, et chaque parole semblait faire un signe négatif, chaque lettre protestait contre l'indignation de Virgilia. Lobo Neves, qui était d'ailleurs un homme énergique, devint en ce moment la plus fragile des créatures. Peut-être vit-il en imagination l'opinion publique le fixer d'un regard sarcastique; peut-être une bouche invisible lui répéta-t-elle les railleries qu'il avait entendues ou prononcées naguère en semblable occurrence. Il insista auprès de sa femme pour qu'elle lui confessât tout, lui promettant un ample pardon. Virgilia comprit qu'elle était sauve. Elle s'indigna contre cette insistance, jura qu'elle n'avait jamais entendu de ma bouche que des paroles aimables et courtoises. La lettre anonyme devait être de quelque amoureux évincé. Elle en cita plusieurs: l'un l'avait poursuivie de ses insistances pendant des semaines; l'autre lui avait envoyé un billet. Elle citait des noms, des circonstances, cherchant à lire dans les regards de son mari: et elle termina en disant qu'elle me traiterait de telle sorte que je n'aurais plus envie de revenir.
J'écoutai tout cela un peu troublé, moins par la diplomatie dont il faudrait dorénavant faire preuve pour m'éloigner progressivement de la maison de Lobo Neves qu'en constatant la tranquillité morale de Virgilia, parfaitement exempte d'émotion, de crainte, de regrets et de remords. Virgilia remarqua ma préoccupation, me força à lever la tête, que j'avais penchée vers le sol, et me dit, non sans amertume: «Tu ne mérites pas les sacrifices que je fais pour toi.»
Je ne répondis pas. Il eût été oiseux de lui faire remarquer qu'un peu de désespoir et de terreur eût rendu à nos amours la saveur pimentée des premiers jours. Peut-être y fût-elle arrivée par artifice. Mais je me tus. Elle battait nerveusement le plancher. Je m'approchai d'elle; je la baisai au front. Elle recula comme sous le baiser glacé d'un défunt.
Vous frémissez, lecteur,—ou en tous cas, vous devriez frémir. La dernière phrase a dû vous suggérer plusieurs réflexions. Vous voyez bien le tableau: dans une petite maison de la Gamboa, deux personnes qui s'aiment depuis longtemps; l'une s'incline vers l'autre pour la baiser au front, et l'autre recule comme au contact d'une bouche de cadavre. Dans le bref intervalle qui sépare la bouche du front, avant le baiser et après le baiser, il y a temps pour beaucoup de choses: le ressentiment, la défiance, ou tout simplement la pâle et somnolente salété...
Nous nous séparâmes allègrement. Je dînai, réconcilié avec la situation. La lettre anonyme rendait à notre aventure le sel du mystère et le poivre du péril. Et quelle chance heureuse que Virgilia n'eût point perdu son sang-froid dans cette crise! Le soir, j'allai au théâtre São Pedro. On représentait un grand drame, où Estella faisait couler des pleurs. J'entre, je lance un coup d'œil sur les loges; j'aperçois dans l'une d'elles Damasceno et sa famille. Sa fille était mise avec plus d'élégance, et même avec un certain luxe: chose étonnante, car le père gagnait juste de quoi s'endetter. Et qui sait? peut-être était-ce là le motif.
J'allai leur rendre visite pendant l'entr'acte. Damasceno me reçut avec un flux de paroles, sa femme avec d'innombrables sourires. Quant à Nha-lolo, elle ne cessa plus de me regarder. Je la trouvai mieux que le soir du dîner. Je lui trouvai je ne sais quelle suavité éthérée, qui s'alliait à la beauté des formes terrestres (expression vague, et parfaitement en rapport avec un chapitre où tout doit être également vague). Et vraiment je ne sais comment exprimer ma parfaite béatitude auprès de la jeune fille, dans sa robe de bonne faiseuse, qui me donnait des démangeaisons de Tartuffe. En la voyant couvrir chastement le bas de ses jambes, je fis cette découverte que la nature avait prévu le vêtement, comme une condition nécessaire de la multiplication de l'espèce. La nudité habituelle, étant donnée la multiplicité des occupations et des soins de l'individu, tendrait à alourdir les sens et à retarder les désirs, tandis que le vêtement, en leurrant les sexes, les aiguise et les incite, et fait ainsi progresser l'humanité. Bienheureux usage qui nous a valu Othello et les transatlantiques.
J'ai bien envie de supprimer ce chapitre. La pente est dangereuse. Mais après tout, j'écris mes mémoires et non les tiens, paisible lecteur. Auprès de la gracieuse demoiselle, je me sentais en proie à une sensation double et indéfinissable. Elle exprimait parfaitement la dualité de Pascal: l'ange et la bête, à cette différence près que le janséniste n'admettait point la dualité des deux natures, tandis qu'ici, elles ne faisaient qu'un: l'ange qui disait des choses célestes, et la bête qui... Non, décidément, je supprime ce chapitre.
Dans la salle, je rencontrai Lobo Neves, en train de causer avec quelques amis. Nous parlâmes de choses et d'autres, froidement, mal à l'aise. Mais dans l'entr'acte suivant, un peu avant le lever du rideau, nous nous retrouvâmes dans un corridor où il n'y avait que nous. Il vint à moi avec beaucoup d'affabilité, en souriant, en m'entraînant dans un des pas-perdus, il causa le plus tranquillement du monde. Je lui demandai des nouvelles de sa femme. Il me répondit qu'elle allait bien; puis il dévia la conversation vers des sujets généraux, expansif, presque gai. Devine qui voudra la cause de ces différentes attitudes. Je me dérobe à Damasceno, qui m'épie devant la porte de la loge.
Je n'entendis pas un traître mot de l'acte suivant. Étranger aux tirades des acteurs et aux applaudissements du public, je reconstituais dans mon fauteuil ma conversation avec Lobo Neves; je revoyais ses gestes, et je trouvai ma nouvelle situation enviable. La Gamboa suffisait. Des relations plus visibles ne servaient qu'à fomenter l'envie. Rigoureusement nous pouvions nous dispenser de nous voir journellement. C'était mettre l'absence au service de l'amour. D'ailleurs, à quarante ans sonnés, je n'étais rien, pas même simple électeur. Il était temps de me lancer, quand ce ne serait que pour l'amour de Virgilia, qui s'enorgueillirait de ma gloire... Je crois bien qu'en cet instant on applaudit dans le salle; mais je n'oserais l'affirmer, car je pensais à autre chose.
Ô multitude, dont je désirais l'attention jusqu'à ma mort, c'est ainsi que je me vengeais parfois de toi. Je laissais la foule bruire autour de moi, sans l'entendre, comme le Prométhée d'Eschyle au milieu de ses bourreaux. Ah! tu voulais m'enchaîner sur le rocher de la frivolité, de ton indifférence ou de ton agitation!... Chaînes fragiles, je vous rompais d'un geste de Gulliver. Il est banal d'aller songer dans un hermitage. Le voluptueux s'isole milieu d'un océan de gestes et de paroles de passions nerveuses et tendues. Il y décrète son absence, son indifférence, son inaccessibilité. Qu'importe que l'on dise lorsqu'il revient à lui, c'est-à-dire aux autres, qu'il tombe du monde de la lune? Qu'est-il après tout, ce monde lumineux et caché de notre cerveau, sinon l'affirmation dédaigneuse de notre liberté spirituelle? Vive Dieu! voilà une bonne fin de chapitre.
Si le monde n'était pas composé d'esprits inattentifs, il serait inutile de rappeler au lecteur que les lois que j'affirme sont vraiment indiscutables. Quant aux autres, je les laisse dans le domaine de la probabilité. L'une d'elles fera l'objet de ce chapitre, que je recommande à la lecture des personnes qui s'intéressent aux phénomènes sociaux. Il semble, et ce n'est pas improbable, qu'il existe entre les faits de la vie publique et ceux de la vie privée une certaine action réciproque, régulière et périodique,—ou pour user d'une image, c'est quelque chose qui ressemble aux marées de la plage du Flamengo ou d'autres également houleuses. Quand l'onde envahit le sable, elle le couvre, pour revenir ensuite sur elle-même couvre une force variable, et va grossir la vague nouvelle qui se comportera comme la première. Telle est l'image; voyons-en l'application.
J'ai dit ailleurs que Lobo Neves, nommé président d'une province, avait refusé sa nomination à cause de la date du décret: le 13. Ce fut un acte grave, dont la conséquence fut de séparer du ministère le mari de Virgilia. Ainsi l'antipathie pour un nombre produisit un phénomène de dissidence politique. Il nous reste à apprendre comment, longtemps après, un acte politique détermina dans la vie particulière une cessation de mouvement. La méthode employée dans ce livre ne permet pas de décrire immédiatement cet autre phénomène. Je me limite à déclarer que quatre mois après notre rencontre au théâtre, Lobo Neves se réconcilia avec le ministère. C'est un fait que le lecteur ne devra pas perdre de vue, s'il veut pénétrer toute la subtilité de ma pensée.
Ce fut Virgilia qui me donna des nouvelles de la volte-face de son mari. Un certain matin d'octobre, entre onze heures et midi, elle me parla de réunions, de conversations, d'un discours...
—De sorte que cette fois, te voilà baronne, interrompis-je.
Elle fit la moue en secouant la tête. Mais ce geste d'indifférence était démenti par quelque chose d'indéfinissable, par une expression de plaisir et d'espérance. Je ne sais trop pourquoi je m'imaginais que les lettres de noblesse pourraient la ramener à la vertu, non pas pour la vertu elle-même, mais par gratitude pour son mari. Car elle aimait cordialement la noblesse. Un des troubles les plus sérieux de notre intimité fut l'apparition d'un certain poseur de légation,—disons de la légation de Dalmatie—le comte B. V., qui lui fit la cour pendant trois mois. Ce noble authentique tourna la tête de Virgilia, qui d'ailleurs possédait la vocation diplomatique. Je ne sais trop ce que je serais devenu, sans la révolution de Dalmatie qui renversa le gouvernement et épura les ambassades. La révolution fut sanglante et formidable. Chaque malle d'Europe apportait des journaux qui transcrivaient les horreurs, comptaient les têtes coupées, jaugeaient le sang versé. Tout le monde frémissait d'horreur et de pitié. Moi, non. Je bénissais intérieurement cette tragédie, qui me tirait une épine du pied. Et puis, la Dalmatie est si loin.
Mais cet homme qui se réjouissait du départ d'un autre pratiqua quelque temps après... Non, je ne dirai rien pour l'instant; ce chapitre me reposera de mes ennuis. Une action grossière, basse, sans explication possible... je le répète, je ne conterai rien dans ce chapitre.
—Non, docteur, cela ne se fait pas; excusez ma franchise, mais cela ne se fait pas.
Combien elle avait raison, cette Dona Placida. Quel est l'homme bien élevé qui arrive au rendez-vous de la dame de ses pensées avec une heure de retard? J'entrai tout essoufflé. Virgilia était déjà partie. Dona Placida me conta qu'après avoir longtemps attendu, elle s'était irritée, qu'elle avait pleuré, qu'elle s'était promis de ne plus penser à moi, et un tas d'autres choses que notre hôtesse répétait avec des larmes dans la voix, en me suppliant de ne pas abandonner Yaya, ce qui serait vraiment trop injuste; car elle m'avait tout sacrifié. Je lui expliquai alors qu'un malentendu... Et ce n'en était pas un; il s'agissait tout simplement d'une distraction de ma part, causée par un bon mot, une anecdote, une conversation, n'importe quoi; une simple distraction.
Cette pauvre Dona Placida!... elle était vraiment désespérée. Elle allait de côté et d'autre, branlant la tête, soupirant bruyamment, regardant à travers la croisée. Avec quel art elle attifait, bichonnait et réchauffait notre amour! Quelle imagination fertile, pour nous rendre les heures agréables et brèves! fleurs, petits goûters,—les bons goûters d'un autre temps,—et des rires, et des caresses, rires et caresses qui augmentaient avec le temps, comme si elle voulait fixer notre aventure et lui rendre sa première jeunesse. Elle n'oubliait rien, notre bonne confidente et hôtesse, rien; ni le mensonge, car elle contait de l'un à l'autre des soupirs et des regrets qui n'avaient jamais existé; ni la calomnie, car elle m'attribua un beau jour une passion nouvelle.—«Tu sais bien que je serais incapable d'aimer une autre femme», dis-je à Virgilia quand elle me parla de cette prétendue infidélité. Cette seule phrase, sans autre protestation mit en poudre l'accusation de Dona Placida, qui en demeura toute triste.
Un quart d'heure après mon arrivée, je dis à Dona Placida:
—C'est bon. Virgilia reconnaîtra qu'il n'y a pas de ma faute... Voulez-vous lui porter de moi un billet tout de suite?
—Comme elle doit être triste, la pauvre! Certes, je ne désire la mort de personne; mais si vous vous mariez quelque jour avec Yaya, alors, oui, vous saurez quel ange elle est.
Je me souviens que je détournai le visage, et que je fixai le plancher. Je recommande ce geste à quiconque ne peut répondre promptement ou qui craint de regarder un interlocuteur en face. En semblable occurrence, certains ont l'habitude de réciter une strophe des Lusiades, d'autres sifflent n'importe quel air d'opéra. Je m'en tiens au geste que j'indique; il est simple, il exige moins d'efforts.
Trois jours plus tard, tout s'expliqua. Je suppose que Virgilia fut quelque peu étonnée, quand je lui demandai pardon des larmes que je lui avais fait verser en cette occurrence. Je ne me rappelle plus si, dans la suite, j'attribuai ces mêmes larmes à Dona Placida. Il se peut bien, en effet, que la bonne vieille ait pleuré en voyant Virgilia désappointée, et que, par un phénomène de vision, ses propres larmes lui aient paru tomber des yeux de Virgilia. Quoi qu'il en soit, tout fut expliqué, mais non pardonné, ni oublié. Virgilia me dit un certain nombre de choses peu aimables, me menaça de me quitter, et termina par l'éloge du mari. Celui-là, oui, était un homme supérieur, plein de dignité, délicat, affectueux et courtois; je n'allais pas à la hauteur de sa cheville. Elle disait tout cela, tandis qu'assis, les bras tombant sur les genoux, je regardais une mouche se promener sur le plancher, entraînant après elle une fourmi qui lui mordait une patte. Pauvre mouche! pauvre fourmi!
—Tu ne trouves rien à répondre? demanda Virgilia, en s'arrêtant devant moi.
—Que veux-tu que je te dise? Tu t'entêtes dans ta mauvaise humeur. Sais-tu ce que je crois? c'est que tu as assez de notre liaison, et que tu veux en finir...
—Justement!
Elle alla prendre son chapeau, tremblante et rageuse. «Adieu! Dona Placida», cria-t-elle. Ensuite, elle alla jusqu'à la porte, l'ouvrit, prête à partir. Je la saisis par la ceinture.
—Allons! voyons! Virgilia.
Elle s'efforça pour s'arracher à mon étreinte. Je la retins, je la suppliai de rester, d'oublier. Elle s'éloigna enfin de la porte, et elle alla tomber sur le canapé. Je m'assis auprès d'elle. Je lui dis des choses tendres, d'autres gracieuses; je m'humiliai devant elle. Je ne sais si nos lèvres se rapprochèrent à la distance de l'épaisseur d'un fil, ou moins encore; c'est matière à controverse. Je sais seulement que, dans son agitation, elle laissa tomber un de ses bijoux, et que je me penchai pour le ramasser. Au même moment la mouche et la fourmi y grimpèrent, l'une traînant l'autre. Alors, avec la délicatesse d'un homme de notre temps, je mis dans la paume de ma main ce couple mortifié. Je calculai la distance qui séparait ma main de la planète Saturne, et je me demandai en même temps quel intérêt je pouvais bien prendre à un épisode si insignifiant. Ne concluez pas que je fusse un barbare. Bien au contraire, je demandai à Virgilia une épingle pour séparer les deux bestioles. Mais la mouche, devinant mes intentions, ouvrit les ailes et s'envola. Pauvre mouche, pauvre fourmi! Et Dieu vit que cela était bon, comme disent les Écritures.
Je rendis l'épingle à cheveux à Virgilia. Elle l'enfonça dans ses cheveux, et s'apprêta à sortir. Il était tard; trois heures venaient de sonner. Tout était oublié et pardonné. Dona Placida, qui épiait l'occasion favorable pour que Virgilia pût sortir, ferma subitement la fenêtre, en s'écriant:
—Doux Jésus! voici le mari de Yaya!
Notre terreur fut courte, mais violente. Virgilia pâlit jusqu'à en devenir de la couleur de ses dentelles; et elle se réfugia dans la chambre à coucher. Dona Placida, qui avait fermé la porte de la rue, voulait aussi fermer la porte intérieure. Je me disposai à attendre Lobo Neves. Un instant après, Virgilia revint à elle, me poussa dans la chambre à coucher, et dit à Dona Placida de retourner à la fenêtre. La confidente obéit.
C'était lui. Dona Placida lui ouvrit la porte avec force exclamations de surprise.
—Vous ici! quel honneur pour la pauvre vieille! Entrez donc! Savez-vous qui est ici!... Bah! vous n'avez pas à deviner; vous venez la chercher... Voici votre mari, Yaya.
Virgilia, qui était dans un coin, se précipita vers lui. J'épiais par le trou de la serrure. Il entra lentement, pâle, froid, compassé, sans explosion, et promena un regard circulaire autour de la pièce.
—Quel miracle! dit Virgilia. Que viens-tu faire dans ces parages?
—Je passais par hasard. J'ai aperçu Dona Placida à la fenêtre, et je suis entré lui dire bonjour.
—Comme c'est aimable! interrompit celle-ci. Et puis l'on dira que personne ne s'occupe des vieilles gens. Mais vraiment, on dirait que Yaya est jalouse. Et, lui faisant force caresses, elle ajouta: C'est mon bon ange! elle n'oublie pas sa vieille Placida. Si bonne! tout le portrait de sa mère. Asseyez-vous donc, monsieur le docteur...
—Je n'ai qu'un instant...
—Tu rentres, dit Virgilia. Retournons ensemble.
—Allons!
—Donnez-moi mon chapeau, Placida.
—Le voici.
Dona Placida alla chercher un miroir, et le tint devant Virgilia, qui attachait les rubans, arrangeait ses cheveux, tout en parlant à son mari, qui ne répondait pas une parole. La bonne vieille bavardait sans trêve. C'était une façon de dissimuler le tremblement de tout son corps. Virgilia, le premier moment passé, était redevenue tout à fait maîtresse d'elle-même.
—Je suis prête, dit-elle. Adieu, Dona Placida, venez me voir.
L'autre promit, en ouvrant la porte.
Dona Placida ferma la porte, et tomba sur une chaise. Je sortis aussitôt de la chambre à coucher, et je fis deux pas dans la direction de la sortie, pour aller arracher Virgilia à son mari. Je le déclarai tout haut, et bien m'en prit car Dona Placida me retint aussitôt par le bras. Plus tard j'en arrivai à supposer que je n'avais parlé qu'à seule fin d'être retenu. Mais la simple réflexion démontre qu'après dix minutes d'angoisse dans la chambre à coucher, mon premier mouvement ne pouvait être que ce qu'il fut. C'est une conséquence de ma fameuse loi sur l'équivalence des fenêtres, que j'ai eu la satisfaction de découvrir et de formuler au chapitre LI. Il était nécessaire que je donnasse de l'air à ma conscience. La chambre à coucher avait les fenêtres fermées. J'en ouvris une autre, en faisant le geste de sortir, et je respirai.
Je respirai et je m'assis. Dona Placida faisait résonner les échos de ses exclamations et de ses plaintes. Je réfléchissais silencieusement s'il n'eût pas été plus prudent de laisser Virgilia dans la chambre à coucher et de demeurer moi-même dans le salon. Mais je réfléchis que c'eût été pis: c'était les soupçons confirmés, le feu mis aux poudres, une scène de sang, peut-être. Oui, les choses s'étaient bien passées. Mais ensuite? qu'allait-il arriver chez eux? Le mari tuerait-il la femme? se porterait-il à des voies de fait? l'enfermerait-il? la chasserait-il de sa présence? Toutes ces suppositions se présentaient l'une après l'autre à mon esprit, passant et repassant comme ces points obscurs qui parcourent le champ visuel des gens qui ont la vue malade ou fatiguée. Ils se succédaient tragiquement sans que je pusse saisir l'un ou l'autre et lui dire: «Est-ce toi? toi, et pas un autre?»
Soudain j'aperçois devant moi un fantôme C'était Dona Placida qui était allée dans sa chambre, avait revêtu sa mantille, et venait s'offrir pour aller jusque chez Lobo Neves. Je lui fis observer que c'était bien risqué. Il pouvait s'étonner d'une visite si imprévue.
—Tranquillisez-vous, me dit-elle; je saurai m'y prendre habilement. J'attendrai qu'il soit sorti.
Elle partit et je l'attendis en ruminant les conséquences possibles de sa démarche. En fin de compte, je jouais un jeu bien dangereux. Je me demandais s'il n'était pas temps de reprendre ma liberté. Je me sentais pris d'une velléité de mariage, d'un désir de canaliser ma vie. Pourquoi pas? Mon cœur pouvait encore explorer de nouvelles contrées. Je ne me sentais pas incapable d'un amour chaste, sévère et pur. En vérité, les aventures sont la partie torrentielle et vertigineuse de la vie, c'est-à-dire l'exception. J'étais las; je crois même que j'éprouvadéficit. Je remarquai la ligne de sa redingote, la blancheur de sa chemise, la propreté de ses bottines. Sa voix même, voilée naguère, paraissait avoir repris sa primitive sonorité. Mais je ne veux point le décrire. Si je parlais par exemple du bouton d'or qu'il portait à sa chemise et de la qualité du cuir de ses souliers, ce serait le commencement d'une longue description, que j'omets pour être bref. Sachez seulement que ces souliers étaient vernis. Sachez encore qu'il avait hérité quelques contos de reis d'un vieil oncle de Barbacena.
Qu'on me permette une comparaison: mon esprit était alors comme une espèce de volant; la narration de Quincas Borba était comme un coup de raquette qui le faisait s'envoler. Quand il était sur le point de tomber, le billet de Virgilia lui donnait une autre impulsion. Il descendait, et c'était alors l'épisode du Jardin public qui le recevait comme une autre raquette. Décidément, je n'étais pas né pour les situations compliquées. Ce va-et-vient de choses diverses me faisait perdre l'équilibre. J'avais envie d'empaqueter Quincas Borba, Lobo Neves, le billet de Virgilia, tous dans la même philosophie, et d'en faire présent à Aristote. D'ailleurs, elle était instructive, la narration de notre philosophe. J'admirais surtout le talent d'observation avec lequel il décrivait la gestation et la croissance du vice, les luttes intérieures, les lentes capitulations, l'accoutumance à la boue.
—Tenez, me dit-il, la première nuit que je passai sur l'escalier de l'église de S. Francisco, je dormis comme sur un lit de plumes: pourquoi? c'est que je tombai graduellement de la paille au plancher, de ma chambre au corps de garde, du corps de garde à la rue...
Il voulut finalement m'exposer son système philosophique. Je lui demandai d'ajourner sa dissertation.—«Je suis trop préoccupé, aujourd'hui, lui dis-je. Un autre jour. Je suis toujours chez moi.» Quincas sourit malicieusement; peut-être connaissait-il mon aventure. Mais il n'ajouta pas un mot, si ce n'est ces dernières paroles, en prenant congé:
—Réfugiez-vous dans l'Humanistisme; c'est le grand asile des esprits, l'éternel océan où je me suis plongé pour en arracher la vérité. Les Grecs la faisaient sortir d'un puits. Quelle mesquine conception! Un puits! C'est pour cela même qu'ils ne l'ont jamais rencontrée. Grecs, sous-Grecs, anti-Grecs, toute la longue série des générations s'est penchée sur le puits, pour en voir sortir la vérité qui ne s'y trouve pas. En a-t-on dépensé, des cordes et des seaux! Quelques audacieux descendirent au fond, et en retirèrent un crapaud. Je suis allé directement à la mer. Réfugiez-vous dans l'Humanitisme.
«Il ne s'est rien passé, mais il se doute de quelque chose. Il est sérieux, il se tait. Maintenant, il vient de sortir. Il a seulement souri une fois à Nhonhô, après l'avoir longtemps regardé d'un air sombre. Je ne sais trop ce qui va arriver. Dieu veuille que rien de grave ne se produise. Beaucoup de prudence pour l'instant, beaucoup de prudence!»
Et voici le drame, la pointe de drame shakespearien. Ce bout de papier griffonné, chiffonné est un document d'analyse, d'une analyse que je ne ferai ni dans ce chapitre, ni dans le suivant, ni peut-être dans tout le reste du livre. J'enlèverais sans doute ainsi au lecteur le plaisir de noter la froideur, la perspicacité et le courage qui se révèlent dans ces lignes tracées à la hâte, et de lire au travers la tempête et la fureur dissimulées, le désespoir qui se contraint et qui médite, l'ignorance de la solution finale dans la boue, dans le sang ou dans les larmes.
Quant à moi, si je vous disais que je relus le billet trois ou quatre fois ce jour-là, vous me croirez sans peine. Si je vous affirme que je le relus le jour suivant, avant et après le déjeuner, vous pouvez encore m'en croire, car c'est la vérité pure. Mais si je vous parle de mon émotion, mettez-la quelque peu en quarantaine, et ne l'acceptez que sous bénéfice d'inventaire. Ni alors, ni plus tard je ne pus discerner ce qui se passa en moi. C'était de la crainte, de la douleur, de la vanité, et ce n'en était pas. C'était de l'amour, sans amour, c'est-à-dire sans délire. Et tout cela donnait une combinaison complexe et vague, quelque chose que ni vous ni moi ne sommes capables de comprendre. Supposons dons que je n'aie rien dit.
On sait donc comment je relus la lettre, avant et après le déjeuner; cela revient à dire que je déjeunai; et j'ajouterai seulement que ce repas fut l'un des plus frugales de ma vie: un œuf, une tranche de pain, une tasse de thé. Je me souviens de ces menus détails, qui persistent dans ma mémoire d'où se sont enfuis tant d'événements importants. On pourrait en chercher la raison dans mon désastre même; mais le véritable motif fut la visite que Quincas Borba me fit ce jour-là. Il me dit que la sobriété n'était nullement nécessaire pour comprendre l'Humanitisme, et moins encore pour le mettre en pratique; que cette philosophie s'accommodait facilement avec les plaisirs de la vie, inclusivement ceux de la table, le spectacle et les amours. La frugalité, au contraire, pouvait indiquer une certaine tendance à l'ascétisme, qui est l'expression achevée de la bêtise humaine.
—Saint Jean, par exemple: quelle idée, de se nourrir de sauterelles dans le désert, au lieu d'engraisser tranquillement dans la ville, et de faire maigrir les pharisiens dans la synagogue!
Dieu me garde de raconter l'histoire de Quincas Borba, qui me fut d'ailleurs narrée tout entière en cette triste occurrence: une histoire longue, compliquée, mais intéressante. Et si je ne raconte point cette histoire, je me dispense aussi de dépeindre son aspect, très différent de celui que j'avais contemplé au Jardin public, Je me tais. Je dirai seulement que si les vêtements caractérisent l'homme encore plus que le visage, ce n'était plus Quincas Borba. C'était un magistrat sans hermine, un général sans uniforme, un négociant sans déficit. Je remarquai la ligne de sa redingote, la blancheur de sa chemise, la propreté de ses bottines. Sa voix même, voilée naguère, paraissait avoir repris sa primitive sonorité. Mais je ne veux point le décrire. Si je parlais par exemple du bouton d'or qu'il portait à sa chemise et de la qualité du cuir de ses souliers, ce serait le commencement d'une longue description, que j'omets pour être bref. Sachez seulement que ces souliers étaient vernis. Sachez encore qu'il avait hérité quelques contos de reis d'un vieil oncle de Barbacena.
Qu'on me permette une comparaison: mon esprit était alors comme une espèce de volant; la narration de Quincas Borba était comme un coup de raquette qui le faisait s'envoler. Quand il était sur le point de tomber, le billet de Virgilia lui donnait une autre impulsion. Il descendait, et c'était alors l'épisode du Jardin public qui le recevait comme une autre raquette. Décidément, je n'étais pas né pour les situations compliquées. Ce va-et-vient de choses diverses me faisait perdre l'équilibre. J'avais envie d'empaqueter Quincas Borba, Lobo Neves, le billet de Virgilia, tous dans la même philosophie, et d'en faire présent à Aristote. D'ailleurs, elle était instructive, la narration de notre philosophe. J'admirais surtout le talent d'observation avec lequel il décrivait la gestation et la croissance du vice, les luttes intérieures, les lentes capitulations, l'accoutumance à la boue.
—Tenez, me dit-il, la première nuit que je passai sur l'escalier de l'église de S. Francisco, je dormis comme sur un lit de plumes: pourquoi? c'est que je tombai graduellement de la paille au plancher, de ma chambre au corps de garde, du corps de garde à la rue...
Il voulut finalement m'exposer son système philosophique. Je lui demandai d'ajourner sa dissertation.—«Je suis trop préoccupé, aujourd'hui, lui dis-je. Un autre jour. Je suis toujours chez moi.» Quincas sourit malicieusement; peut-être connaissait-il mon aventure. Mais il n'ajouta pas un mot, si ce n'est ces dernières paroles, en prenant congé:
—Réfugiez-vous dans l'Humanistisme; c'est le grand asile des esprits, l'éternel océan où je me suis plongé pour en arracher la vérité. Les Grecs la faisaient sortir d'un puits. Quelle mesquine conception! Un puits! C'est pour cela même qu'ils ne l'ont jamais rencontrée. Grecs, sous-Grecs, anti-Grecs, toute la longue série des générations s'est penchée sur le puits, pour en voir sortir la vérité qui ne s'y trouve pas. En a-t-on dépensé, des cordes et des seaux! Quelques audacieux descendirent au fond, et en retirèrent un crapaud. Je suis allé directement à la mer. Réfugiez-vous dans l'Humanitisme.
Une semaine après, Lobo Neves fut nommé président d'une province. Je m'accrochai à l'espoir qu'il refuserait encore, si le décret portait la date du 13. Mais il fut signé un 31, et cette simple transposition de chiffres en élimina la substance diabolique. Singuliers ressorts de la vie!...
Comme j'ai pris l'habitude de ne rien dissimuler dans ces pages, je vais conter l'aventure du mur. Ils étaient alors sur le point de s'embarquer. En entrant chez Dona Placida, je vis un papier plié sur la table. C'était un billet de Virgilia. Elle me disait qu'elle m'attendait le soir, sans faute, dans le jardin. Et elle terminait par ces mots: «Le mur est assez bas du côté de l'impasse.»
Je fis un geste d'ennui. La lettre me parut excessivement audacieuse, dénuée de réflexion, et même ridicule. Ce n'était pas seulement chercher le scandale, c'était encore risquer les gorges chaudes. Je me vis franchissant le mur, tout bas qu'il fût, et appréhendé par un sergent de ville qui m'emmenait au corps de garde. Le mur était bas; et puis après? Virgilia avait perdu la tête; elle devait déjà s'être repentie depuis. Je regardai le morceau de papier: un morceau de papier froissé, mais inflexible. J'eus envie de le déchirer en trente mille morceaux, et de les jeter au vent, comme derniers vestiges de mon aventure. Je reculai à temps: l'amour-propre, la honte d'avoir fui, la crainte, je n'avais qu'à me soumettre.
—Vous pouvez lui dire que j'irai.
—Où donc? demanda Dona Placida.
—Où elle me dit de l'attendre.
—Mais elle n'a rien dit du tout.
—Eh bien! et ce papier?
Dona Placida ouvrit des yeux.
—Ce papier, je l'ai trouvé ce matin dans votre tiroir, et j'ai pensé que...
Je pressentis une singulière impression. Je relus le papier, je le parcourus de nouveau. C'était en vérité un vieux billet de Virgilia, reçu aux premiers temps de nos amours, et me conviant à une en revue qui m'avait, en effet, obligé à sauter le mur, un mur bas et discret. Je gardai le billet, et j'éprouvai une curieuse impression.
Il était écrit que cette journée serait celle des événements à double entente. Quelques heures plus tard, je rencontrai Lobo Neves, rue d'Ouvidor, et nous parlâmes de sa présidence, et de la politique du moment. Il mit à profit la rencontre de la première personne de connaissance pour me quitter, avec force compliments. Je me rappelle qu'il paraissait contraint, mais faisait tous ses efforts pour dissimuler cette contrainte. Je crois, et je demande pardon à la critique si mon jugement est téméraire, je crois qu'il avait peur, non pas de moi ni de lui, ni du code, ni de sa conscience, mais peur de l'opinion. Je suppose que ce tribunal anonyme et invisible, dont chaque membre est à la fois accusé et juge, était la limite contre laquelle se butait la volonté de Lobo Neves. Peut-être n'aimait-il plus sa femme; peut-être son cœur était-il étranger à l'indulgence de sa conduite au cours des derniers incidents. Je crois, et de nouveau je fais ici appel à la bonne volonté de la critique, je crois qu'il se serait séparé de sa femme avec la même indifférence que le lecteur se sera séparé de certaines relations personnelles. Mais l'opinion, l'opinion qui aurait étalé sa vie à tous les carrefours, qui aurait ouvert une enquête et mis à jour toutes les circonstances, les antécédents, les inductions, les preuves, pour discuter le tout par le menu aux heures de causerie et de désœuvrement, cette opinion terrible, si avide des secrets d'alcôve, empêcha la dispersion de la famille. Elle rendit en même temps impossible la vengeance, qui ne pouvait avoir lieu sans la divulgation. Il ne pouvait me montrer du ressentiment sans aller jusqu'à la répudiation. Il dut donc feindre l'ignorance et, par déduction, les sentiments d'une autre époque à mon égard.
Il lui en coûta sans doute pendant les premiers temps; il lui en coûta énormément, j'en suis sûr. Mais le temps,—et c'est un autre point qui méritera je l'espère l'indulgence des penseurs,—le temps met des durillons sur la sensibilité et oblitère la mémoire des événements. Il était à supposer que les années émousseraient les épines, que l'éloignement des faits en adoucirait les contours, qu'une ombre de doute rétrospectif couvrirait la nudité de la réalité, enfin que l'opinion s'occuperait un peu moins de lui et serait détournée sur d'autres aventures. Le fils, devenu grand, satisferait les ambitions paternelles, et serait l'héritier de toutes ses affections. Tout cela, uni à l'activité externe, le prestige public, la vieillesse ensuite, puis la maladie, le déclin, la mort, un service funèbre, une notice biographique, et le livre de la vie s'achèverait sans une goutte de sang.
La conclusion, si toutefois il y en a une au chapitre antérieur, c'est que l'opinion est une excellente soudure des institutions domestiques. Il n'est pas impossible que je développe cette pensée avant d'achever ce livre. Mais il est possible aussi que je n'y revienne plus. Quoi qu'il en soit, l'opinion est une bonne soudure, aussi bien dans la famille qu'en politique. Quelques métaphysiciens bilieux la considèrent comme l'arbitre des gens médiocres et creux. Mais il est évident que, quand bien même une décision aussi extrême ne contiendrait pas sa propre condamnation, il suffirait de considérer les effets salutaires de l'opinion pour en conclure qu'elle est l'œuvre supérieure de la fine fleur du genre humain, c'est-à-dire de la majorité.
—Oui, demain. Tu viendras à bord?
—Es-tu folle? c'est impossible.
—Alors, adieu!
—Adieu!
—N'oublie pas Dona Placida. Va la voir de temps à autre. La pauvre! Elle est venue hier prendre congé de moi. Elle pleurait... elle me disait que je ne la verrai plus... C'est une bonne créature, n'est-il pas vrai?
—Certainement.
—Si nous nous écrivons, elle recevra les lettres. Maintenant, d'ici à...
—Deux ans, peut-être.
—Allons donc! Il dit qu'il va seulement présider aux élections.
—Oui. Alors à bientôt. Attention! on nous regarde.
—Qui?
—Là, sur le sofa. Séparons-nous.
—Si tu savais combien il m'en coûte!
—Oui; mais il le faut. Adieu, Virgilia.
—À bientôt donc. Adieu.
Je n'assistai pas à son départ. Mais, à l'heure marquée, j'éprouvai quelque chose qui n'était ni de la douleur ni du plaisir, un mélange à doses égales de soulagement et de regrets. Que le lecteur ne s'irrite point de cette confession. Je sais bien que pour être agréable à sa fantaisie et faire vibrer ses nerfs, j'aurais dû souffrir un profond désespoir, verser des larmes, et ne pas déjeuner. Ce serait romanesque, mais non biographique. La vérité pure, c'est que je déjeunai comme tous les jours, nourrissant mon cœur du souvenir de mon aventure, et mon estomac des mets de M. Proudhon...
Vieillards de ma génération, vous souvenez-vous encore de ce maître cuisinier de l'hôtel Pharoux, qui, à en croire le patron de l'hôtel, avait servi chez Véry et Véfour, et aussi chez le comte Molé et chez le duc de la Rochefoucauld? Il était vraiment insigne. Lui et la polka firent à la même époque leur solennelle entrée à Rio... La polka, M. Proudhon, Tivoli, le bal des étrangers, le Casino, voilà quelques-uns de mes meilleurs souvenirs de ce temps-là. Mais les petits plats du chef étaient surtout délicieux.
Ce matin-là, on aurait dit que ce diable d'homme avait pressenti ma catastrophe. Jamais son art et son génie ne lui furent si propices. Quelle recherche des condiments, quelles chairs tendres, quelle ordonnance des plats! On dégustait avec la bouche, les yeux, le nez. Je n'ai pas gardé la note de ce jour-là; je sais qu'elle fut salée. Hélas! il me fallait enterrer magnifiquement mes amours. Ils s'en allaient en plein océan, dans l'espace et dans le temps, et je me retrouvais au coin d'une table, avec mes quarante et tant d'années, inutiles et vides. Elle pourrait bien revenir, comme elle revint en effet. Mais eux!... Hélas! qui s'aviserait de redemander au crépuscule du soir les effluves du matin?...
Cette fin de chapitre m'a tellement attristé que j'étais sur le point de ne plus écrire, de me reposer un peu, pour purger mon esprit de cette mélancolie, avant de continuer. Mais non: je ne veux pas perdre de temps.
Le départ de Virgilia me laissa une impression de veuvage. Les premiers jours, je restai chez moi, passant les heures comme Domicien, à enfiler des mouches, si toutefois Suétone n'a pas menti. Mais je les harponnais d'une façon particulière, avec les regards. Je les transperçais une à une au fond d'une grande salle, étendu dans un hamac, un livre ouvert entre les mains. C'était tout: regrets, ambitions, un peu d'ennui, et, par-dessus tout, beaucoup de rêverie. Mon oncle, le chanoine, mourut dans cet intervalle; item, deux cousins. Leur mort me laissa froid. Je les conduisis au cimetière comme on porte de l'argent en banque; que dis-je?... comme on porte des lettres à la poste. J'y collai le timbre, je les donnai au facteur, et je lui laissai le soin de les remettre en main propre. Ce fut à peu près à cette époque que naquit ma nièce Venancia, fille de Cotrim. Les uns naissaient, les autres mouraient; je continuai à vivre avec les mouches.
Parfois aussi, je m'agitais. Je retournais mes tiroirs; je retrouvais d'anciennes lettres, d'amis, de parents, de maîtresses, voire de Marcelina. Je les ouvrais toutes, je les relisais une à une et je revivais le passé. Lecteur ignare, si tu ne conserves pas tes lettres de jeunesse, tu ne connaîtras pas un jour la philosophie des feuilles mortes; tu ne connaîtras pas la jouissance de te revoir très loin dans une pénombre, avec un grand tricorne, des bottes de sept lieues et des barbes assyriennes, danser au son d'un accordéon anacréontique. Garde tes lettres de jeunesse.
Si le tricorne ne te sourit pas, j'emploierai l'expression d'un vieux marin, ami de Cotrim. Je dirai que si tu gardes tes lettres de jeunesse, tu auras l'occasion de «chanter une nostalgie»; c'est le nom que nos loups de mer donnent aux airs de la patrie, qu'ils entonnent en plein océan. Comme expression poétique, on ne saurait rien trouver de plus triste.
Deux forces, et une troisième par-dessus le marché, m'incitaient à reprendre ma vie agitée: Sabine et Quincas Borba. Ma sœur poussa la candidature conjugale de Nha-Lolo d'une façon véritablement impétueuse. Quand je retombai en moi-même, je me trouvai presque avec la jeune fille dans les bras. Quant à Quincas Borba, il m'exposa son système philosophique de l'Humanitisme, destiné à ruiner tous les autres.
—Humanitas, disait-il, principe des choses, est l'homme lui-même distribué entre tous les hommes. Humanitas compte trois phases: la statique, antérieure à toute création; l'expansive, commencement des choses; la dispersive apparition de l'homme; et elle en comptera une autre encore, la contractive, absorption de l'homme et des choses. L'expansion, force vive de l'univers, suggéra à Humanitas le désir d'en jouir, et de là vient la dispersion, qui n'est que la multiplication personnifiée de la substance originelle.
Comme cette exposition ne me paraissait Pas assez claire, Quincas Borba me la développa d'une façon profonde, en m'indiquant les grandes lignes du système. Il m'expliqua que, par certains côtés, l'Humanitisme se reliait au Brahmanisme, qui distribue les hommes d'après les différentes parties du corps d'Humanitas dont ils procèdent. Mais ce qui dans la religion hindoue n'a qu'une étroite signification politique et théologique, devient dans l'Humanitisme la grande loi de la valeur personnelle. Ainsi, descendre de la poitrine ou des reins d'Humanitas, c'est-à-dire d'une forte souche, n'est pas la même chose que de descendre de ses cheveux ou du bout de son nez. De là vient la nécessité de cultiver la vigueur physique. Hercule fut un symbole anticipé de l'Humanitisme. Arrivé à ce point, Quincas Borba démontra que le paganisme aurait pu atteindre à la vérité, s'il ne s'était pas amoindri par la signification galante des mythes. Rien de cela n'arrivera avec l'Humanitisme. Dans cette église, il n'y a place ni pour les aventures faciles, ni pour les chutes, ni pour les tristesses, ni pour les allégresses puériles. L'amour, par exemple, est un sacerdoce; la reproduction, un rite. Comme la vie est le plus grand bienfait de l'univers, et qu'il n'y a pas de mendiant qui ne préfère la misère à la mort, ce qui est un délicieux influx d'Humanitas, il s'ensuit que la transmission de la vie, loin d'être un passe-temps galant, est l'heure suprême de la vie spirituelle. Car il n'y a vraiment au monde qu'un seul malheur: c'est de ne pas y venir.
—Imagine, par exemple, que je ne sois point né, continua Quincas Borba. Il est certain que je n'aurais pas en ce moment le plaisir de causer avec toi, de manger ces pommes de terre, d'aller au théâtre, et pour tout dire en un mot, de vivre. Note bien que je ne fais pas de l'homme un simple véhicule d'Humanitas. Non: il est à la fois véhicule, cocher et voyageur. Il est la réduction du propre Humanitas. C'est donc une nécessité de s'adorer soi-même. Veux-tu une preuve de la supériorité de mon système? Regarde l'envie. Il n'y a pas un seul moraliste, grec ou turc, chrétien ou musulman, qui ne tempête contre le sentiment de l'envie. L'accord est universel, depuis les champs de l'Idumée jusqu'au sommet de la Tijuca. Fort bien; laisse là maintenant les vieux préjugés, oublie les vieux oripeaux de la rhétorique, et étudie de sang-froid l'envie, ce sentiment si subtil et si noble. Chaque homme étant une réduction d'Humanitas, il est clair qu'aucun homme ne peut être fondamentalement l'ennemi d'un autre homme, quelles que soient les apparences contraires. Ainsi, par exemple, le bourreau qui exécute un condamné peut exciter la vaine clameur des poètes; mais en substance, il n'est autre chose qu'Humanitas corrigeant Humanitas pour une infraction de la loi d'Humanitas. J'en dirai autant d'un individu qui en étripe un autre. C'est une manifestation des forces d'Humanitas. Rien n'empêche, et il y a des exemples de semblables coïncidences, qu'il ne soit à son tour étripé. Si tu m'as bien compris, tu verras que l'envie n'est autre chose que l'admiration de la lutte, qui est la grande fonction du genre humain. Tous les sentiments belliqueux sont les plus appropriés à son bonheur. D'où je conclus que l'envie est une vertu.
Je ne nierai pas que j'étais stupéfait. La clarté de l'exposition, la logique des principes, la rigueur des conséquences, tout cela m'apparaissait supérieurement élevé, et je dus me taire pendant quelques minutes pour prendre le temps de digérer cette philosophie nouvelle. Quincas Borba dissimulait mal son air de triomphe. Il avait une aile de poulet dans son assiette, et la mangeait avec une philosophique sérénité. Je lui fis encore quelques objections, mais si faibles qu'il les réduisit aussitôt à néant.
—Pour bien comprendre mon système, me dit-il, il ne faut jamais oublier que le principe universel est réparti entre tous les hommes, et résumé en chacun d'eux. Regarde: la guerre, qui semble une calamité, est une opération congrue, comme qui dirait un claquement des doigts d'Humanitas. La faim (et ce disant il mâchait philosophiquement son aile de poulet), la faim est une preuve qu'Humanitas sait dominer ses propres viscères. Mais je ne veux point d'autre preuve de la sublimité de mon système que ce poulet lui-même. Il s'est nourri de maïs qui fut planté par un noir importé du fin fond de l'Afrique: d'Angola par exemple. Le négrillon naquit, poussa, fut vendu et mis à bord d'un navire, construit avec des planches provenant d'arbres coupés dans la forêt par dix ou douze hommes, et poussé par des voiles tissées par d'autres hommes, sans parler des cordages et des autres parties de l'appareil nautique. Ainsi, ce poulet que je viens de déguster est le résultat d'une multitude d'efforts et de luttes, exécutés à seule fin d'assouvir mon appétit.
Entre la poire et le fromage, Quincas Borba me démontra encore que son système tendait à la destruction de la douleur. La douleur, suivant la théorie de l'Humanitisme, est une pure illusion. Quand l'enfant est menacé d'un bâton, il ferme les veux et tremble, avant même d'avoir été frappé. Cette prédisposition est ce qui constitue la base de l'illusion humaine, héritée et transmise. L'adoption du système n'est certainement pas suffisante pour en finir avec la douleur, mais elle est indispensable. Le reste est la naturelle évolution des choses. Une fois que l'homme se sera bien compénétré de cette vérité qu'il est le propre Humanitas, il n'aura qu'à remonter en pensée jusqu'à sa substance originelle pour éviter toute sensation douloureuse. Mais c'est là une évolution si décisive qu'on peut bien lui assigner quelques milliers d'années.
Quelques jours après, Quincas Borba me lut son œuvre tout entière. Elle tenait en quatre volumes manuscrits, de cent pages chacun, contenant force citations latines, et écrits d'une écriture très fine. Le dernier se composait d'un traité de la politique fondée sur l'Humanitisme. C'était la partie la plus aride du système, mais conçue avec une formidable logique. Sa société réorganisée n'éliminait ni la guerre, ni l'insurrection, ni le simple coup de poing, ni le coup de couteau anonyme, ni la misère, ni la maladie, ni la faim. Mais comme tous ces fléaux supposés ne sont que des erreurs de l'entendement, il est clair que leur existence ne doit pas troubler la félicité humaine; car ce sont de simples effets externes de la substance interne, destinés à n'influer sur l'homme que pour rompre la monotonie universelle. Mais quand bien même ces fléaux (chose radicalement fausse d'ailleurs) pourraient continuer à correspondre dans l'avenir à la mesquine conception des temps passés, le système n'en serait nullement détruit, et pour deux motifs: 1° parce qu'Humanitas étant la substance créatrice et absolue, chaque individu doit éprouver le plus intense délice à se sacrifier aux principes dont il descend; 2° parce que, dans ce cas extrême, le pouvoir de l'homme sur la terre ne serait point diminué, l'univers ayant été créé pour sa plus grande récréation, avec les étoiles, la brise, les dattes et la rhubarbe. «Pangloss, me dit-il en fermant le livre, n'était pas aussi sot que l'a peint Voltaire.»
Mon troisième motif d'action était le désir de briller, et surtout l'impossibilité de vivre seul. La multitude m'attirait, je m'enivrais des applaudissements. Si l'idée de l'emplâtre m'était venue en ce temps-là, qui sait? je ne serais peut-être pas mort tout de suite, et je serais devenu célèbre. Mais je n'eus pas l'idée de l'emplâtre. Et je ne pus résister au désir de m'agiter dans un milieu quelconque pour une chose quelconque, et une fin quelconque.
Je veux consigner ici, entre parenthèses, une demi-douzaine de maximes choisies parmi celles que j'écrivis en grand nombre à cette époque. Ce sont des bâillements d'ennui. Elles peuvent servir d'épigraphe aux discours de gens qui manqueraient de titres.
On supporte toujours patiemment la colique du prochain.
Nous tuons le temps; il nous enterre.
Un cocher philosophe avait l'habitude de dire que le plaisir d'aller en voiture serait considéré comme bien médiocre, si tout le monde avait la sienne.
Aie confiance en toi; mais ne doute point toujours des autres.
Comment est-il possible qu'un peau-rouge se perce la lèvre pour y introduire un simple morceau de bois?
Cette réflexion est d'un bijoutier.
Ne t'irrite pas si l'on oublie tes bienfaits: il vaut mieux tomber des nues que d'un troisième étage.
Oui, mon cher, que tu le veuilles ou non, maintenant tu te marieras, me dit un jour Sabine. Garçon, sans enfants, quel bel avenir!
Sans enfants!... l'idée d'en avoir me fit sursauter. Une fois encore, le fluide mystérieux me parcourut tout entier. Oui, je devais être père. La vie de garçon a sans doute ses avantages, mais ils sont précaires, et on les achète au prix de solitude. Mourir sans enfants! non, c'était impossible. J'étais prêt à tout, même à l'alliance avec Damasceno. Sans enfants!... comme j'avais grande confiance en Quincas Borba, je j'allai voir, et lui exposai les mouvements intimes de ma paternité. Le philosophe m'écouta avec enthousiasme. Il me déclara qu'Humanitas s'agitait en moi. Il m'encouragea au mariage. C'était quelques convives de plus qui battaient à la porte de la vie, etc. Compelle intrare, comme disait Jésus. Et il ne me laissa point sortir sans m'avoir préalablement démontré que l'apologue évangélique était une prophétie de l'Humanitisme, mal interprétée par les prêtres.
Au bout de trois mois, tout allait comme sur des roulettes. Le fluide, Sabine, les jolis yeux de la jeune fille, la bonne volonté du père, tout cela, dans une même impulsion, me conduisait au mariage. Le souvenir de Virgilia venait de temps à autre battre à ma porte, conduit par un diable tout noir, qui me présentait un miroir, dans lequel je voyais au loin Virgilia baignée de larmes. Mais aussitôt, un autre diable rose me présentait un second miroir, où se reflétait l'image de Nha-Lolo, tendre, lumineuse, angélique.
Je ne parle pas du poids des ans, car je ne le sentais pas. J'ajouterai même que ce poids, je m'en débarrassai un certain dimanche que j'allai entendre la messe à la chapelle de Livramento avec Nha-Lolo et son père. Comme Damasceno habitait aux Cajueiros, je les accompagnais souvent à l'église. La colline n'était pas encore édifiée, sauf le vieux palais du sommet où se trouvait la chapelle. Or, un dimanche, tandis que je descendais la côte avec Nha-Lolo à mon bras, je ne sais par quel miracle, je laissai ici deux années, là quatre, plus loin cinq, de sorte qu'en arrivant en bas, je me trouvai n'avoir plus que vingt-cinq ans et tout l'enthousiasme de cet âge.
Maintenant, si vous désirez savoir comment se produisit ce phénomène, vous n'avez qu'a lire ce chapitre jusqu'à la fin. Nous venions d'entendre la messe. Au beau milieu de la colline, nous rencontrons un groupe d'hommes. Damasceno, qui marchait à côté de nous, comprit de quoi il s'agissait, et se précipita. Nous l'imitâmes. Et voici ce que nous vîmes: des hommes de tout âge, de toutes les couleurs et de toutes les tailles, les uns en manches de chemise, d'autres en jaquette, d'autres enfouis dans des redingotes fripées, en des attitudes diverses, les uns à califourchon, d'autres les mains appuyées sur les genoux, d'autres assis sur des pierres, ceux-là appuyés à un mur, et tous les yeux fixés vers le même centre, et l'âme coulant à travers les prunelles.
—Qu'est-ce là? demanda Nha-Lolo.
Je lui fis signe de se taire; je lui ouvris un chemin avec adresse, et tous me cédèrent le pas, sans que personne nous remarquât d'une façon positive, tant le même objet attirait les regards. C'était un combat de coqs. Je vis les deux combattants, avec leurs éperons aigus, leur œil sanglant et leur bec pointu. L'un et l'autre agitaient leurs crêtes pourprées. Leurs poitrines étaient déplumées et vermeilles. Ils tombaient de fatigue. Mais ils luttaient tout de même, croisant leurs regards, le bec en haut, le bec en bas, estocade par-ci, estocade par-là, vibrants et rageurs. Damasceno perdit la notion de tout. L'univers entier, sauf le lieu du combat, disparut à ses regards. J'avais beau lui dire qu'il était temps de partir, il ne répondait pas, n'entendait pas, tout à l'émotion du duel. C'était une de ses passions.
Soudain, Nha-Lolo me tira par le bras, en me disant qu'elle voulait partir. J'obéis, et nous descendîmes. J'ai déjà dit que la colline était inhabitée. J'ai dit aussi que nous revenions de la messe, et comme je n'ai point parlé de la pluie, il est clair qu'il faisait un temps excellent et un délicieux soleil, et fort: si fort que j'ouvris aussitôt mon parapluie; et, le tenant par le milieu du manche, je l'inclinai de façon que j'ajoutai une page à la philosophie de Quincas Borba: Humanitas baisa Humanitas... C'est ainsi que je semai les années tout le long du chemin.
Après être descendus, nous nous arrêtâmes quelques minutes, en attendant Damasceno. Il arriva, quelques minutes plus tard, entouré de parieurs qui commentaient les péripéties du combat. L'un d'eux, le trésorier des paris, distribuait de vieilles notes de dix tostons, que les gagnants recevaient avec une vive allégresse. Quant aux coqs, ils venaient dans les bras de leurs respectifs propriétaires. L'un avait la crête si sanglante et si endommagée, que je le considérait tout de suite comme le vaincu. Mais non, le vaincu, c'était l'autre qui n'avait plus de crête du tout. Tous deux ouvraient le bec, respirant avec peine, et se trouvaient sur le flanc. Les parieurs au contraire venaient contents, malgré les fortes émotions de la lutte. On faisait la biographie des lutteurs, on remémorait leurs prouesses. Nous continuâmes notre route, moi gêné, Nha-Lolo plus gênée encore.
Ce qui vexait Nha-Lolo, c'était l'attitude de son père. La facilité avec laquelle il était entré dans l'intimité des joueurs mettait en relief ses anciennes habitudes et affinités sociales, et Nha-Lolo craignait qu'un tel beau-père ne me fît rougir. Elle s'étudiait, elle m'étudiait; elle se transformait. La vie élégante et polie l'attirait parce qu'elle lui paraissait le moyen le plus sûr de mettre nos deux personnes en parfaite harmonie. Elle observait, imitait et devinait. En même temps, elle faisait un effort pour dissimuler la vulgarité de sa famille. Ce jour-là, l'algarade paternelle l'attrista profondément. Son abattement était si visible et si expressif que j'en arrivai à attribuer à Nha-Lolo l'intention positive de séparer dans mon esprit sa propre cause de celle de l'auteur de ses jours. Ce sentiment me parut d'une grande élévation. C'était une affinité de plus entre nous.
—Décidément, me dis-je, je vais arracher cette fleur à ce bourbier.
Nonobstant mes quarante et quelques années, je crus, avant de décider mon mariage, devoir demander conseil à Cotrim, car j'aimais l'harmonie dans la famille. Il m'écouta, et me répondit très sérieusement qu'il n'émettait point d'opinion quand il s'agissait de ses parents. On aurait pu le trouver suspect, si par hasard il louait les rares qualités de Nha-Lolo. Il préférait donc se taire. Bien plus, il ne doutait pas qu'elle n'éprouvât pour moi une réelle passion; et cependant, si elle le consultait, il ne me cachait pas que sa réponse serait négative. Il n'éprouvait à mon égard aucune haine; il appréciait mes bonnes qualités,—il les louait sans cesse, et c'était justice,—et quant à Nha-Lolo, jamais il n'émettrait le moindre doute sur ses excellentes aptitudes au mariage. Mais de là à conseiller une union matrimoniale il y avait un abîme.
—Je m'en lave les mains, conclut-il.
—Mais vous me disiez l'autre jour que je devrais me marier au plus tôt.
—Ça, c'est une autre question. Je trouve qu'il est indispensable que l'on se marie, surtout quand on a des ambitions politiques. Le célibat, pour l'homme politique, est un rémora. Mais quant à la fiancée, je ne puis, ni ne veux, ni ne dois donner d'opinion; il y va de mon honneur. Je crois que Sabine a excédé les limites, en vous faisant certaines confidences, d'après ce qu'elle m'a dit. Mais dans tous les cas, elle n'est que tante par alliance de Nha-Lolo, tandis que moi, je suis son oncle pour de vrai. Tenez... mais non... Je ne dis rien...
—Parlez donc.
—Non, je ne dis rien...
Les gens qui ne connaissent pas le caractère férocement honorable de Cotrim trouveront peut-être son scrupule excessif. Moi-même je m'étais montré injuste à son égard durant les années qui suivirent l'inventaire paternel. Je reconnais aujourd'hui qu'il a été à cet égard la perfection même. On le taxait d'avarice, et je crois qu'on avait raison. Mais l'avarice est à peine l'exagération d'une vertu, et les vertus sont comme les budgets: mieux vaut qu'il y ait solde que déficit. Comme il était très sec dans ses manières, ses ennemis l'accusaient d'être barbare. On pouvait bien alléguer qu'il faisait fréquemment fustiger ses esclaves jusqu'au sang. Mais outre qu'il ne faisait fouetter que les pervers et les fuyards, il faut dire à sa décharge qu'ayant fait pendant longtemps la contrebande de l'ébène, il s'était habitué à traiter les nègres avec plus de brutalité qu'il ne conviendrait peut-être; on ne peut en tous cas honnêtement attribuer au naturel d'un individu ce qui est un pur résultat des relations sociales. La preuve que Cotrim avait des sentiments, c'est la douleur qu'il éprouva, quelques mois plus tard, quand il perdit sa fille Sara; et cette preuve est irréfutable. Il était trésorier d'une confrérie, et affilié à différents tiers ordres, ce qui ne concorde guère avec sa réputation d'avarice. Il est vrai qu'il tirait parti de son sacrifice; la confrérie dont il avait été dignitaire commanda son portrait à l'huile. Il avait bien ses petits défauts: par exemple il faisait publier dans tous les journaux les œuvres de bienfaisance qu'il pratiquait; mais il se disculpait en disant que les bonnes actions sont contagieuses quand elles sont rendues publiques; et l'on ne saurait le nier. Je crois même, et en cela je fais son éloge, que de temps à autre, il ne pratiquait le bien qu'à seule fin d'éveiller la philanthropie d'autrui. Et dans ce cas, il faut bien reconnaître que la publicité était une condition sine qua non. En somme, il pouvait bien devoir des attentions, mais pas un sou à qui que ce soit.
Qu'y a-t-il entre la vie et la mort? l'épaisseur d'un fil. Et cependant, si je n'écrivais ce chapitre, le lecteur souffrirait un choc assez préjudiciable à la bonne tenue de ce livre. Passer d'un portrait à une épitaphe peut être réel et banal. Mais le lecteur ne se réfugie dans le livre que pour échapper à la réalité des choses. Je ne dis pas que cette pensée soit la mienne; je dis qu'il y a là une dose de vérité, et que la forme au moins en est pittoresque.
CI-GIT
EULALIA DAMASCENA DE BRITO
MORTE
À L'ÂGE DE DIX-NEUF ANS
PRIEZ POUR ELLE.
L'épitaphe dit tout. Inutile après cela de narrer la maladie de Nha-Lolo, sa mort, l'enterrement et le désespoir de la famille. Elle mourut pendant la première épidémie de fièvre jaune. Je l'accompagnai jusqu'à sa demeure dernière, et lui dis adieu, tristement, mais l'œil sec. J'en conclus que peut-être je n'avais pas pour elle un réel amour.
Voyez maintenant à quel excès peut porter le manque de réflexion. Je clamai contre l'épidémie, qui, frappant à tort et à travers, emportait ainsi une jeune fille qui aurait dû être ma femme. Je ne comprenais nullement la nécessité de l'épidémie, et moins encore la nécessité de cette mort. Je crois bien qu'elle me parut plus absurde même que celle de tant d'autres gens. Mais Quincas Borba m'expliqua que les épidémies, bien que désastreuses pour un certain nombre d'individus, ont des avantages pour l'espèce. Il me fit remarquer que, dans leur horreur, elles offrent un notable avantage: la survivance du plus grand nombre. Il me demanda si, au milieu du deuil général, je n'éprouvais aucun secret délice d'avoir échappé aux fureurs de la peste. Mais cette demande était si insensée que je ne jugeai pas devoir y répondre.
Puisque je ne parle pas de la mort de Nha-Lolo, je passerai aussi sous silence la messe du septième jour. La tristesse de Damasceno était profonde. Ce pauvre homme paraissait une ruine. Quinze jours après, je le rencontrai. Il était toujours inconsolable, et il disait que la grande douleur qui lui était infligée par Dieu se compliquait encore de celle que lui avaient infligée les hommes. Il n'ajouta rien de plus. Mais, trois semaines plus tard, il revint sur le même sujet, et me confessa qu'au milieu de cet irréparable désastre, il avait espéré l'appui moral de ses amis. Or douze personnes, presque toutes amis de Cotrim, avaient accompagné jusqu'au cimetière les restes de sa fille chérie. Et il avait envoyé quatre-vingts invitations. Je lui fis observer que, dans presque toutes les familles, il y avait des victimes, ce qui devait faire excuser ce manque apparent d'égards.
—On m'a abandonné, gémit-il.
Cotrim, qui était présent, objecta:
—Vos vrais amis étaient là. Les autres seraient venus par simple formalité, et tout le temps ils eussent parlé de l'inertie du gouvernement, des panacées du droguiste, du prix des maisons, et d'un tas d'autres choses.
Damasceno l'écouta en silence, secoua une autre fois la tête et soupira:
—Ils auraient bien pu venir tout de même.
C'est une grande chose que d'avoir reçu du ciel avec quelque sagesse, le don de trouver les relations des choses, la faculté de comparaison et le don de tirer des conséquences. J'ai eu cette distinction psychique. Je m'en félicite encore du fond de mon sépulcre.
De fait, l'homme vulgaire qui eût entendu la dernière réflexion de Damasceno ne s'en fût pas souvenu, en voyant, quelque temps après, six dames turques représentées sur une gravure. Mais moi, je m'en souvins. C'étaient six dames de Constantinople, vêtues à la moderne, en costume de ville, la face voilée, non pas d'une étoffe épaisse, mais d'un voile transparent et léger, qui feignait de découvrir seulement les yeux, et en réalité découvrait la face tout entière. Et je trouvai quelque ironie à cette coquetterie fine des musulmanes qui, pour se soumettre à une longue tradition, se couvrent le visage, mais sans cacher leurs traits ni dissimuler leur beauté. Apparemment, qu'y a-t-il de commun entre les dames turques et Damasceno? rien. Mais si tu as un esprit profond et pénétrant (et je doute fort que tu me déclares le contraire), tu comprendras que, dans l'un et l'autre cas, l'on voit poindre le bout de l'oreille d'une inséparable et douce compagne de tout homme sociable.
Aimable Formalité, tu es le baume des cœurs, la médiatrice des hommes, le lien qui unit la terre et le ciel. Tu sèches les larmes d'un père, tu obtiens l'indulgence d'un prophète. Si la douleur s'apaise et si la conscience devient accommodante, à qui, sinon à toi, doit-on cet immense avantage? L'estime qui passe devant nous avec le chapeau sur la tête ne dit rien à notre âme; mais l'indifférence qui salue y laisse une délicieuse impression. Continue donc à vivre, aimable Formalité, pour la tranquillité de Damasceno et la gloire de Mahomet.
Notez bien que cette gravure turque, je ne la vis que deux ans plus tard à la Chambre des députés, au milieu d'un grand chuchotement de voix, tandis qu'un orateur discutait les conclusions de la commission du budget. J'étais alors moi-même député. Pour ceux qui ont lu ce livre, il est inutile de dire ma satisfaction, et il serait également oiseux de le dire pour les autres. J'étais député, et je vis la gravure turque, tandis qu'appuyé sur le dossier de mon fauteuil j'écoutais un voisin qui contait une histoire, en en regardant un autre qui faisait sur le revers d'une carte de visite le portrait de l'orateur. Cet orateur n'était autre que Lobo Neves. L'onde de la vie nous avait jetés sur le même rivage, lui contenant son ressentiment, et moi avec l'obligation de dissimuler mes remords. Et j'emploie la forme suspensive, dubitative ou conditionnelle parce qu'en réalité je ne dissimulais rien du tout, si ce n'est mon ambition d'être ministre.
Non vraiment, je n'avais aucun remords.
La première fois que je pus parler à Virgilia après la présidence, ce fut dans un bal, en 1855. Elle portait un superbe vêtement de gourgouran de couleur bleue, et présentait aux lumières la même paire d'épaules qu'autrefois. Elle n'avait plus la fraîcheur de la première jeunesse, loin de là; mais elle était encore fort belle, d'une beauté automnale rehaussée par la nuit. Nous causâmes longtemps, sans allusion au passé. Nous sous-entendions simplement: une parole vague, un regard, et c'était tout. Quand elle partit, j'allai la voir descendre les escaliers, et je ne sais par quel phénomène de ventriloquie cérébrale (que les philologues me pardonnent cette phrase barbare), je murmurai cette parole profondément rétrospective: «Magnifique!»
Si je possédais un laboratoire, j'inclurais dans ce livre un chapitre de chimie, où je décomposerais le remords en ses derniers éléments, avant de décider pourquoi Achilles promenait autour de Troie le cadavre de son adversaire, tandis que lady Macbeth promenait autour d'une salle de son palais sa manche tachée de sang. Mais je n'ai pas plus de laboratoire que je n'avais de remords. Je désirais tout simplement être ministre. En tous cas, avant de terminer ce chapitre, je dirai que je n'aurais voulu être ni Achilles ni lady Macbeth. Mais s'il m'avait fallu absolument choisir, j'aurais tout de même préféré traîner le cadavre que la souillure. J'y aurais gagné une ovation, les supplications de Priam, et une jolie réputation militaire et littéraire. Mais ce que j'écoutais, c'était le discours de Lobo Neves et non les supplications de Priam; et je n'avais pas de remords.
Comme j'achevais de pousser cette exclamation intérieure, par mon procédé de ventriloquie cérébrale (et elle était l'expression d'une simple opinion et nullement d'un remords), je sentis quelqu'un qui me battait sur l'épaule. Je me retournai. C'était un de mes anciens camarades, officier de marine, jovial, un peu sans-façons. Il sourit malicieusement et me dit:
—Ah! vieux paillard! ce sont des souvenirs du passé, hein!
—Vive le passé!
—Naturellement tu as été réintégré dans tes anciennes fonctions.
—Veux-tu bien te taire! lui dis-je en le menaçant du doigt.
Je confesse que ce dialogue était fort indiscret, principalement en ce qui concerne ma réponse. Et je le confesse avec d'autant plus de plaisir que les femmes ont la réputation d'être indiscrètes, et je ne voudrais pas terminer ce livre sans rectifier cette injuste notion de l'esprit humain. En matière d'aventures amoureuses, j'ai trouvé des hommes qui souriaient ou niaient maladroitement d'une façon évasive et monosyllabique, tandis que leurs complices auraient juré sur les Saints Évangiles qu'on les calomniait. La raison de cette différence, c'est que la femme, à part l'hypothèse du chapitre CI et dans quelques autres cas, se livre par amour qu'il s'agisse de l'amour-passion de Stendhal ou de l'amour purement physique de quelques dames romaines, voire même polynésiennes, lapones, cafres, ou de n'importe quelle autre race civilisée. Mais l'homme, je parle de l'homme d'une société cultivée et élégante, l'homme unit toujours sa vanité à l'autre sentiment. De plus (et je me réfère toujours aux cas prohibés), la femme, quand elle aime un homme autre que son mari, croit faillir à un devoir, et doit par conséquent dissimuler avec un art supérieur, et raffiner sa dissimulation; tandis que l'amant, qui se sait la cause d'une trahison et se juge vainqueur de son semblable, est naturellement orgueilleux de cette victoire, et passe vite à un autre sentiment moins secret, à cette bonne fatuité, qui est la transpiration lumineuse du mérite.
Mais que mon explication soit ou ne soit pas probante, je me contenterai d'avoir bien fait ressortir dans ces pages que l'indiscrétion des femmes est un mensonge inventé par les hommes. En amour, tout au moins, elles sont silencieuses comme des sépulcres. Elles se trahissent souvent par maladresse, nervosité, ou faute de savoir s'abstenir de manifestations ou d'œillades; et c'est pour ce motif qu'une grande dame qui fut en même temps une femme d'esprit, la reine de Navarre, a employé cette métaphore pour dire que toute aventure amoureuse se découvre tôt ou tard: «Le chien le mieux dressé finit toujours par aboyer.»
En citant la phrase de la reine de Navarre, je me suis rappelé qu'entre nous on demande communément à une personne qu'on voit faire mauvaise mine: «Bon Dieu! qui donc a tué vos petits chiens?» comme si on voulait dire: «Qui donc a troublé vos amours, vos aventures secrètes, etc.?» Mais ce chapitre n'est pas sérieux.
Je disais donc qu'un officier de marine m'arracha la confession des amours de Virgilia, et ici je crois devoir corriger le principe d'Helvétius, ou tout au moins l'expliquer. Mon intérêt était de me taire. Confirmer d'anciens soupçons pouvait soulever des haines amorties, provoquer un scandale, tout au moins me valoir une réputation d'indiscret. J'aurais donc dû me taire, si l'on interprète le principe d'Helvétius d'une façon superficielle. Mais j'ai donné déjà le motif de l'indiscrétion masculine: avant l'intérêt de ma sûreté personnelle, je faisais passer l'autre, celui de la vanité qui est plus intime et plus immédiat. Le premier dépend de la réflexion et suppose un syllogisme antérieur; le second est spontané, instinctif, il vient du tréfonds de l'être. Finalement, le premier ne pouvait avoir qu'un résultat éloigné, tandis que l'autre avait un résultat prochain. Conclusion: le principe d'Helvétius était applicable à mon cas, si l'on considère non l'intérêt apparent, mais l'intérêt caché.
Je ne vous ai pas encore dit,—mais je vous le dis maintenant,—qu'au moment où Virgilia descendait les escaliers et où l'officier de marine me battait sur l'épaule, j'avais déjà cinquante ans révolus. Ainsi donc, ma vie descendait aussi les escaliers, ou du moins la meilleure partie, celle des plaisirs, des agitations, des émotions, entourée il est vrai de dissimulation et de duplicité, mais la meilleure tout de même, si l'on parle le langage usuel. Mais en usant d'un autre moins sublime, la meilleure partie fut l'autre, celle que j'avais encore à vivre, comme je le prouverai dans le peu de pages qu'il me reste encore à écrire.
Cinquante ans! Pourquoi cette confession? On va trouver que mon style n'a plus la même désinvolture. Aussitôt après ma conversation avec l'officier de marine, qui enfila son manteau et sortit, j'avoue que j'éprouvai quelque tristesse. Je revins dans la salle, l'envie me prit de danser une polka, de m'enivrer de lumière, de fleurs, du reflet des cristaux, de celui des beaux yeux, du murmure sourd et léger des conversations particulières. Je n'eus pas à m'en repentir, car je me trouvai soudain tout rajeuni. Mais quand, une demi-heure plus tard, je me retirai du bal, à quatre heures du matin, qu'est-ce que je trouvai dans le fond de ma voiture? Mes cinquante ans. Ils étaient revenus avec entêtement, non point frileux ni rhumatisants, mais un peu las, et désireux d'un bon lit et de repos. Alors, voyez ce que peut l'imagination d'un pauvre homme à moitié endormi, il me sembla entendre une chauve-souris pendue au plafond me dire: «Monsieur Braz Cubas, le rajeunissement était dans la salle, dans le reflet des cristaux, dans les lumières, dans les soieries,—enfin, autour de vous et non en vous.»
Je suis sûr que si une dame m'a accompagné jusqu'ici, elle va fermer le livre, sans plus s'importer du reste. Pour elle, ce qu'il y avait d'intéressant dans ma vie, c'est-à-dire l'amour, a cessé d'exister. Cinquante ans, ce n'est pas encore la décrépitude, mais ce n'est déjà plus la fleur de l'âge. Encore dix ans, et l'on pourra m'appliquer ce que disait un Anglais: «Triste chose, de ne plus rencontrer quelqu'un qui se souvienne de nos parents, alors qu'on se demande comment vous considérera l'oubli lui-même.»
Et j'ai pris pour titre de ce chapitre «Oblivion!» Il est juste que l'on rende tous les honneurs possible à un personnage peu estimé, convive de la dernière heure, mais convive inévitable. Elle le sait bien, la jolie femme qui florissait à l'aurore du règne actuel sous le ministère Paraná, attendu qu'elle est plus rapprochée du triomphe et qu'elle se sent déjà détrônée. Alors, si elle a la dignité d'elle-même, elle ne s'entête pas à réveiller les attentions mortes ou défaillantes. Elle ne cherche pas dans les regards d'aujourd'hui les mêmes hommages que lui prodiguaient les regards d'autrefois, quand d'autres commençaient la promenade de la vie, l'âme allègre et le pied léger. Tempora mutatitur! Le même tourbillon emporte les feuilles sèches et les loques du chemin, sans exception ni pitié. Et les gens philosophes n'envient point, mais plaignent plutôt ceux qui ont pris leur place dans la voiture, parce qu'à leur tour ils seront mis à pied par le conducteur Oblivion. Et tout cela à seule fin de dérider la planète Saturne, qui promène son ennui dans l'espace.
Mais, ou je me trompe fort, ou je viens d'écrire chapitre inutile.
Et qui sait! peut-être que non. Il résume les réflexions que je fis le jour suivant à Quincas Borba, en ajoutant que je me sentais découragé, et un tas d'autres choses tristes. Mais ce philosophe, avec l'éminent bon sens qui le caractérisait, me cria que je me laissais glisser sur la route fatale de la mélancolie.
—Mon cher Braz, me dit-il, ne te laisse pas affoler par ces vapeurs. Que diable! il faut être un homme! être fort, lutter, vaincre, briller, dominer! Cinquante ans: c'est l'âge de la science et du gouvernement. Courage! Braz Cubas, ne te laisse pas déprimer. Qu'est-ce qu'elle peut bien te faire, cette succession de fleurs ou de ruines? Jouis de la vie: et n'oublie pas qu'il n'est pire philosophie que celle des pleurnicheurs qui se couchent sur les rives d'un fleuve pour se plaindre du cours incessant de l'onde. C'est son métier de ne s'arrêter jamais. Conforme-toi à cette loi, et tâche d'en tirer parti.
L'autorité d'un grand philosophe se révèle dans les plus petites choses. Les paroles de Quincas Borda eurent le don de secouer ma torpeur morale et mentale. Allons! montons au pouvoir! il en est temps. Jamais, jusqu'alors, je n'étais intervenu dans de grands débats. Je briguais le portefeuille par des amabilités, des thés, des commissions et des votes. Et le porte-feuille ne venait pas. Il fallait me rendre maître de la tribune.
J'allai doucement. Trois jours plus tard, comme on discutait le budget de la justice, je profitai de la circonstance pour demander modestement au ministre s'il ne jugeait pas opportun de diminuer la hauteur des shakos de la garde nationale. Ce n'était pas une demande de bien grande importance; mais je prouvai néanmoins que j'étais capable de discuter les affaires de l'État. Je citai Philopœmen, qui fit substituer les brodequins trop étroits de ses soldats, et leurs lances trop légères; et l'histoire ne jugea pas ces petits faits indignes d'être enregistrés. La hauteur de nos shakos devait être modifiée, au nom de l'esthétique et au nom de l'hygiène. Leur poids pouvait être fatal pendant les revues, sous l'ardeur du soleil. L'un des préceptes d'Hippocrate étant qu'il faut avoir la tête fraîche, il était cruel d'obliger un individu, pour une simple considération d'uniforme, à risquer sa santé et sa vie, et par conséquent l'avenir de sa famille. La Chambre et le gouvernement devaient se souvenir que la garde nationale était le soutien de la liberté et de l'indépendance, et que les citoyens appelés à un service pénible, fréquent, et qui plus est gratuit, avaient droit à ce qu'on leur donnât un uniforme léger et commode. J'ajoutai que la lourdeur du shako faisait courber le front des citoyens qui devaient au contraire l'élever avec fierté devant le pouvoir. Et je pérorai avec cette pensée: le saule, qui incline ses rameaux vers la terre, est l'arbre des cimetières; le palmier droit et ferme, est l'arbre du désert, des places et des jardins.
L'impression de ce discours fut diverse. Quant à la forme, à l'envolée, à la partie littéraire et philosophique, tout le monde tomba d'accord qu'il était impossible de tirer de plus brillantes idées d'un simple shako. Mais au point de vue politique, mon attitude fut considérée comme un désastre parlementaire. On insinua que je versais dans l'opposition, elles ennemis du ministère voulurent profiter de l'incident pour proposer une motion de défiance. Je repoussai une semblable interprétation. Elle était non seulement erronée, mais encore calomnieuse, tant il était notoire que j'appuyais le cabinet. J'ajoutai que la nécessité de diminuer la hauteur du shako n'était pas si urgente qu'on ne pût différer encore pendant quelques années; en tous cas, j'étais prêt à transiger sur la réduction, et je me contentais de trois ou quatre pouces en moins. Enfin, même si ma proposition n'était pas adoptée, je m'estimais déjà heureux d'avoir posé un jalon pour l'avenir.
Quincas Borba ne fit aucune restriction.
—Je ne suis pas homme politique, me dit-il au dîner. Je ne sais si tu as bien ou mal fait; ce que sais, c'est que ton discours était excellent. Et il mit en relief les parties saillantes, les belles images, les arguments puissants, avec cette pondération dans la louange qui sied si bien à un grand philosophe. Ensuite, il prit l'affaire à son compte, et combattit le shako avec tant de véhémence que je finis par me convaincre moi-même du péril qu'il offrait.
Mon cher critique,
Quelques pages plus haut, après avoir dit que j'avais cinquante ans, j'ajoutais: «On commence déjà à sentir que mon style n'est plus aussi leste Qu'aux premiers jours.» Peut-être cette phrase paraîtra-t-elle dénuée de sens, étant donné mon état actuel. Mais j'attire justement ton attention sur la subtilité de cette pensée. Je ne veux point dire que je suis en ce moment plus vieux qu'en commençant ce livre. La mort ne vieillit. Je veux dire qu'à chaque phase de cette narration j'éprouve la sensation correspondante à la phase dont je parle. Bon Dieu! quelle nécessité de mettre toujours les points sur les i!
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Il y a des choses que l'on ne traduit bien que par le silence. Par exemple ce qui fait le sujet du chapitre antérieur. Les ambitieux déçus l'entendront. Si aucune passion n'égale celle du pouvoir, comme d'aucuns le disent, imaginez le désespoir, la douleur, l'abattement où je tombai le jour que je perdis mon fauteuil de député. Toutes mes espérances s'effondraient; ma carrière politique était brisée. Or, notez que Quincas Borba, d'après certaines inductions philosophiques qu'il fit, jugea que mon ambition n'était pas la véritable passion du pouvoir, mais un simple caprice, un désir de briller. Dans son opinion, ce sentiment, quoique moins profond que l'autre, incommode davantage, car il est de la nature de l'attrait qu'ont les femmes pour les dentelles et les objets de toilette. Un Cromwell ou un Bonaparte, ajouta-t-il, par cela même qu'il est brûlé par la passion du pouvoir, finit toujours par y atteindre, par le droit chemin ou par des chemins de traverse. Ce n'était pas mon cas. Mes aspirations n'ayant pas la même intensité, je ne pouvais prétendre au même résultat. De là venait mon désenchantement. Mon sentiment, selon les doctrines de l'Humanitisme...
—Va au diable, avec ton Humanitisme, interrompis-je. J'en ai assez de ta philosophie, qui ne mène à rien.
La brutalité de cette interruption, étant donnée la supériorité du philosophe, était une véritable offense. Mais il excusa mon état d'irritation. On nous apporta du café. Il était une heure de l'après-midi; nous nous trouvions dans mon cabinet de travail qui donnait sur le fond du jardin. C'était une salle confortable, meublée de bons livres, d'objets d'art, et, entre autres, d'un Voltaire en bronze, qui paraissait à cette heure accentuer son rire sarcastique et l'acuité de son regard. Les sièges étaient excellents. Au dehors brillait un grand soleil que Quincas Borba, par plaisanterie ou dans un accès de lyrisme, appela un des ministres de la Nature. Des trois fenêtres, pendaient trois cages, où des oiseaux sifflaient leurs opéras rustiques. Tout avait l'apparence d'une conspiration des choses contre l'homme. Et bien que je me trouvasse dans mon cabinet, en face de mon jardin, assis dans mon fauteuil, au milieu de mes livres, éclairé par mon soleil, et en train d'écouter le ramage de mes oiseaux, je ne pouvais me consoler de la perte d'un autre fauteuil, auquel je n'avais plus droit.
—Mais enfin qu'as-tu l'intention de faire maintenant? me demanda Quincas Borba, en allant poser sa tasse sur le rebord d'une des fenêtres.
—Je ne sais pas. Je vais aller m'enfermer à la Tijuca; fuir les hommes. Je suis honteux et las. Tant de beaux rêves, mon cher Borba, tant de beaux rêves, et je ne suis rien.
—Rien! interrompit Quincas Borba avec un geste d'indignation.
Pour me distraire, il m'invita à sortir. Nous marchâmes dans la direction d'Engenho Velho. Nous allions à pied, tout en philosophant. Jamais je n'oublierai l'action sédative de cette promenade. La parole de ce grand homme était le cordial de la sagesse. Il me dit que je ne pouvais échapper au combat. Puisque l'on me fermait la tribune, je devais fonder un journal. Il employa même une expression vulgaire, démontrant ainsi que le langage philosophique peut, une fois ou l'autre, user des métaphores populaires.
—Fonde un journal, me dit-il, et renverse-moi toute cette petite paroisse.
—Magnifique idée! Je vais fonder un journal; je vais les réduire en miettes, je vais...
—Lutter. Peu importe le résultat. L'essentiel est de lutter. La vie, c'est la lutte. La vie sans la lutte, c'est une mer morte au centre de l'organisme universel.
Peu après, nous tombâmes sur deux chiens qui se battaient. C'est un événement sans valeur aux regards d'un homme vulgaire. Quincas Borba me les fit observer. Il me désigna un os, motif de la guerre, et mon attention fut attirée sur cette circonstance: il n'y avait pas de chair sur Los. L'os était nu. Les chiens grognaient, se mordaient, et leurs yeux étincelaient de fureur. Quincas Borba mit sa canne sous son bras et semblait en extase.
—Que c'est beau! disait-il de temps à autre.
Je voulus l'entraîner, mais en vain. Il paraissait vissé au sol, et il ne reprit son chemin qu'après avoir assisté à la défaite de l'un des deux chiens qui alla porter sa faim ailleurs. Je remarquai qu'il était joyeux, bien qu'il contînt la manifestation de sa joie, comme il convient à un grand philosophe. Il me fit observer la beauté du spectacle, rappela le sujet de la lutte, conclut que les chiens avaient faim. Mais la privation d'aliments n'est rien auprès des effets généraux de la philosophie. Sur quelques parties du globe, le spectacle est plus grandiose. Les créatures humaines y disputent aux chiens les os et autres aliments les moins appétissants. La lutte se complique, parce que l'intelligence de l'homme entre en action, avec toute la sagacité accumulée en lui par les siècles, etc.
Que de choses il y a dans un menuet, comme dit l'autre. Que de choses il y a dans un combat de chiens! Mais je n'étais pas un disciple servile et timoré, incapable de faire une réflexion opportune. Tout en marchant, je lui fis part d'un doute. Je ne comprenais pas très bien l'utilité de disputer la nourriture aux chiens. Il me répondit avec une exceptionnelle bienveillance:
—Il est indiscutablement plus logique de la disputer aux autres hommes, car leur condition est la même, et le plus fort l'emporte sur le plus faible. Mais pourquoi ne serait-ce pas un spectacle grandiose de la disputer aux chiens. On a mangé volontairement des sauterelles comme le Précurseur, ou pis encore, comme Ézéchiel. Donc, ce qui est ignoble est pourtant mangeable. Reste à savoir s'il est plus digne pour l'homme de disputer de semblables aliments pour satisfaire une nécessité naturelle, ou de manger ces mêmes aliments en vertu d'une exaltation religieuse et qui peut être passagère, tandis que la faim est éternelle comme la vie et comme la mort.
Nous étions arrivés sur le seuil de la maison. On me remit une lettre, en me disant qu'elle venait de la part d'une dame. Nous rentrâmes, et Quincas Borba, avec Indiscrétion propre à un philosophe, s'en fut lire les titres des livres sur une étagère, tandis que je parcourais la lettre, qui était de Virgilia.
Mon bon ami,
Dona Placida est au plus mal. Veuillez donc faire quelque chose pour elle. Elle demeure dans l'impasse des Escadinhas; voyez s'il est possible de la faire entrer à l'hôpital.
Votre amie dévouée,
V.
Ce n'était pas l'anglaise fine et correcte de Virgilia, mais une écriture contrefaite et inégale. Le V de la signature était un simple paraphe, sans intention alphabétique. De sorte qu'il était possible, le cas échéant, de récuser la paternité de la lettre. Je tournai et retournai le papier. Pauvre Dona Placida!... Eh bien! et les cinq contos de la plage de la Gamboa que je lui avais donnés. Je ne pouvais comprendre que...
—Tu vas comprendre, me dit Quincas Borba, en tirant un livre du rayon.
—Comprendre quoi! demandai-je abasourdi.
—Tu vas comprendre que je t'ai dit la vérité. Pascal est un de mes ancêtres spirituels. Et bien que ma philosophie soit de beaucoup supérieure à la sienne, je ne puis nier qu'il ait été un grand homme. Or que dit-il dans cette page? (Et le chapeau sur la tête, la canne sous le bras, il me désignait du doigt le passage.) Que dit-il? Il dit que l'homme a sur le reste de l'univers le grand avantage de savoir qu'il est sujet à la mort, alors que les autres êtres ne se doutent point qu'ils sont périssables. Tu vois; lorsqu'un homme dispute un os à un chien, il a sur celui-ci le grand avantage de savoir qu'il a faim. C'est cela qui rend, comme je te le disais, la lutte grandiose. «Il sait qu'il meurt», expression profonde. Je crois que la mienne est plus profonde encore, «il sait qu'il a faim». Donc le fait de mourir limite en quelque sorte l'entendement humain. La conscience de l'extinction dure un instant très court et finit pour toujours, alors que la faim a l'avantage de revenir et de prolonger l'état conscient. Il me semble, sans immodestie, que la formule de Pascal est inférieure à la mienne, sans cesser d'être une grande pensée, car Pascal fut un grand homme.
Tandis qu'il remettait le livre sur le rayon, je relisais le billet. Au dîner, voyant que je parlais peu, que je mâchais les mets sans me décider à avaler les bouchées, que je considérais le coin de la salle, le bout de la table, une assiette, une chaise, une mouche invisible, il me dit:
—Tu as quelque chose? Je parie que c'est cette lettre?...
Et réellement j'étais furieux de cette demande de Virgilia. J'avais donné à Dona Placida cinq contos de reis. Je doute que personne eût été aussi généreux que moi, cinq contos! Et qu'en avait-elle fait? Naturellement elle les avait jetés par la fenêtre en faisant la noce, et maintenant, en route pour l'hôpital! Elle pouvait bien y aller toute seule. On meurt partout. De plus je ne savais où trouver cette impasse des Escadinhas. Mais le nom seul indiquait un coin obscur de la ville. Il me fallait aller là, attirer l'attention des voisins, battre à la porte, etc. Au diable! Je n'y vais pas.
Mais la nuit, bonne conseillère, me fit comprendre que, par simple courtoisie, je devais obtempérer aux désirs de mon ancienne maîtresse.
—C'est un billet tiré sur moi, et que je dois payer à l'échéance, dis-je en me levant.
En achevant de déjeuner, je me rendis chez Dona Placida. Je trouvai une vieille carcasse enveloppée dans des haillons et couchée sur un grabat nauséabond. Je lui donnai quelque argent, et le lendemain je la fis transporter à l'hôpital de la Miséricorde, où elle mourut une semaine après. On la trouva sans vie, le matin. Elle sortit de l'existence en se cachant, comme elle y était entrée. Une fois encore, je me demandai, comme au chapitre LXXV, si c'était pour ce beau résultat que le sacristain de la cathédrale et la pâtissière avaient procréé Dona Placida dans un moment de sympathie spécifique. Mais je pensai aussitôt que sans Dona Placida mes amours avec Virgilia auraient peut-être été interrompues ou immédiatement brisées, en pleine effervescence; l'utilité de la vie de Dona Placida avait sans doute été de les entretenir. Utilité relative, j'en conviens; mais qu'y a-t-il d'absolu dans ce monde?
Quant aux cinq contos, est-il besoin de dire qu'un jardinier du voisinage feignit de tomber amoureux de Dona Placida, parvint à éveiller en elle les sens ou la vanité, et l'épousa? Au bout de quelques mois, il inventa une affaire quelconque, vendit les titres et s'enfuit avec l'argent. Inutile, n'est-ce pas? C'est comme pour les chiens de Quincas Borba. Simple répétition d'un chapitre.
Il fallait donc fonder un journal. Je rédigeait le programme, qui était une application politique de l'Humanitisme. Seulement, comme Quincas Borba n'avait pas encore publié son livre, qu'il retouchait d'année en année, nous résolûmes de n'y faire aucune allusion. Quincas Borba exigea seulement une déclaration autographe et secrète où je reconnaissais que certains principes nouveaux appliqués à la politique étaient tirés de son œuvre encore inédite.
C'était un superbe programme. J'y promettais de sauver la société, de détruire les abus, de défendre les principes libéraux et conservateurs. J'y faisais un appel au commerce et à l'agriculture. J'y citais Guizot et Ledru-Rollin, et je finissais par cette menace que Quincas Borba trouva mesquine et locale: «La nouvelle doctrine que nous professons renversera inévitablement le ministère.» Je confesse que, dans les circonstances politiques d'alors, le programme me sembla un chef-d'œuvre. Je fis comprendre à Quincas Borba que la menace de la fin, loin d'être mesquine, était saturée du plus pur Humanitisme, et il se rendit à mes raisons. Car enfin, l'Humanitisme ne comporte aucune exclusion: les guerres de Napoléon et un combat de chèvres présentent la même sublimité, à cela près que les soldats de Napoléon avaient la notion de la mort, notion qui échappe aux chèvres, en apparence du moins. Or je ne faisais qu'appliquer aux circonstances notre formule philosophique: Humanitas voulait substituer Humanitas pour la plus grande consolation d'Humanitas.
—Tu es mon disciple bien-aimé, mon calife! s'écria Quincas Borba avec un accent de tendresse que je ne lui connaissais pas. Je puis dire comme le grand Mahomet: «Si le soleil et la lune venaient à l'encontre de mes idées, je ne reculerais pas.» Crois bien, mon cher Braz Cubas, qu'elles contiennent la vérité éternelle antérieure aux mondes et postérieure aux siècles.
Je fis aussitôt passer dans la presse une note discrète annonçant que, sous quelques semaines, il allait paraître un journal d'opposition rédigé par le Dr Braz Cubas. Quincas Borba, après l'avoir lue, prit la plume, et, dans un élan de fraternité vraiment humaniste, ajouta cette phrase: «l'un des membres les plus distingués du dernier Parlement».
Le jour suivant, je vis entrer Cotrim. Il était bouleversé, mais affectait un air tranquille et gai. Il avait lu la notice, et, en bon parent, il voulait me dissuader de ma résolution. C'était une erreur, une erreur fatale. J'allais me placer dans une situation difficile, et me fermer pour toujours les portes de la Chambre des députés. Non seulement le ministère lui paraissait excellent, ce qui pouvait d'ailleurs ne pas être mon opinion, mais, qui plus est, il avait toutes les chances de durer longtemps. Que pouvais-je bien gagner en me vouant à l'ostracisme? Quelques-uns des ministres me voulaient du bien. Il n'était pas impossible qu'à la première vacance...
Je l'interrompis pour lui dire que j'avais beaucoup médité avant de prendre une décision et que je ne reculerais pas d'une semelle. Je lui offris de lui lire mon programme, mais il se refusa énergiquement à l'entendre, en disant qu'il ne voulait aucunement prendre part à mon extravagance.
—Car c'en est une, vraiment; prenez le temps de la réflexion, et vous verrez si je n'ai pas raison.
Sabine vint à la rescousse, le soir, au théâtre. Elle laissa son mari et sa fille dans la loge, me prit le bras, et m'entraîna dans le corridor.
—Mon petit Braz, qu'est-ce que tu vas faire? me demanda-t-elle avec une visible tristesse. Quelle idée de provoquer le Gouvernement, sans nécessité, quand tu pourrais...
Je répliquai qu'il ne pouvait me convenir de mendier un fauteuil au Parlement; que mon idée était de renverser le ministère, qui ne me paraissait pas opportun, et qui était en opposition avec mes conceptions philosophiques. Je lui promis de toujours employer un langage courtois, bien qu'énergique. La violence n'était pas mon fait. Sabine se donnait des tapes sur les doigts avec son éventail, dodelinait de la tête, insistant toujours, tantôt suppliante, et tantôt menaçante. Je répondais non, non et non.
—C'est bon, dit-elle, tu préfères les mauvais conseils d'étrangers envieux à ceux de ton beau-frère et aux miens. Fais ce qu'il te plaira. Nous avons rempli notre devoir. Et, me tournant le dos, elle rentra dans sa loge.
Je publiai le journal. Vingt-quatre heures après son apparition, je lus dans un autre une déclaration de Cotrim, disant en substance que, bien qu'étranger à tous les partis, il jugeait devoir déclarer hautement qu'il n'avait aucune part directe ou indirecte dans la publication de la feuille de son beau-frère, le Dr Braz Cubas, dont il désapprouvait entièrement les idées et les procédés en cette circonstance. Le ministère actuel, comme d'ailleurs n'importe quel autre composé de gens aussi éminents, lui paraissait propre à faire le bonheur de la nation.
Je n'en pouvais croire mes yeux. Je me les frottai deux ou trois fois. Puis je relus la déclaration inopportune, insolite et énigmatique. S'il était étranger aux partis, que pouvait bien lui faire un incident aussi banal que la publication d'un nouveau journal? Est-on donc obligé de déclarer par la voie des journaux si l'on est ou non favorable à un ministère? Réellement l'intrusion de Cotrim dans cette affaire était aussi mystérieuse que son agression personnelle. Nos relations s'étaient toujours maintenues dans les meilleurs termes, après notre réconciliation. Nous n'avions plus eu l'ombre d'un dissentiment. Bien au contraire, je lui avais rendu des services; comme par exemple, alors que j'étais député, l'obtention pour lui d'une fourniture à la marine, qui continuait encore, et qui, suivant ses propres calculs, et comme il me l'avait dit deux ou trois semaines auparavant, devait lui donner en trois ans près de deux cents contos de reis. Le souvenir du bienfait ne l'avait point empêché de renier publiquement son beau-frère. Il devait avoir un motif bien puissant pour venir si mal à propos manifester son ingratitude, j'avoue que c'était pour moi un problème insoluble...
...Si insoluble que Quincas Borba lui-même n'en put sortir, après l'avoir étudié longuement et avec attention.
—Bah! dit-il, tous les problèmes ne valent pas cinq minutes d'attention.
Quant à l'accusation d'ingratitude, il la rejeta entièrement, non pas comme improbable, mais parce qu'elle ne concordait pas avec les conclusions d'une bonne philosophie humaniste.
—Tu ne nieras pas, me dit-il, que la satisfaction du bienfaiteur est toujours bien supérieure à celle de l'individu qui bénéficie du bienfait. Une fois que l'effet essentiel est produit, c'est-à-dire dès que la privation a cessé, l'organisme revient à son état antérieur d'indifférence. Suppose que tu aies trop serré la boucle de ton pantalon. Pour échapper au supplice, tu la desserres, tu respires, tu savoures un court instant de jouissance, après quoi, ton organisme retourne à sa primitive indifférence, sans que tu conserves le souvenir des doigts qui t'ont rendu service.
La mémoire n'est pas une plante aérienne; elle meurt quand elle n'a pas de terrain solide où pousser des racines. L'espérance de faveurs nouvelles empêche bien celui qui en a reçu une première de l'oublier complètement. Mais ce phénomène, l'un des plus admirables d'ailleurs que la philosophie puisse trouver sur son chemin, s'explique par la mémoire des privations antérieures, ou, pour user d'une autre formule, par la privation qui se prolonge dans la mémoire, laquelle répercute la gêne passée et conseille de ne point perdre la possibilité d'un remède opportun. Je ne dis pas qu'en dehors de cette circonstance la mémoire du bienfait ne puisse subsister, accompagnée d'une affection plus ou moins intense; mais c'est là une véritable aberration, sans aucune valeur aux yeux du philosophe.
—Mais, répliquai-je, s'il n'y a aucune raison pour que celui qui a reçu un bienfait en conserve le souvenir, il y en a bien moins encore pour que ce bienfait subsiste dans le souvenir du bienfaiteur.
—Il est inutile d'expliquer ce qui est évident de sa nature, me répondit Quincas Borba. Mais je dirai plus: La persistance du bienfait dans le souvenir de celui qui l'exerce s'explique par la nature même de l'acte et de ses effets. D'abord, il y a le sentiment d'une bonne action, et par déduction la conscience que nous sommes capables de bonnes actions. Il y a ensuite le sentiment d'une supériorité en relation à une autre créature, supériorité dans l'état et dans les moyens. Et c'est là une des choses les plus agréables à l'humaine nature, si l'on en croit les opinions les mieux autorisées. Érasme, qui a écrit un certain nombre de bonnes choses dans son éloge de la folie, a appelé l'attention sur la complaisance que mettent les baudets à se gratter mutuellement. Je suis loin de dédaigner cette observation d'Érasme. Mais j'ajouterai ce qu'elle omet: à savoir, que si l'un des deux baudets gratte mieux que l'autre, le premier doit avoir dans le regard un éclair spécial de satisfaction. Si une jolie femme se regarde dans son miroir, c'est pour avoir la certitude d'une certaine supériorité sur une multitude d'autres femmes, moins jolies qu'elle, ou absolument laides. La conscience fait de même; il lui plaît de se contempler quand elle se trouve à son gré. Le remords n'est que l'angoisse d'une conscience qui se trouve laide. N'oublie pas que tout est une irradiation d'Humanitas et que par conséquent le bienfait et ses conséquences sont des phénomènes parfaitement admirables.
Chacune de nos entreprises, chacune de nos affections, représente un cycle entier de la vie humaine. Le premier numéro de mon journal fit poindre dans mon âme un et de credos. Quelques jours auparavant, j'avais imaginé l'hypothèse d'une révolution sociale, religieuse et politique qui eût fait de l'archevêque de Cantuaria un simple receveur à Petrópolis, et je m'étais livré à de longues spéculations pour savoir si le receveur eût éliminé l'évêque, si l'évêque eût éliminé le receveur, ou quelle part d'un receveur peut se combiner avec un archevêque, etc.: questions en apparence insolubles, mais non dans la réalité, si l'on prend garde qu'il peut y avoir dans un archevêque deux archevêques, celui de la bulle, et l'autre. Voilà, je serai nabab.
C'était une simple plaisanterie. J'en fis part à Quincas Borba, qui me regarda avec attention et avec une certaine tristesse, et poussa la commisération au point de me dire que j'étais fou. Je me mis à rire tout d'abord; mais la noble conviction du philosophe finit par faire naître en moi une certaine terreur. L'unique objection que je pouvais faire, c'est que je ne me sentais pas le moins du monde fou; mais elle tombait d'elle-même, si l'on songe que les vrais fous ne sentent jamais leur folie. Et voyez s'il y a quelque fondement à l'opinion populaire qui déclare que les philosophes ne s'occupent pas de menus détails. Le lendemain, Quincas Borba m'envoya un aliéniste. Je le connaissais, et je demeurai atterré de sa visite. Il s'acquitta de sa mission avec le plus grand tact, et me quitta si joyeusement que j'eus le courage de lui demander si vraiment il ne me trouvait pas fou.
—Non, me dit-il. Vous êtes dans la plénitude de votre jugement.
—Alors, Quincas Borba s'est trompé.
—Complètement. Je dirai plus: si vous êtes son ami, veillez à le distraire...
—Juste ciel! vous croyez?... un homme d'un si grand talent, un philosophe!
—Peu importe; la folie entre dans tous les cerveaux.
Figurez-vous mon affliction. L'aliéniste, voyant l'effet de mes paroles, connut que j'étais vraiment l'ami de Quincas Borba, et essaya de diminuer la gravité de son diagnostic. Il me dit que ça pouvait n'être rien, et ajouta qu'un grain de folie, loin d'être nuisible, donne du piquant à la vie. Comme je rejetais cette opinion avec horreur, l'aliéniste sourit, et me dit une chose si extraordinaire, si extraordinaire qu'elle mérite au moins un chapitre tout entier.
Je m'éloignai des groupes, en feignant de lire les épitaphes. D'ailleurs, j'aime les épitaphes. Elles sont, parmi les civilisés, l'expression de ce pieux et secret égoïsme qui pousse l'homme à enlever à la mort un peu de l'ombre dont elle s'entoure. De là vient sans doute la tristesse de ceux qui savent que leurs morts reposent dans la fosse commune. Il leur semble que la pourriture anonyme les atteint eux-mêmes.
Tout le monde était parti; ma voiture m'attendait à la porte du cimetière. J'y montai et m'éloignai en allumant un cigare. La cérémonie continuait présente à ma vue, comme les sanglots de Virgilia continuaient présents à mon ouïe, d'une façon mystérieuse, vague et problématique. Virgilia avait trompé son mari avec enthousiasme, et le pleurait avec sincérité. Il était difficile de combiner ces deux attitudes, et je m'y efforçai en vain pendant le reste du trajet. Ce ne fut qu'en mettant pied à terre, devant chez moi, que je m'avisai de la possibilité et même de la facilité d'une telle combinaison. Douce nature! la monnaie de la douleur est comme celle de Vespasien, elle n'a pas d'odeur; on la prend de la même manière, qu'on la trouve sur le mal ou sur le bien. La morale pourra bien censurer ma complice; mais que t'importe, implacable amie, douce, trois fois douce Nature, puisque tu as reçu ponctuellement ses larmes?
Je commence à devenir pathétique, et je préfère aller dormir. Pendant mon sommeil, je rêvai que j'étais nabab, et je me réveillai avec cette idée. J'aimais parfois à me bercer à ces contrastes de régions, d'états et de credos. Quelques jours auparavant, j'avais imaginé l'hypothèse d'une révolution sociale, religieuse et politique qui eût fait de l'archevêque de Cantuaria un simple receveur à Petrópolis, et je m'étais livré à de longues spéculations pour savoir si le receveur eût éliminé l'évêque, si l'évêque eût éliminé le receveur, ou quelle part d'un receveur peut se combiner avec un archevêque, etc.: questions en apparence insolubles, mais non dans la réalité, si l'on prend garde qu'il peut y avoir dans un archevêque deux archevêques, celui de la bulle, et l'autre. Voilà, je serai nabab.
C'était une simple plaisanterie. J'en fis part à Quincas Borba, qui me regarda avec attention et avec une certaine tristesse, et poussa la commisération au point de me dire que j'étais fou. Je me mis à rire tout d'abord; mais la noble conviction du philosophe finit par faire naître en moi une certaine terreur. L'unique objection que je pouvais faire, c'est que je ne me sentais pas le moins du monde fou; mais elle tombait d'elle-même, si l'on songe que les vrais fous ne sentent jamais leur folie. Et voyez s'il y a quelque fondement à l'opinion populaire qui déclare que les philosophes ne s'occupent pas de menus détails. Le lendemain, Quincas Borba m'envoya un aliéniste. Je le connaissais, et je demeurai atterré de sa visite. Il s'acquitta de sa mission avec le plus grand tact, et me quitta si joyeusement que j'eus le courage de lui demander si vraiment il ne me trouvait pas fou.
—Non, me dit-il. Vous êtes dans la plénitude de votre jugement.
—Alors, Quincas Borba s'est trompé.
—Complètement. Je dirai plus: si vous êtes son ami, veillez à le distraire...
—Juste ciel! vous croyez?... un homme d'un si grand talent, un philosophe!
—Peu importe; la folie entre dans tous les cerveaux.
Figurez-vous mon affliction. L'aliéniste, voyant l'effet de mes paroles, connut que j'étais vraiment l'ami de Quavec un poids sur la poitrine et sur la conscience. Au cimetière, au moment où je lançai la pelletée de terre sur le cercueil, le bruit du gravier sur les planches, dans la fosse, me fit passer un frisson, passager c'est vrai, mais désagréable tout de même. L'après-midi était couleur de plomb; le cimetière, les vêtements de deuil...
—Vous devez vous souvenir, me dit l'aliéniste, de ce fameux maniaque athénien, qui supposait que tous les navires qui entraient dans le Pirée lui appartenaient. C'était un pauvre diable qui n'avait peut-être pas même pour dormir le tonneau de Diogène. Mais la possession imaginaire des navires valait tous les drachmes de l'Hellade. Eh bien! il y a en chacun de nous un maniaque d'Athènes. Et si quelqu'un jure qu'il n'a pas possédé en imagination trois ou quatre bateaux dans sa vie, il un faux serment.
—Vous aussi? demandai-je.
—Naturellement.
—Et moi!
—Comme les autres; et aussi votre domestique, qui est, je crois, cet homme en train de secouer des tapis par la fenêtre.
De fait, un valet de chambre battait les tapis, tandis que nous parlions dans le jardin, tout auprès. L'aliéniste me fit remarquer qu'il avait ouvert tout grand les fenêtres, et relevé les rideaux, de façon qu'on pût voir du dehors la salle richement meublée; et il conclut:
—Votre domestique a la manie de l'Athénien. Il suppose que ces navires sont à lui. Cette douce illusion fait de lui un des heureux de ce monde.
Si l'aliéniste a raison, me dis-je, Quincas Borba n'est pas à plaindre. C'est une question de plus ou de moins. Toutefois, il est bon de veiller sur lui, et d'éviter que des maniaques d'autres régions ne fassent incursion dans son cerveau.
Quincas Borba ne partagea pas l'opinion de l'aliéniste, en ce qui concernait mon valet de chambre.
—On peut, métaphoriquement, attribuer à ton domestique la manie de l'Athénien; mais les métaphores ne sont ni des idées ni des observations prises dans la nature. Ton domestique est poussé par un sentiment noble, et parfaitement régi par les lois de l'Humanitisme: c'est l'orgueil de la servilité. Il veut montrer qu'il n'est pas le domestique de n'importe qui.
Et Quincas Borba attira mon attention sur les cochers de grandes maisons, plus orgueilleux que les maîtres, sur les garçons d'hôtels, dont la sollicitude est dosée suivant la condition sociale du voyageur. Et il conclut en disant que c'était là un sentiment délicat et noble, et qui prouvait une fois de plus que l'homme peut être sublime, même quand il cire des chaussures.
—C'est toi qui es sublime! m'écriai-je en le prenant dans mes bras.
En effet, était-il croyable qu'un homme aussi profond sombrât dans la démence? C'est ce que je lui dis après l'avoir lâché, en lui répétant les soupçons de l'aliéniste. Je ne saurais décrire l'impression que lui fit cette confidence. Je me rappelle qu'il frémit et devint tout pâle.
À cette époque, je me réconciliai de nouveau avec Cotrim, sans bien savoir pourquoi nous nous étions fâchés. La réconciliation fut opportune; la solitude me pesait, et la vie était pour moi la pire des fatigues, la fatigue sans travail. Peu après, il m'invita à m'affilier à un tiers ordre. J'acceptai après avoir consulté Quincas Borba.
—Je ne vois pas d'inconvénient, me dit-il, à ce que tu entres temporairement dans cet ordre. J'ai l'intention d'annexer à ma philosophie une partie liturgique et dogmatique. L'Humanitisme doit être aussi une religion, la religion de l'avenir, la seule véritable. Le christianisme est bon pour les femmes et les mendiants, et les autres ne valent pas mieux. Elles offrent toutes les mêmes vulgarités et les mêmes faiblesses. Le paradis chrétien est le digne émule du paradis de Mahomet. Et quant au nirvana de Bouddha, c'est une conception de paralytique. Tu verras ce qu'est la religion de l'Humanitisme. L'absorption finale, la phase contractive est la reconstitution de la substance et non son anéantissement. Va où l'on t'appelle; mais n'oublie pas que tu es mon calife.
Et admirez ma modestie. J'entrai dans le tiers ordre de ***; j'y exerçai quelques charges, et ce fut la phase la plus brillante de ma vie. Et pourtant je me tais, je ne dis rien, je ne raconte pas mes services, le bien que je fis aux pauvres et aux malades, ni les récompenses que je reçus: je ne dis rien, absolument rien.
Peut-être l'économie sociale pourrait-elle trouver quelque avantage dans une démonstration de la supériorité d'une récompense subjective et immédiate sur une récompense étrangère. Mais ce serait rompre le silence que j'ai juré de garder. D'ailleurs les phénomènes de conscience sont de difficile analyse. D'autre part, si j'en contais un, je devrais conter tous ceux qui s'y rapporteraient, et je finirais par écrire un chapitre de psychologie. Ce que je puis affirmer, c'est que ce fut la phase la plus brillante de mon existence. Les tableaux étaient tristes, ils étaient empreints de la monotonie du malheur, qui est aussi ennuyeuse que la monotonie de la jouissance, et peut-être encore davantage. Mais l'allégresse que l'on procure aux âmes des souffrants et des pauvres est une récompense de quelque valeur. Et que l'on ne dise pas qu'elle est négative parce que celui qui reçoit le bienfait est seul à en bénéficier. Non. J'en recevais le reflet, et si vif qu'il me donnait une excellente idée de moi-même.
Au bout de quelques années, trois ou quatre environ, j'en eus assez de ma charge, et je m'en démis en faisant un don de valeur, qui me mérita l'honneur devoir mon portrait mis dans la sacristie. Mais avant de passera un autre ordre d'idées, je dirai que je vis mourir à l'hôpital de notre ordre, devinez qui... la belle Marcella. Et je la vis mourir le même jour où, en allant distribuer des aumônes dans un bouge, je rencontrai... je vous le donne en mille... je rencontrai la fleur du buisson, Eugenia, la fille de Dona Eusebia et de Villaça, boiteuse comme par le passé, et plus triste encore.
Elle pâlit en me reconnaissant et baissa les yeux. Mais aussitôt, elle releva la tête, et me considéra avec dignité. Je compris qu'elle ne recevrait pas l'aumône de ma poche, et je lui tendis la main comme j'eusse fait à la femme d'un banquier. Elle me salua et s'enferma dans son galetas.
Jamais je ne la revis. Jamais je ne sus rien de son existence, ni si sa mère était morte, ni quel désastre de sa vie l'avait ravalée dans une telle misère. Je sais seulement qu'elle était toujours aussi boiteuse et aussi triste. Ce fut sous cette impression profonde que j'entrai dans l'hôpital où Marcella avait été conduite la veille, et où je la vis expirer une demi-heure plus tard, laide, maigre et décrépite...
Je compris que j'étais vieux et que j'avais besoin d'un soutien. Mais Quincas Borba était parti six mois auparavant pour Minas, en emportant avec lui la meilleure des philosophies. Il revint quatre mois plus tard, et entra chez moi, un matin, dans un état voisin de celui où je l'avais trouvé au Jardin Public. Seulement, son regard était autre. La folie avait fait son œuvre. Il me raconta que, voulant perfectionner sa doctrine de l'Humanitisme, il avait brûlé le premier manuscrit, et qu'il allait en écrire un second. La partie dogmatique était déjà achevée; il ne lui restait qu'à la mettre sur le papier. Ce serait la véritable religion de l'avenir.
—Jures-tu par Humanitas? me demanda-t-il.
—Tu le sais bien.
C'est à peine si la voix sortait de sa poitrine. Et d'ailleurs, je n'avais pas découvert toute la cruelle vérité; Quincas Borba non seulement était fou, mais encore il avait la compréhension de son état, et ce reste de conscience, semblable à la faible lueur d'une veilleuse dans les ténèbres, compliquait encore l'horreur de sa situation. Pourtant, il ne s'irritait pas contre le mal. Au contraire, il disait que c'était un témoignage d'Humanitas, qui se jouait de lui-même. Il me récitait de longs chapitres de son livre, ainsi que des antiennes et des litanies spirituelles. Il reproduisit même devant moi une danse sacrée dont il avait réglé les pas pour les cérémonies de l'Humanitisme. La grâce lugubre avec laquelle il levait et secouait les jambes, était prodigieusement fantastique. D'autres fois il se mettait dans un coin, les regards en l'air, et, de temps à autre, une lueur persistante de raison y brillait avec la tristesse d'une larme.
Il mourut peu après, chez moi, répétant et jurant jusqu'au bout que la douleur est une illusion et que Pangloss, Pangloss si calomnié, n'était pas aussi sot que le disait Voltaire.
Entre la mort de Quincas Borba et la mienne, il faut intercaler tous les événements que j'ai déjà racontés dans la première partie de ce livre. Le principal fut l'invention de l'emplâtre Braz Cubas, dont j'emportai le secret dans la tombe. Divin emplâtre, tu m'aurais donné la première place parmi les hommes; tu m'aurais placé au-dessus des savants et des riches, étant comme tu l'étais une inspiration directe du ciel. Le hasard en décida autrement, et l'humanité demeurera éternellement hypocondriaque.
Ce dernier chapitre est rempli de négatives. Je n'obtins pas la célébrité que me méritait la découverte de l'emplâtre; je ne fus ni ministre, ni calife, et j'ignorai les douceurs du mariage. Il est vrai que, comme fiche de consolation, je n'ai pas eu besoin de gagner mon pain à la sueur de mon front. Ma mort fut moins cruelle que celle de Dona Placida, et j'échappai à la demi-démence de Quincas Borba. Quiconque fera cet inventaire trouvera que la balance est égale, et que je sortis quitte de la vie. Et ce sera une erreur; car, sur le mystérieux rivage, il y a un petit solde à mon préjudice: et c'est la dernière négative de ce chapitre de négatives. Je mourus sans laisser d'enfants; je n'ai transmis à aucun être vivant l'héritage de notre misère.
FIN
[1]Cubas (cuves) en vieux portugais. (Note du traducteur.)
[2]Barata en portugais signifie «cancrelat».
[3]Tartre, en portugais tartaro, ce qui explique le jeu de mot. (Note du traducteur.)
[4]Yayá, nhonhô, nhanhá (prononcez niania), termes d'amitié. (Note du traducteur.)
End of the Project Gutenberg EBook of Mémoires Posthumes de Braz Cubas, by
Machado de Assis
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MÉMOIRES POSTHUMES DE BRAZ CUBAS ***
***** This file should be named 60847-h.htm or 60847-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/6/0/8/4/60847/
Produced by Laura Natal Rodrigues at Free Literature (Images
generously made available by Gallica, Bibliothèque nationale
de France.)
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.